| Faites connaître cet article avec Google +1 |
La suspension du jugement ou les origines
du scepticisme dans la philosophie antique.
Patrick Perrin
Précédent...
III/XII LE RELATIVISME DES SOPHISTES
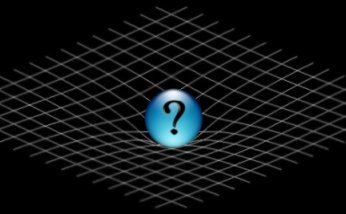 Avant-propos. Avant de se pencher sur ce nouveau chapitre, je conseille vivement au lecteur (à la lectrice) de lire ou relire le quatrième chapitre de mon article sur le logos. Dédié aux sophistes, ce texte comporte des données générales sur lesquelles je ne puis revenir ici. Par ailleurs, il ne m’est pas possible de traiter la sophistique dans son ensemble car il existe autant de doctrines (parfois contradictoires) qui lui sont attachées que de sophistes. Je n’évoquerais donc essentiellement que Protagoras en raison de son rôle prépondérant dans l’élaboration du relativisme. Par contre, je conseille vivement aux personnes souhaitant accéder à une connaissance plus étendue concernant ce sujet de lire l’excellent livre de Gilbert Romyer Dherbey : Les sophistes, Que sais-je, 2009.
Avant-propos. Avant de se pencher sur ce nouveau chapitre, je conseille vivement au lecteur (à la lectrice) de lire ou relire le quatrième chapitre de mon article sur le logos. Dédié aux sophistes, ce texte comporte des données générales sur lesquelles je ne puis revenir ici. Par ailleurs, il ne m’est pas possible de traiter la sophistique dans son ensemble car il existe autant de doctrines (parfois contradictoires) qui lui sont attachées que de sophistes. Je n’évoquerais donc essentiellement que Protagoras en raison de son rôle prépondérant dans l’élaboration du relativisme. Par contre, je conseille vivement aux personnes souhaitant accéder à une connaissance plus étendue concernant ce sujet de lire l’excellent livre de Gilbert Romyer Dherbey : Les sophistes, Que sais-je, 2009.
« Les sujets travaillent à l’avantage du plus fort et font son bonheur en le servant, mais le leur de nulle manière. (...) L’homme juste est partout inférieur à l’injuste (...) L’injustice est plus avantageuse que la justice (...) L’injustice poussée à un degré suffisant, est plus forte, plus libre, plus digne d’un maître que la justice, et, comme je le disais au début, le juste consiste dans l’avantage du plus fort. Platon, la République, Livre I, 343b. 344b »
« Et chaque gouvernement établit les lois pour son propre avantage : la démocratie des lois démocratiques, la tyrannie des lois tyranniques et les autres de même ; ces lois établies, ils déclarent justes, pour les gouvernés, leur propre avantage (...) Dans toutes les cités le juste est une même chose : l’avantageux au gouvernement constitué ; or celui-ci est le plus fort, d’où il suit, pour tout homme qui raisonne bien, que partout le juste est une même chose : l’avantageux au plus fort. Platon, ibid., 338 c. »
Attribués au sophiste Thrasymaque par Platon, ces propos soulèvent deux questions : Le sophiste a-t-il véritablement parlé ainsi à Socrate et, si c’est le cas, plaida-t-il une doctrine personnelle ou se borna-t-il à effectuer un constat ? En d’autres termes, peut-on se fier à Platon ? Faire abstraction du contexte philosophico-historique propre à cette époque (notamment la rivalité entre Socrate et les sophistes), pourrait conduire à commettre une erreur : penser que les sophistes furent tels que Platon les décrivit. Adopter ce point de vue conduirait alors à considérer Thrasymaque (ainsi que le très controversé Calliclès) comme des cyniques (j’emploie ce terme dans son acception ordinaire) dépourvus de tous scrupules et dont la philosophie se résumerait à ce précepte : N’est juste que le plus fort. Seulement, par chance, « par bonheur », nous dit G. Romeyer Dherbey : « Un fragment de Thrasymaque sur la justice qui n’est pas tiré de La République (Platon), mais d’un discours du sophiste nous dit que " Les dieux ne regardent pas les choses humaines ; en effet, ils ne manqueraient de prendre en garde le plus grand des biens chez les hommes – la justice. Or, nous voyons que les hommes ne la pratiquent pas. " Les sophistes, p. 71. » Ce fragment illustre le désabusement et la pensée réelle de Thrasymaque qui prit acte de “l’abandon des dieux” et d’une réalité qu’il désapprouvait sinon pourquoi aurait-il considéré cette justice, absente de la cité, comme le plus grand bien des hommes ?
Les problèmes soulevés par Platon sont toujours les mêmes : D’une part, comment, dans ses dialogues, distinguer la part pouvant lui être attribuée de celle revenant à Socrate et, d’autre part, qu’elle est l’ampleur des débordements polémiques qui entachent l’image des sophistes ? Dans ce contexte, ne pourrait-on penser que Platon se servit des sophistes (habiles rhétoriciens) pour faire prévaloir ses propres idées en déformant jusqu’à la caricature les leurs ?
Toutefois, penser que Socrate et Platon auraient uniquement considéré les sophistes comme des “faire-valoir” reviendrait à méconnaître l’ampleur des divergences entre les premiers et les seconds. Mais, pourrait-on se demander, quel fut l’objet de ces désaccords ? Il porta essentiellement sur la possibilité, ou la non-possibilité, de connaître “l’Etre en soi” de toute chose. Platon ne pu nier l’existence des choses perçues par les sens mais, pour lui, elles ne relevaient que d’un monde sensible des plus trompeurs. (cf. Le mythe de la caverne : La République, livre VII, 514a – 517c -) Si donc, les choses ne peuvent être l’objet d’une connaissance véritable, pensa-t-il, c’est qu’il doit exister un autre ordre de réalité que les transcendent. Pourtant, nul ne peut contester que nos sens perçoivent les choses... Certes, répondra Socrate mais : « Que dirions-nous qu’est le vent pris en lui-même, froid ou non froid ? Ou bien en croirons-nous Protagoras et dirons-nous qu’il est froid pour celui qui a froid, et qu’il n’est pas froid pour celui qui n’a pas froid ? (...) Alors l’apparence et la sensation sont la même chose. Théétète, 152b,c. » Mais, s’il en est ainsi, la raison ne peut s’appuyer sur les sens pour connaître. Toutefois, en rester là, conduirait à penser que la connaissance véritable est impossible et, dès lors, triompherait le relativisme de Protagoras. Admettre cela aurait été une concession de trop pour un Platon qui, par ailleurs, n’avait pu éviter de commettre un “parricide” douloureux : « C’est qu’il nous faudra nécessairement, pour nous défendre (des sophistes), mettre à la question la thèse de notre père Parménide et prouver par la force de nos arguments que le non-être est sous certain rapport, et que l’être, de son coté, n’est pas en quelque manière. Le Sophiste, 241e. » Bien que ce parricide n’ait en aucun cas détruit la conception parménidienne de l’être, il a cependant fortement limité la portée de la célèbre formule de Parménide : « L’être est et le non-être n’est pas. » En outre, s’il ne donne pas entièrement raison à Héraclite, il cautionne néanmoins une partie de sa célèbre sentence : « On ne peut pas descendre deux fois dans le même fleuve. Fgt. 91 »
La scène était donc dressée. D’un coté, l’être parménidien, certes altéré mais toujours présent et, de l’autre, une doctrine soutenue par Héraclite et Protagoras selon laquelle la perception des choses toujours en mouvement ne peut être que relative souvenons-nous du passage 440c du Cratyle de Platon – cf. supra). Un statu quo aurait pu s’installer entre ces deux conceptions. Mais, de toute évidence, la pensée platonicienne ne parvint à s’y résoudre. Dans un premier temps, Socrate s’efforça de démontrer que les acceptions courantes de concepts tels que la justice, la beauté, la science, la sagesse etc. étaient fausses. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’il n’existait par de référents sur lesquels s’appuyer (les fameux “critères” ou “démonstrations” de Sextus Empiricus). A titre d’exemple, penchons sur ce fragment du Théétète : « Mais ce qu’on te demandait, Théétète, ce n’était pas cela, de quoi c’est la science et combien il y a de sciences, car ce n’était pas dans le dessein de les dénombrer que je t’interrogeais, mais pour savoir ce que peut être la science en soi. 146e » Dans l’instant suivant, Socrate déclare que l’on ne pouvait comprendre : « Ce qu’est la science de la chaussure, quand on ne sait pas ce qu’est la science. 147b » Concernant cette fois-ci les mots, un passage du Cratyle évoque, une fois encore, cette quête quasi obsessionnelle du fondement des choses : « Ce serait là des échappatoires fort ingénieuses de la part de ceux qui refusent de rendre compte de la justesse des noms primitifs. Cependant, de quelque façon qu’on ignore la propriété des mots primitifs, il est impossible de connaître celle des dérivés, qui ne peuvent s’expliquer que d’après les premiers, au sujet desquels on ne sait rien. 425c » Ce dernier fragment illustre parfaitement une donnée des plus paradoxale : C’est le doute systématique qui fonda la pensée de Socrate. Ceci explique, d’ailleurs, que la plupart des dialogues l’ayant mis en scène (Le Théétète, par exemple) n’ait pas abouti. Mais (et comme s’y exercera plus tard Descartes), son élève Platon n’en restera pas là. C’est dans ce sens qu’un dialogue, même inachevé, comme le Théétète, encore, annonce la théorie des Idées ; théorie ambiguë dont la finalité semble s’inscrire dans une perspective gnoséologique (théorie philosophique de la connaissance). Platon fut en effet des plus cohérent. Puisque la perception des choses et les opinions fausses dont elles étaient l’objet ne permettaient pas de les connaître véritablement, il fallait de toute évidence se référer à un autre ordre de réalité. Héraclite aurait pu être confronté au même problème puisque, pour lui aussi, la connaissance des choses était relative. Il n’en fut rien car il était protégé par le logos qui préservait, en dépit de la mobilité des choses, l’unité d’un être universel. Seulement, à l’époque de Platon, le logos était en crise car les sophistes l’avaient totalement séparé de la transcendance. Coupée de toute relation avec le sacré, la parole était devenue une rhétorique destinée à convaincre. Le logos étant descendu sur terre, s’étant laïcisé, pourrait-on dire, plus de communication possible avec le divin. Dès lors, à quoi pouvaient servir les dieux et, en tout premier lieu, étaient-ils connaissables ? A la suite Xénophane de Colophon (Cf. supra), Protagoras répondit sans ambiguïté : « Sur les dieux, je ne puis rien dire, ni qu’ils soient, ni qu’ils ne soient pas : bien des choses empêchent de le savoir, d’abord l’obscurité de la question, ensuite la brièveté de la vie. Fgt III » Fondateur de son agnosticisme (refus de se prononcer sur l’existence, ou la non existence, de (ou des) dieu), ce fragment préfigura son “homme/mesure”. Ici, nous sommes parvenus au cœur de l’origine du relativisme né de l’alternative suivante :
2) Soit, cette réalité transcendantale n’existe pas (Nous sommes chez Protagoras) et, dès lors, l’homme ne peut accéder qu’à une connaissance partielle des choses car sa raison est vassalisée par ses sens. Cette théorie fonde le relativisme et le scepticisme.
C’est à partir de ces doctrines opposées que naquirent certains grands couples antagonistes de la philosophie : Le dogmatisme et le scepticisme ; l’empirisme et l’idéalisme ; le rationalisme et le scepticisme et, quittons un instant la philosophie au sens strict du terme : le théisme et l’agnosticisme. Le relativisme repose donc sur un double refus : celui du divin (d’où l’agnosticisme de Protagoras) et celui envers les théories prônant l’existence d’une cause première (comme en atteste le deuxième trope d’Agrippa,- Cf. Diogène Laërce, Ibid. p. 201 -. J’y reviendrais). Il en découle qu’une connaissance absolue des choses est impossible et, qu’à un moment donné, ne peut que survenir la suspension du jugement. (Une exception notable concerne le sophiste Hippias pour lequel, et par le truchement des mots, une connaissance vraie des choses est possible.)
Si tout est relatif, à quoi se référèrent Socrate et Platon ? Renouant quelque part avec le logos d’Héraclite, Socrate invoqua “ un démon” intérieur, une sorte de guide envoyé par le divin. (Le démon de Socrate ne doit pas être confondu avec celui des ecclésiastiques pour lesquels il est ange déchu ou diable. Celui de Socrate était dieu, déesse ou divinité. D’un point de vue philosophique, il est préférable de le considérer comme un conseiller, une sorte de guide, issu d’une transcendance devenue immanence afin d’être perceptible. – Le “porte-parole” du dieu des chrétiens, en quelque sorte... -) Dès lors, et sans redouter un sophisme éhonté, Socrate pu affirmer « qu’il ne savait rien » et, de fait, il ne prit guère de risques puisqu’il était guidé par une instance douée d’un savoir plus sibyllin et plus étendu que le sien.
Platon n’a pas recouru à ce type de justification. Par contre, il a imaginé une architecture que l’on pourrait qualifier de géniale si elle n’était pas dépourvue de tout fondement : la théorie des Idées. Apparemment simple (Une Idée serait le modèle universel des choses qui lui sont rattachées), cette théorie s’avère finalement complexe car elle renvoie à la notion de “chose en soi”. De quoi s’agit-il ? Et, surtout, peut-on la percevoir ? Penchons-nous sur l’avis de Platon : « Et nous appelons beau en soi, bien en soi et ainsi de suite, l’être réel de chacune des choses que nous posions d’abord comme multiples, mais que nous rangeons ensuite sous leur idée propre, postulant l’unité de ces dernières. (...) Et nous disons que les unes sont perçues par la vue et non par la pensée, mais que les idées sont pensées et ne sont pas vues. République VI, 507b. » D’une manière très claire, Platon vient de nous faire savoir que les Idées n’appartiennent pas au monde sensible puisqu’elles ne peuvent être vues. Mais comme elles peuvent être pensées, elles découlent nécessairement de l’activité cognitive et participent par-là même de “l’intelligible” (Il est possible de rapprocher les idées platoniciennes des concepts des mathématiques : ils sont en effet indépendants de l’expérience sensible). Si l’on veut bien suivre Platon, il y aurait donc deux mondes superposés, l’un en “bas”, le monde sensible et l’autre en “haut”, le monde intelligible, celui dans lequel résident les Idées. Cependant, dans la mesure ou l’homme perçoit le premier et imagine le second, comment peut-il être assuré de l’existence de ce dernier ? Et, question des plus intéressante, le monde intelligible de Platon ne serait-il pas finalement celui des concepts ? Prenons pour exemple un enfant qui vient de naître. D’évidence, il ne connaît pas un monde qu’il va devoir découvrir. Ses parents désignent un meuble : « C’est une table » disent-ils à leur enfant. L’expérience s’étant reproduite plusieurs fois, l’enfant finit par associer l’objet table avec l’image acoustique qui l’accompagne et la représentation mentale qui s’ensuivra. Dès lors, le mot table est devenu un concept attaché à ce meuble. Si l’on veut bien mettre en perspective cet exemple avec la théorie platonicienne, nous pouvons penser que le concept “table” correspond à l’Idée de “table”. Si les choses étaient réellement ainsi, elles seraient des plus simples. Mais, Platon était tout sauf un pragmatique. Pour lui, l’Idée ne pouvait en aucun cas relever d’un processus ne résultant que de l’unique activité humaine mais bien davantage d’une ordonnance vassalisée par le divin. En atteste par exemple ce célèbre fragment (République X 597a) : « Ainsi, il y a trois sortes de lits ; l’une qui existe dans la nature des choses, et dont nous pouvons dire, je pense, que dieu est l’auteur. (...) Une seconde est celle du menuisier. (...) Et une troisième, celle du peintre. » L’Idée platonicienne correspond quelque part à la cause finale d’Aristote dans la mesure ou elle est la cause (et le modèle) de l’objet qu’elle désigne. Et, dès lors, il n’est pas surprenant que la connaissance la plus aboutie d’un objet perçu soit celle de son Idée. En effet, connaître l’Idée d’un objet donné apporte la connaissance de tous les objets semblables à lui-même. Par exemple, si l’on me désigne une plante que l’on nomme oeillet sans me dire qu’il s’agit d’une fleur, lorsque je verrai une rose je ne pourrais en aucun cas savoir qu’il s’agit également d’une fleur. Finalement l’un des rôles de l’Idée platonicienne est de subsumer (Intégrer un individu dans une espèce, l’un des buts de la logique aristotélicienne) les choses multiples dans une unité. Transcendante, en raison de son origine divine, l’Idée est également immanente puisqu’elle émane de l’esprit humain. Quelque part, elle joue le rôle du logos d’Héraclite : réunir le transcendant et l’immanent.
J’ai précédemment évoqué le fragment No 3 du sophiste Protagoras et avancé que ces quelques lignes pouvaient être considérées comme fondatrices de l’agnosticisme de son auteur. Peut-être est-il utile de les rappeler : « Sur les dieux, je ne puis rien dire, ni qu’ils soient, ni qu’ils ne soient pas : bien des choses empêchent de le savoir, d’abord l’obscurité de la question, ensuite la brièveté de la vie. » Ensuite, et en plein accord avec Gilbert Romeyer Dherbey (Les sophistes), j’ai ajouté que ce fragment annonçait le célèbre fragment No 1 selon lequel : « L’homme est la mesure de toutes choses, de celles qui existent et de leur nature ; de celles qui ne sont pas et de l’explication de leur non-existence. » Pierre de voûte de la pensée de Protagoras, ce fragment exprime le recentrage radical de l’homme sur lui-même. Désormais ; nous sommes fort éloignés de la transcendance platonicienne ; nous sommes même quasiment aux antipodes de l’idée de transcendance. Les conséquences philosophiques de cette conception ont été considérables. En ayant rejeté tout recours au divin, tout recours à l’absolu, Protagoras à jeté les bases du subjectivisme et d’un humanisme radical. Seulement, toute médaille a son revers : dès lors que les dieux s’avèrent incapables de guider l’homme, celui-ci se retrouve face à lui-même avec ses incertitudes et ses doutes. C’est en ce sens que Protagoras peut, à juste titre, être considéré comme un relativiste car le relativisme reste ce qui demeure lorsque le divin s’enfuit. Ceci étant, on ne peut qualifier Protagoras de sceptique car son homme/mesure est également un homme/connaissance et cela, par la seule vertu du discours. Pour qui veut comprendre les sophistes, la clé de leur pensée est dans cette relation.
Protagoras, nous dit Diogène Laërce (ibid. p. 185), : « fut le premier qui déclara que sur toute chose on pouvait faire deux discours exactement contraire, et il usa de cette méthode. » (Le premier scolarque de “l’Académie moyenne”, Arcélisas, a soutenu la même thèse. Il est des plus étonnant que, gérant l’école fondée par Platon, ce philosophe ait repris à son compte l’un des arguments essentiels des sophistes.) Protagoras vient de poser les bases du discours double qui actualise une contradiction dans une quasi-immédiateté. Pour note, il développa cette thèse dans son ouvrage : Les Antilogies (Le terme antilogie désigne la contradiction entre deux thèses philosophiques – ou opinions – émanant du même auteur). Si donc, il est possible d’émettre deux discours opposés sur une même chose c’est admettre qu’il est impossible d’affirmer que cette chose est ceci et non cela. Déjà mise à mal par cette éristique (art de la controverse, de la contradiction), l’ontologie de Parménide subira un nouveau coup, porté cette fois-ci par le sophiste Gorgias. Dans son traité Du non être, il part du principe que rien n’est. Et même si l’être est, il est inconnaissable. Et, s’il était connaissable, nul ne pourrait communiquer cette connaissance. Finalement, le sophiste a appliqué à la notion d’être le même relativisme dont Xénophane fit preuve au sujet de la vérité : « La vérité, aucun homme ne la connaît, et aucun ne la connaîtra. » Il découle de tout ceci que, l’être soit ou qu’il ne soit pas, revient au même puisqu’il est inconnaissable. (Il en va de même pour Dieu : que l’on y croit ou non, nul n’est en mesure de prouver son existence comme, d’ailleurs, son inexistence.)
Il est donc possible d’émettre deux discours opposés sur une même chose, vient de nous faire savoir Protagoras. Certes, mais il va bien falloir trancher : lequel est le plus juste ? Le plus performant, en termes plus modernes ? Dans un premier temps, c’est l’homme/mesure qui va en décider. Mais en fonction de quels critères ? Préfigurant quelque part l’utilitarisme de Jeremy Bentham (1748/1832) et celui de John Stuart Mill (1806/1873), Protagoras a recouru à une notion essentielle de sa pensée : l’utilité. Citons pour exemple quelques fragments du Théétète de Platon. Par la bouche de Socrate, c’est Protagoras qui parle : « (...) Par homme sage, j’entends précisément celui qui, changeant la face des objets, les fait apparaître et être bons à celui à qui ils apparaissaient et étaient mauvais. (...) De même, en ce qui concerne l’éducation, il faut faire passer les hommes d’un état à un état meilleur, mais, tandis que le médecin le fait par ses remèdes, le sophiste le fait par ses discours. (...) J’affirme en effet que les laboureurs remplacent dans les plantes, quand ils en trouvent de malades, les sensations mauvaises par les sensations bonnes. (...) A la vérité, ce qui paraît juste et honnête à chaque cité est tel pour elle, tant qu’elle en juge ainsi. 166e, 167d » Il est donc utile pour le laboureur de remplacer les plantes malades et tout aussi utile pour le sophiste de changer son élève par son seul discours. Ici, un problème se pose : certes l’homme est la mesure de toute chose mais, si son discours ne traduit que cet état, à quoi pourrait-il donc servir ? En outre, s’il existe un seul discours pour un seul homme, il y aura obligatoirement autant de discours qu’il y aura d’hommes et, conséquemment, autant de vérités. Comme à son habitude, Platon n’a pas manqué de se ruer dans la brèche : « Il en résulte en outre quelque chose de tout à fait plaisant, c’est que Protagoras reconnaît que, lorsque ses contradicteurs jugent de sa propre opinion et croient qu’il est dans l’erreur, leur opinion est vraie, puisqu’il reconnaît qu’on ne peut avoir que des opinions vraies. (...) La vérité de Protagoras sera donc révoquée en doute par tout le monde, à commencer par lui. (...) Donc, puisqu’elle est contestée par tout le monde, la vérité de Protagoras n’est vraie pour personne, ni pour tout autre que lui, ni pour lui. Théétète, 171a,c » De fait, si Protagoras n’était allé plus loin, il n’aurait pu s’affranchir de cette redoutable aporie (contradiction insoluble). Seulement, tout comme Platon, le sophiste vit au cœur de la démocratie athénienne et le propre de ce système politique consiste à confronter des avis opposés. La conquête du pouvoir passe, non pas par la vérité platonicienne, mais par la persuasion en vue de l’adhésion du plus grand nombre à un discours donné. Les sophistes n’ont pas cherché ce qu’était le “politique” mais ils ont réfléchi sur les moyens à mettre en oeuvre pour faire de la politique ce qui impliquait (et implique toujours) une parfaite maîtrise du langage. Dès lors, peu surprenante est l’affirmation de Protagoras selon laquelle sur toute chose on pouvait faire deux discours exactement contraire car, c’est le propre même de la parole politique. Pour Protagoras, il n’y a donc pas de vérité en soi mais seulement une vérité utile mise à la disposition des rhéteurs. Le cheminement de sa pensée commence par la mise en lumière de la contradiction (les Antilogies) qui se résolvent dans un premier temps dans l’homme/mesure pour finir dans un utilitarisme des plus pragmatique. Si donc le pouvoir est obtenu grâce à un discours l’ayant emporté sur un autre, c’est qu’il existe deux types de discours : l’un “fort” et l’autre ”faible”. Et, même si cela peut paraître regrettable, le discours fort n’est pas forcément le discours le plus juste. C’est à partir de ce constat, et contrairement à Platon, que Thrasymaque a dissocié radicalement l’éthique de la politique. Dès lors, il put affirmer que « le juste consiste dans l’avantage du plus fort » Et, ce faisant, il a très clairement défini la politique dont la vertu première est précisément de ne pas s’encombrer de vertu.
On pourrait reprocher aux sophistes d’avoir fourni des armes ayant contribué à alimenter l’injustice. C’est d’ailleurs bien un tel procès que leur intenta Platon. Cela dit, ce même Platon (Théétète, 176a) admit lui-même : « Qu’il n’était pas possible que les maux disparaissent car il faut toujours qu’il y ait quelque chose de contraire au bien. » De fait, pour qu’il y ait un vainqueur, il faut bien qu’il y ait un vaincu. Mais, et si l’on excepte Critias, les sophistes n’ont fait l’apologie ni de ce qui était nuisible à l’homme ni de ce qui pouvait l’asservir. Ils ont simplement réfléchi sur le discours et, surtout, qu’elles étaient ses modalités et son utilité. Peut-on le leur reprocher ? Après tout, que faisons-nous d’autre lorsque nous parlons ? Ne souhaitons-nous pas persuader ? Convaincre ? Nous défendre ? Manifester notre amour ? Nos désirs ? Nos aversions ? Nous plaindre ? Nous réjouir ? Ne sommes-nous pas, comme le déclara Aristote, des animaux raisonnables parce que doués de parole ?
Pour ma part, je ne sais si une chose est ou n’est pas. Par contre, je pense que si une chose est, elle est toujours par rapport à une autre chose et qu’il est essentiel de savoir laquelle est la meilleure pour nous. Je n’irais pas jusqu’à dire qu’il s’agit là de sagesse mais, de lucidité, oui. « Connais-toi toi-même », disait Socrate certes, mais connaissons aussi ce qui est bon (bien ?) pour nous-même : « Tout être animé, écrivit Epictète, est naturellement porté à fuir et à se détourner de ce qui lui paraît un mal et de ce qui en est la cause, à rechercher et à s’éprendre de se qui lui paraît un bien, et de ce qui le procure. Manuel, p. 197 » Eloignons-nous quelque peu de notre sujet pour remarquer que le législateur moderne ferait bien de s’imprégner de ce fragment avant de légiférer sur tout et n’importe quoi : « On a légiféré sur les yeux, déplorait déjà le sophiste Antiphon, les choses qu’ils doivent voir et celles qu’ils ne doivent pas. Et sur les oreilles, les choses qu’elles doivent entendre, et celles qu’elles ne doivent pas. Et sur la langue, les choses qu’elle doit dire et celles qu’elle ne doit pas. Et sur les mains, les choses qu’elles doivent faire et celles qu’elles ne doivent pas. (...) Et sur l’esprit, ce qu’il doit désirer et ne pas désirer. » (Citation empruntée à Gilbert Romeyer Dherbey, Les sophistes, p. 104, 105) Si la loi est indispensable, notamment pour protéger le plus faible face aux velléités du plus fort, elle devient l’ennemi de l’homme dès lors qu’elle ne cherche qu’à réprimer (nous en savons quelque chose aujourd’hui..!) Comme le professèrent les sophistes Hippias, Lycophron et Antiphon, la loi (nomos), non seulement se dresse contre la nature, mais s’avère incapable de rendre meilleurs les citoyens du moins, de leur plein gré. Bien qu’il soit peu optimiste, ce constat marque les limites de ce que l’on nomme : l’état de droit.
Penseurs d’une extraordinaire modernité, les sophistes ont désacralisé la philosophie de Platon et centré le discours au cœur de la démocratie athénienne. Plus encore qu’Aristote, ils ont porté leur regard sur la terre. Non pas celle des “physiciens” présocratiques, mais sur celle des hommes. Et, si l’on refuse impérativement de se référer à un quelconque divin, tout devient effectivement relatif car tout dépend de l’appréciation de l’homme, vis à vis de lui-même comme vis à vis de ce qui l’entoure. De ce point de vue, le relativisme est l’un des fils de la liberté.
Suivant...


