| Faites connaître cet article avec Google +1 |
La suspension du jugement ou les origines
du scepticisme dans la philosophie antique.
Patrick Perrin
Précédent...
II/XII LE PRE-RELATIVISME DES PRESOCRATIQUES
Dans la mesure ou l’un et l’autre nient l’existence d’une cause première, il existe une filiation entre le relativisme et le scepticisme. Cependant, et si l’on veut bien se souvenir que l’on prête à Protagoras la formule fondatrice du relativisme, il serait maladroit de considérer ses prédécesseurs comme relativistes (et moins encore, sceptiques) sous peine de commettre un anachronisme. Toutefois, Diogène Laërce s’est affranchi de ce risque : « Une tradition fait d’Homère le fondateur de cette secte (les sceptiques) parce que des mêmes choses, il a parlé diversement et parce qu’il ne porte sur rien un jugement catégorique. On dit encore que les sept sages étaient des sceptiques, parce qu’ils ont dit par exemple : " Rien de trop " ou " Qui se porte garant se prépare du malheur " (...) De la même façon, on peut joindre aux Sceptiques Xénophane (de Colophon), Zénon d’Elée et Démocrite. Xénophane ne dit-il pas : La vérité, aucun homme ne la connaît, et aucun ne la connaîtra. » (Ibid. 194, 195). Face à ce fragment, il est possible soit d’accorder notre créance à Diogène et, dès lors, nous pouvons effectivement considérer les penseurs cités comme des pré-sceptiques (voire des sceptiques) ou replacer cette doctrine dans son contexte historique. Dans ce dernier cas, nous devons considérer Pyrrhon comme son fondateur (avec des réserves sur lesquelles nous reviendrons). Remarquons que les deux options sont recevables à la condition, cependant, de bien spécifier ce que l’on entend par scepticisme. Si nous le considérons comme une disposition à douter manifestée par l’esprit humain, nous pouvons suivre Diogène. Par contre, si nous étudions le scepticisme en tant que doctrine, il ne peut être antérieur à Pyrrhon.
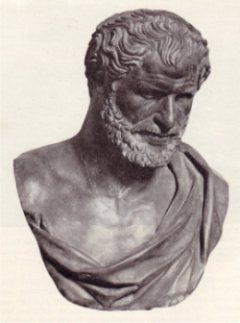
Héraclite d'Éphèse
Tout comme le relativisme de Protagoras s’apparente à un pré-scepticisme, les réticences manifestées par certains présocratiques en matière de connaissance (notamment celle dispensée par les sens) peuvent être qualifiées de pré-relativistes. Mais, auparavant, il convient de distinguer deux formes de relativisme. Adoptée par Protagoras, la première peut être considérée comme un “subjectivisme”. En énonçant que “l’homme est la mesure de toutes choses”, Protagoras considéra l’homme comme l’acteur prépondérant dans sa relation avec la nature, prépondérance qui se prolongea dans l’éthique et la politique. Il jeta ainsi les bases d’un subjectivisme radical. Par contre, le célèbre fragment 91 d’Héraclite : « On ne peut pas descendre deux fois dans le même fleuve », suggère une forme plus objective, plus théorique, du relativisme dans la mesure ou il met en exergue la difficulté de connaître véritablement les choses en raison de leur instabilité et de leur mobilité. (Ici, nous rejoignons le cœur de la pensée platonicienne. En effet, pourquoi Platon jugea-t-il nécessaire d’imaginer un “monde intelligible” peuplé d’Idées immuables ? Un fragment important du Cratyle (440c) apporte un début de réponse à cette difficile question : « Mais on ne peut même pas dire, Cratyle, qu’il y ait connaissance, si tout change et si rien ne demeure fixe ; car, si cette chose même que nous appelons connaissance ne cesse pas d’être connaissance, alors la connaissance peut subsister toujours et il y a connaissance. Mais si la forme même de la connaissance vient à changer, elle se change en une autre forme que la connaissance et, du coup, il n’y a plus de connaissance ; et, si elle change toujours, il n’y aura jamais connaissance, et pour la même raison il n’y aura ni sujet qui connaisse ni objet à connaître. Si au contraire le sujet connaissant subsiste toujours, si l’objet connu subsiste, si le beau, si le bien, si chacun des êtres subsiste, je ne vois pas que les choses dont nous parlons aient aucune ressemblance avec le flux et le mouvement. En est-il ainsi de ces choses ou sont-elles comme le dit Héraclite ? » Assez paradoxalement, nous pouvons penser que “l’idéalisme platonicien” s’arc-boute sur une certaine forme de scepticisme liée aux difficultés d’une connaissance qui ne reposerait que sur les sens. En effet, si tout change, à commencer par nous-mêmes, comment pouvons-nous être assurés de la fiabilité de ce que nous percevons ?
Ceci étant, une question se pose : lorsque Démocrite nous dit que « C’est l’usage qui fait dire d’une chose qu’elle est froide ou qu’elle est chaude (...) », nous parle-t-il de connaissance ? En d’autres termes, affirmer qu’une chose est chaude ou froide, douce ou amère, belle ou laide relève-t-il de la connaissance ou d’autre chose ? Si, contre Socrate (Cf. Le Théétète), nous choisissons la connaissance, le procès sceptique sera alors possible mais si nous procédons différemment, nous entrerons directement dans le champ du relativisme. L’ambiguïté que l’on peut relever dans le fragment de Démocrite (et certains présocratiques avant lui), résulte sans doute de la confusion entre deux données : la connaissance et l’appréciation des choses opérée par les sens qui lui est complémentaire. En effet, la sensation de douceur ou d’amertume, par exemple, est une affaire de goût et non d’intellect. De son coté, la connaissance appartient à l’univers du cognitif (faculté de connaître) d’ailleurs, écoutons Socrate : « Ce n’est donc point dans les impressions que réside la science, mais dans le raisonnement sur les impressions » (Platon, Théétète, 186d) Cette distinction entre perception et cognition explique qu’un même objet puisse être perçu différemment. Par exemple, tel plat sera estimé trop salé par l’un et trop peu par l’autre. Les deux ont raison et prétendre les départager reviendrait à ignorer que leurs jugements ne relèvent pas de la connaissance mais de la seule sensation. Tout ceci nous conduit à évoquer les deux principaux caractères de la philosophie et de la science grecques qui hantèrent la spéculation platonicienne : l’un repose sur un modèle déductif, cognitif alors que l’autre actualise un modèle empirique (doctrine selon laquelle la connaissance est fondée sur l’expérience sensible.) La pensée, d’un coté, et la perception sensible, de l’autre ou, pour rester chez Platon : le mode intelligible d’un coté et le monde sensible, de l’autre.
Maintenant, nous pouvons nous demander pourquoi il est possible de dénicher certains signes annonciateurs du relativisme (et même du scepticisme) chez quelques penseurs présocratiques. Pour tenter de répondre à cette question il faut essayer de s’imaginer ce que peut être une civilisation dépourvue de connaissances scientifiques. Dans un tel contexte, tout est mystère : le jour, la nuit, la pluie, l’orage, le vent etc. Pourtant, la nature existe. Jour après jour, elle se dévoile mais, le fait-elle réellement ? Par exemple, lorsque la foudre s’abat sur un arbre, est-il possible de ne pas s’interroger au sujet de son origine ? Et cela d’autant plus que ce phénomène est terrifiant ? Les hommes baignés dans une telle civilisation n’ont pas de réponse. Alors, tout naturellement, ils imaginent autant de causes mythiques susceptibles d’expliquer les phénomènes. Dès lors, les dieux sont responsables de tout : le meilleur ou le pire, le bonheur ou le malheur, la fortune ou l’infortune. Dans un tel contexte, nulle place pour le doute puisque l’homme n’est pas tenu de chercher. Il n’est pas dans l’obligation de démêler le vraisemblable de l’invraisemblable. Il n’a donc pas besoin de connaître. Ne pouvant se tromper, il ne peut douter. Plus encore, en attribuant aux dieux la paternité de toutes choses, il ne peut en être la mesure.
Les choses en étaient là lorsque survint Thalès (~624/548 av. J.C.). Bien qu’encore baigné dans la cosmogonie de l’époque, il eut le mérite d’affirmer que l’eau était l’élément primordial à partir duquel était généré tout ce qui existait. Dès lors, la voie conduisant de l’explication mythique à l’explication physique était ouverte. On pourrait penser que sa thèse relève d’une naïveté “prélogique” en raison notamment de son inanité. Seulement, se borner à un tel raisonnement reviendrait à oublier que Thalès jeta les bases d’un processus qui jamais ne s’arrêta (tout au plus fut-il ralenti par le dogmatisme transcendantal judéo-chrétien). En posant un principe explicatif de la nature, il détourna ses yeux du ciel pour fixer son regard sur ce qui l’entourait. Avec Thalès commence une chasse visant à dénicher un principe premier (un élément) susceptible de devenir, par-là même, la cause originelle des choses. Maintenant, pourrait-on penser, en quoi cette quête nouvelle fut-elle extraordinaire ? Après tout, Hésiode (Cf. la Théogonie) n’attribua-t-il pas la transition du chaos originel (le désordre) vers le cosmos (l’ordre, donc l’univers) au dieu Eros ? On serait donc en droit de penser qu’Hésiode et Thalès tentèrent d’une manière identique de définir une cause première pouvant expliquer l’existence de l’univers (Eros, d’un coté et l’eau, de l’autre). Il semble n’en être rien car la référence d’Hésiode était d’origine divine alors que celle de Thalès se trouvait dans l’univers lui-même. Transcendance chez Hésiode, immanence (théorie selon laquelle l’univers n’est pas réglé par un principe supérieur) chez Thalès. Tout comme la séparation entre muthos et logos favorisa la naissance de la philosophie (Cf. mon premier article) la dissociation entre l’immanence et la transcendance jeta les bases de la science grecque. Et, incontestablement, Thalès fut l’un des précurseurs de cette évolution. Seulement, affirmer que l’eau est l’élément fondateur de tout ce qui existe, n’explique pas les apparences mouvantes des choses. De plus, en n’étant plus protégée par l’architectonique divine, la raison humaine fut progressivement conduite à émettre des hypothèses susceptibles de rendre compte des phénomènes perçus par les sens. Une telle orientation, une telle solitude, ne pouvait conduire qu’à des doutes et à des incertitudes. C’est sans doute ainsi que se profila le relativisme de Protagoras et, plus tard, le scepticisme de Pyrrhon.
Tout naturellement, les dieux furent les premières victimes de cet orgueil nouveau de la raison. C’est ainsi que, tout en ne niant pas leur existence, Xénophane de Colophon (VI/V av. J.C.) accentua plus encore la coupure entre les dieux et les hommes : « Il n’y eut dans le passé et il n’y aura jamais dans l’avenir personne qui ait une connaissance certaine des dieux et de tout ce dont je parle. Même s’il se trouvait quelqu’un pour parler avec toute l’exactitude possible, il ne s’en rendrait pas compte lui même (...). fgt. 34 » Dès lors, les dieux devinrent inconnaissables ce qui, plus tard, incitera Epicure à douter de leur utilité : « Il faut éviter de faire intervenir une explication d’ordre divin, car il ne faut attribuer à la divinité aucune intervention dans le monde (...) Diogène Laërce, Ibid. p. 249. » Il ne faudrait toutefois pas penser que Xénophane accordât aux perceptions le primat de la connaissance. A l’instant évoqué, son fragment nous fait savoir que la connaissance des dieux est impossible mais ne remet aucunement en cause leur existence. Cela implique la cohabitation de deux ordres de réalités distincts : l’un, accessible à l’expérience sensible et l’autre, constitué de valeurs supérieures. Remarquons, toutefois, que s’il existe deux ordres de réalité, il existe nécessairement deux modes de connaissance. Et, Xénophane aurait été l’un des premiers philosophes à avoir opposé « le savoir à l’apparence en attribuant aux dieux la connaissance véritable et aux hommes la conjecture » (Jean Brun, les Présocratiques, p. 67). Nous pouvons remarquer que ce dualisme instauré au cœur de la connaissance nous renvoie une fois encore à Platon (que l’on relise le mythe de la caverne). Par ailleurs, dans la mesure ou il existe une connaissance “inférieure” (les conjectures) alimentée essentiellement par les sens, celle-ci ne peut qu’être entachée par le doute et ne peut que conduire à une forme de pré-relativisme. Cela s’explique si l’on veut bien comprendre, qu’à l’inverse de l’esprit, les sens ne spéculent pas : ils perçoivent, sans plus. Par contre, le cerveau est capable de se souvenir d’une sensation (la madeleine de Proust, par exemple) à laquelle, souvent, il associe une connotation (valeur affective associée à un mot en dépit de son sens). C’est ainsi qu’un myosotis, un oeillet ou autre peut faire surgir de la mémoire des souvenirs liés par exemple à l’enfance. Chaque sens peut donc être le générateur d’une représentation mentale qui est associée à un objet perçu. Or, la représentation mentale est à la base du concept lequel peut-être à l’origine d’une théorie ce qui, sans doute, fit dire au sceptique Sextus Empiricus (II ou III apr. J.C.) que « Les sens sont simplement affectés, alors que la pensée va de la saisie des choses senties à la saisie des choses pensées. Esquisses pyrrhoniennes, III, 47. »
Comme tous les penseurs de cette époque, Anaxagore de Clazomènes (V av. J.C.) a proposé une cosmologie (Etude des lois générales qui gouvernent l’univers) laquelle reposa sur un concept précis : le Noûs (ou Esprit). Ici, il ne s’agit pas d’un élément fondateur de tout ce qui existe (comme l’eau de Thalès) mais d’une véritable intelligence rectrice de l’univers : « Les autres choses ont une part du tout ; mais le Noûs, lui, est infini, autonome, et ne se mélange à rien ; il est seul lui-même et par lui-même, car, s’il n’était pas par lui-même et s’il était mêlé à quelque autre chose, il participerait à toutes choses dans la mesure où il serait mêlé à l’une d’elle. Car, en tout, il y a une part du tout (...) Et ce qui serait mêlé au Noûs l’empêcherait d’avoir pouvoir sur chaque chose, comme il l’a maintenant étant seul par lui-même. » (fgt. 12) Ce fragment nous renvoie à la bipartition de Xénophane : les dieux sont réels mais inconnaissables (et constituent donc la réalité ultime), alors que les objets perçus par les sens sont certes connaissables mais imparfaitement. En effet, le Noûs d’Anaxagore agit sur les choses mais n’est pas mêlé à elles. Il en découle, qu’une fois encore, il existe, selon ce philosophe, deux ordres de réalité : celui qui concerne le Noûs (qui est à la fois transcendant et immanent au monde) et un autre ne comportant que les phénomènes perceptibles par les sens. Dès lors, il devient compréhensible que le Noûs relève d’une affirmation de nature dogmatique ne pouvant souffrir d’aucun doute alors que la perception (et, par voie de conséquence, la connaissance) des phénomènes est pour le moins sujette à caution. Anaxagore ne dit pas autre chose lorsqu’il affirme que : « A cause de la faiblesse de nos sens, nous sommes impuissants à distinguer la vérité. » (fgt. 20) Si donc, Anaxagore ne s’inscrit pas en faux contre une raison capable d’imaginer une architecture qui la dépasse (Descartes recourra à cette faculté pour démontrer l’une de ses preuves de l’existence de dieu), il n’en reste pas moins le prisonnier d’un dualisme très clairement hiérarchisé : un connaissable absolu (le Noûs) puisqu’il est le fruit d’une spéculation purement intellectuelle et un environnement (le “monde sensible” de Platon) qui ne peut être connu que par des perceptions défectueuses. Finalement, et en dépit de la souplesse et de la finesse de la pensée d’Anaxagore, nous sommes, une fois encore, confrontés aux limites de la connaissance et, conséquemment, à une théorie pré-relativiste.
Quelques décennies plus tôt, un autre grand philosophe de l’antiquité Parménide (VI/V av. J.C.), l’auteur de la célèbre formule : l’Etre est et le non-Etre n’est pas : « De toute nécessité, il faut dire et penser que l’Etre est, puisqu’il est l’Etre. Quant au non-Etre, il n’est rien, affirmation que je t’invite à bien peser. » (fgt. 6) fit preuve, lui aussi, d’une indéniable réserve à l’encontre de la validité des sens. En effet, et si nous voulons bien suivre Diogène Laërce, (Ibid. p. 172) : « Parménide (...) prend la raison pour critère de la vérité et déclare que nos sens nous trompent. Il dit en effet : Ne tente pas, suivant cette route commune de la coutume, de prendre pour règle ton oeil aveugle, ton oreille pleine de bruits, et ta langue, mais que la raison tranche les arguments controversés. » Dans le même passage, Diogène poursuit : « C’est pourquoi Timon (L’un des élèves du sceptique Pyrrhon) a dit de lui : “De Parménide le fol orgueil et le grand savoir luttent contre les illusions et les tromperies des sens.” » Parménide est sans doute le philosophe qui illustra mieux qu’aucun autre l’un des plus grands paradoxes de la pensée des présocratiques : accorder autant de crédit à la raison tout en se défiant des sens. Cette coupure entre l’imaginé et le perçu pourrait expliquer la cohabitation d’avis dogmatiques (par exemple, “l’être est et le non-être n’est pas” de Parménide) avec des attitudes pré-relativistes, voire pré-sceptiques. Finalement, les philosophes pré-socratiques n’ont-ils pas été les fondateurs de l’école de la contradiction ?
C’est dans ce contexte que s’éleva la voix du véritable précurseur du relativisme : Héraclite VI/V av. J.C.). A l’instar des philosophes de son temps, lui aussi s’interrogea sur la fiabilité des sens : « La présomption ? Une maladie sacrée. La vue ? Une tromperie. » (fgt. 46) Nous pourrions donc penser que Parménide vient de nous dire la même chose mais la célèbre métaphore d’Héraclite selon laquelle : « On ne peut pas descendre deux fois dans le même fleuve. » (fgt. 91) explique d’une manière nouvelle la relativité des perceptions en lui donnant une cause. En effet, nous dit-il, si nos sens sont trompeurs c’est parce que : « La nature aime à se dérober à nos yeux. » (fgt. 123) Sans nier l’ambiguïté de ce fragment (ambiguïté relevée par Jean Brun, Les présocratiques, p. 62), nous pouvons malgré tout penser (sans trop trahir Héraclite) qu’en raison de la mouvance des choses, de leur mobilisme permanent, les bien connaître s’avère des plus aléatoire. Toutefois, cette remarque ne nous autorise pas à considérer Héraclite comme un sceptique. En effet, et rappelons le, il est le philosophe du logos. Or, le logos est la cause et l’expression de toutes choses (fgt. 1). S’exprimant par la bouche d’Héraclite, il est une passerelle entre le transcendant et l’immanent : « Il est sage, nous dit Héraclite, d’écouter non pas moi-même, mais le logos et de confesser que toutes choses sont un. » (fgt. 50) Héraclite nous confronte donc à deux difficultés : la première, comme nous venons de le voir, résulte de l’instabilité des choses et, la seconde, plus énigmatique il est vrai, est due aux limites de la raison humaine : « Ce mot (logos), les hommes ne le comprennent jamais, aussi bien d’en avoir entendu parler qu’après. Bien que tout se passe selon ce mot, ils semblent n’avoir aucune expérience de paroles et de faits tels que je les expose, en distinguant et en expliquant la nature de chaque chose. Mais les hommes ignorent ce qu’ils ont fait en état de veille, comme ils oublient ce qu’ils font pendant leur sommeil. » (fgt. 1) Si donc les hommes sont incapables d’accéder au creuset de la transcendance, il leur est toutefois loisible d’accéder à la connaissance d’eux-mêmes : « A tous les hommes, il est accordé de se connaître eux-mêmes et de faire preuve de sagesse. » (fgt. 116) Ici, on ne peut s’empêcher de songer à la célèbre maxime de Socrate : « Connais-toi toi-même » et également à celle de Thalès selon laquelle : « Se connaître est difficile. » (Pour note, Diogène Laërce attribue la paternité du “Connais-toi toi-même” socratique à Thalès) Au risque d’être démenti, je pense que le fragment 116 peut être considéré comme l’un des signes annonciateurs du relativisme de Protagoras. En effet, et en raison même de sa formulation, ce fragment renvoie l’homme à lui-même. Et, si l’homme n’est pas encore la mesure de toutes choses, il commence à être sa propre mesure.
Lors de la rédaction de mon article sur l’ataraxie, j’ai dédié un chapitre à Démocrite dans lequel j’ai tenté de montrer les grandes lignes de sa physique : l’atomisme. Aussi, je ne pense pas utile d’y revenir. L’un des problèmes soulevés par ce philosophe concerne sa relation avec le sophiste Protagoras et, en filigrane, la date de sa naissance. Celle de Protagoras est estimée aux alentours de 492 av. J.C. alors que celle attribuée à Démocrite est loin d’être claire. En effet, alors qu’Apollodore situe sa naissance en – 460, Diodore le fait naître en – 494. Que l’on choisisse l’une ou l’autre de ces dates (la chronologie d’Apollodore semble l’emporter aujourd’hui) n’a finalement aucune importance dans la mesure ou il connut Socrate : « On croit, ajoute Démétrios, qu’il vint à Athènes, et ne chercha pas à se faire connaître, parce qu’il méprisait la gloire, qu’il connut Socrate, mais ne se fit pas connaître de lui. » (Diogène Laërce, ibid. p. 180) Cet extrait met en exergue un anachronisme qui a conduit beaucoup de spécialistes de la philosophie antique à considérer Démocrite comme un présocratique. C’est ainsi que Jean Brun n’a pas hésité à intégrer ce philosophe dans l’un de ses ouvrages (Les présocratiques), et cela, sans avoir pris la précaution de mettre en garde ses lecteurs. Cette parenthèse fermée, la trentaine d’années d’écart concernant sa naissance a une conséquence sur l’influence, ou l’inverse, qu’il aurait pu avoir sur Protagoras. Il existe donc deux hypothèses : soit Protagoras fut son disciple (certains témoignages semblent l’attester) soit ce fut Protagoras qui l’influença (ce que semble penser certains exégètes modernes.) Pour nous aussi, ce débat n’est pas sans conséquences car, selon la thèse adoptée, Démocrite peut-être considéré comme un relativiste ou comme un pré-relativiste. Jean Brun (les Présocratiques, p. 121) s’avère des plus réservé : « Nous trouvons donc chez Démocrite une théorie empirique de la connaissance ; toutefois une telle théorie s’achève, sinon par un subjectivisme relativiste (position de Protagoras) ou par un certain scepticisme, du moins par un certain pessimisme désabusé. » Quelque part, on ne saurait mieux dire surtout si l’on se penche sur le fragment 117 : « En réalité nous ne savons rien, car la vérité est au fond de l’abîme. » De fait, pour l’inventeur de l’atomisme (avec Leucippe, il est vrai), connaître véritablement les choses, s’avère des plus aléatoire : « Et pourtant on verra bien nettement qu’il est embarrassant de savoir ce qu’est véritablement chaque chose » (fgt. 8) Un peu plus loin, Démocrite insiste : « De la réalité nous ne saisissons rien d’absolument vrai, mais seulement ce qui arrive fortuitement, conformément aux dispositions momentanées de notre corps et aux influences qui nous atteignent ou nous heurtent. » (fgt. 9) Ce dernier fragment rappelle un peu celui d’Héraclite selon lequel : « A tous les hommes, il est accordé de se connaître eux-mêmes (...) ». Car, finalement, “saisir ce qui arrive fortuitement conformément aux dispositions momentanées de notre corps” revient à reconnaître qu’il est possible de saisir une petite partie de la réalité. Et cela, bien que : « Nous ne saisissions pas véritablement ce que chaque chose est ou n’est pas (...) » (fgt. 10) Toutefois, le “scepticisme” de Démocrite est fortement tempéré par le fragment 11 : « Il y a, nous dit-il, deux formes de connaissance : l’une véritable, l’autre obscure. A la connaissance obscure appartiennent la vue, l’ouïe, l’odeur, le goût, le toucher. La véritable connaissance est toute différente. Quand la première se révèle incapable de voir le plus petit (...) Il faut pousser ses recherches sur ce qui est plus difficilement perceptible à cause de sa finesse, alors intervient la connaissance véritable qui, elle, possède un moyen de connaître plus fin. » Nous retrouvons ici la bipartition de Xénophane et celle d’Anaxagore selon lesquelles il existe un connaissable absolu (accessible par la seule raison) et un connaissable relatif (celui dispensé par les sens.) Fil conducteur de la pensée antique (qui associe des affirmations que l’on peut qualifier de dogmatiques en matière de physique avec une réelle défiance envers les sens), ce dualisme est très énigmatiquement évoqué par Démocrite : « La couleur n’existe que par convention, nous dit-il, de même le doux, de même l’amer, suppose que les sens ripostent à la raison : Pauvre raison, tu prends chez nous tes arguments et t’en sers pour nous calomnier. Ta victoire est ton échec ! » (fgt. 125) Je laisse à la lectrice, au lecteur, le soin de méditer sur ce très beau fragment qui illustre, Oh combien ! La dramaturgie dans laquelle la philosophie antique fut baignée...
Suivant...


