| Faites connaître cet article avec Google +1 |
Philosophie politique.
Aristote et platon. Politique et démocratie.
Patrick Perrin
Précédent...
IV/IV ARISTOTE ET PLATON : POLITIQUE ET DÉMOCRATIE

Aristote
« Si Platon est le plus admirable, Aristote est le plus important des philosophes occidentaux. Jean-François Revel »
« Puisque toute cité, nous le voyons, est une certaine communauté, et que toute communauté est constituée en vue d’un certain bien (car c’est en vue de ce qui leur semble un bien que tous font tout ce qu’ils font), il est clair que comme toutes les communautés visent un certain bien, c’est le bien le plus éminent entre tous que vise au plus haut point celle qui est la plus éminente de toutes et qui contient toutes les autres. Or c’est celle que l’on appelle la cité, c’est à dire la communauté politique. Aristote : Les politiques »
1- Précédemment ( Cf. mon article : Naissance du relativisme chez les sophistes ), nous avons remarqué qu’il était très difficile de distinguer la pensée socratique (comme celle des sophistes, d’ailleurs) à la seule lecture des dialogues platoniciens il semble exister une ambiguïté de cet ordre en matière de politique. En effet, les conceptions exposées dans les Politiques d’Aristote sont-elles si différentes de celles soutenues dans la République de Platon ? Toutefois, si l’on peut soutenir qu’Aristote ne se soit pas détourné de la politique, il ne l’aborda pas de la même manière que Platon. Pour ce dernier, en effet, politique et éthique étaient étroitement liées. Certes, il existait bien une différence quantitative entre elles mais la même justice, donc la même vertu, devait régner dans l’individu et dans la cité. Et cela à un point tel que la qualité de la seconde dépendait directement de la première : « N’y a-t-il pas grande nécessité, nous dit Platon, de convenir qu’en chacun de nous se trouvent les mêmes formes et les mêmes caractères que dans la cité ? (...) Il serait, en effet, ridicule de penser que le caractère irascible de certaines cités n’a pas son origine dans les particuliers qui ont la réputation de le posséder (...) La République, IV, 435e. » Chez Aristote, semble-t-il, si éthique et politique visent toutes deux le souverain bien (le bonheur), c’est la politique qui prédomine : « Puisque dans toutes les sciences et tous les arts le but est un bien, que le plus grand bien réside essentiellement dans la science qui est absolument souveraine sur toutes les autres, et que c’est la faculté politique, et que le juste c’est le bien politique à savoir l’avantage commun (...) Aristote : Les Politiques, p. 259. »
2- Philosophe par excellence de la connaissance, Aristote observe, classe mais se garde bien d’extrapoler. C’est pourquoi sa conception de la politique est, avant tout, descriptive et repose sur l’analyse d’un très grand nombre de constitutions attachées aux cités grecques, notamment de son temps. En fait, et pour recourir à une formulation moderne, Aristote s’est livré à une enquête de terrain et non à une spéculation mue par un utopisme si cher à Platon. Par conséquent, pas de « philosophe roi » pour cet esprit pour le moins pragmatique qui s’est borné à nous faire part de ce qui est. Donc, de ce qui est perceptible et, par conséquent, observable.
3- Historiquement, et même philosophiquement, il existe une incontestable filiation entre le platonisme et l’aristotélisme et, de ce point de vue, on peut dire que le Lycée (École fondée par Aristote en –336) fut le descendant direct de l’Académie (École fondée par Platon en -387.) Ceci étant, il ne faudrait surtout pas penser que le Lycée fut une copie fidèle de l’Académie car la filiation ayant liée les deux Écoles n’impliqua aucunement une vassalité de la première vis à vis de la seconde. Aussi, si le Lycée ne peut être considéré comme un rival (au sens propre de ce terme) de l’Académie, il en fut nettement distinct. Dans un autre domaine, et alors que Platon fut un athénien de naissance (il naquit à Athènes probablement en – 427), Aristote ne fut athénien que par adoption. En effet, il naquit à Stagire (colonie ionienne sise sur la côte macédonienne) en –384. Toutefois, il est utile de remarquer que, et bien que située en Macédoine, Stagire était une ville grecque dans laquelle, par conséquent, on parlait la langue grecque ce qui facilita l’installation d’Aristote à Athènes. Étant le médecin du roi Amyntas (le père de Philippe II de Macédoine, lui-même le père d’Alexandre le Grand) Nicomaque, le père d’Aristote lui ouvrit toutes grandes les portes de la cour des rois de Macédoine ; cour qui exerça sur lui une profonde influence.
4- C’est à l’âge de 17 ans (nous sommes en –366 environ) qu’Aristote s’installe à Athènes et s’inscrit, comme étudiant, à l’Académie de Platon. Il y restera jusqu’à la mort de son maître en –347. Très vite, et en raison de la puissance de sa pensée, Aristote sera amené à souvent contredire son maître. Notons, cependant, qu’aucune source ne permet de dire que les deux philosophes s’entredéchirèrent au point de se haïr. Bien au contraire, Aristote manifesta toujours une réelle affection envers son maître et son École comme en témoigne ce célèbre passage de l’Éthique de Nicomaque : « Certes la recherche est difficile du fait que ce sont de nos amis – les platoniciens - qui ont introduit la doctrine des Idées. Peut-être, de l’aveu général, vaut-il mieux et faut-il même, pour sauver la vérité, sacrifier nos opinions personnelles, d’autant plus que nous aussi nous sommes philosophes. On peut avoir de l’affection pour les amis et la vérité ; mais la moralité consiste à donner la préférence à la vérité. »
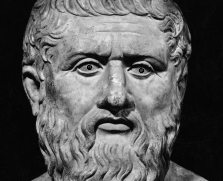
Platon
Note : La doctrine des Idées (ne surtout pas confondre ce terme avec son acception moderne), point central de la métaphysique platonicienne, repose sur une conception bipolaire du monde (il en sera d’ailleurs de même pour Aristote mais pour des raisons très différentes). Pour Platon, en effet, il existe un monde intelligible (celui des Idées ou essences) et un monde sensible dans lequel siègent la multiplicité et le changement. A l’opposite de ce dernier, le monde intelligible est constitué d’êtres stables, non-changeants, et toujours identiques à eux-mêmes. Ces êtres sont des modèles, des archétypes, pourrait-on dire, fondateurs des réalités sensibles appartenant à l’autre monde. Cette conception qui repose sur un monde transcendant (c’est à dire extérieur et supérieur par rapport au monde sensible) conduisit Platon à imaginer sa théorie de la participation (ou lien entre ses deux mondes) afin de démontrer que le monde intelligible est le principe, et l’origine, du monde sensible. C’est précisément cette conception qu’Aristote va reprocher à Platon notamment dans sa Métaphysique : « Dire que les Idées sont des paradigmes et que les autres choses participent d’elles, c’est se payer de mots vides de sens et faire des métaphores poétiques. » Comme le résume très clairement la célèbre fresque de Raphaël (L’École d’Athènes dans laquelle Platon est représenté un doigt levé vers le ciel alors que celui d’Aristote est baissé vers la terre), Platon, et en dépit du célèbre parricide commis à l’encontre de Parménide (Le Sophiste, 241e), n’a pas cru que le monde sensible puisse être pourvoyeur de la connaissance des réalités enfouies en son sein. Aussi, a-t-il cherché dans le ciel intelligible les principes d’explication de l’essence des êtres. A l’encontre de Platon, Aristote aurait recherché dans la réalité elle-même (c’est à dire, accessible à l’observation) les principes susceptibles de la mieux comprendre. Ce qui précède explique pour une large part que la Cité idéale, telle qu’elle est décrite dans la République ou les Lois de Platon n’ait été qu’un modèle et non une réalité. Et cela, en dépit des efforts déployés par le législateur pour s’opposer aux changements responsables de son inévitable décadence. Car, liée au monde sensible, elle aussi est soumise à la corruption due au temps qui emporte toute chose.
5- Nous sommes en –343 lorsque Philippe II de Macédoine confia à Aristote l’éducation de son fils Alexandre le Grand. Comme il ne reste aucune trace de l’enseignement qu’Aristote prodigua à Alexandre, on ne peut dire qu’elle furent ses conséquences sur la politique conduite par son élève lorsque celui-ci, après l’assassinat de son père en –336, accéda au trône de Macédoine. Il semble, cependant, qu’Alexandre conserva des relations amicales avec son maître du moins jusqu’en –325 date à laquelle il fit assassiner Callisthène, le propre neveu d’Aristote, en raison de divergences politiques. Ce meurtre paraît donc, sinon avoir interrompu cette connivence, entre autres intellectuelle, du moins l’avoir singulièrement ralenti. Par contre, la relation entretenue entre Alexandre (donc la cour macédonienne) et Aristote eut des conséquences négatives sur la vie du philosophe. Mais, avant toutes choses, souvenons-nous que Philippe II (le père d’Alexandre, rappelons le) avait annexé la Grèce notamment à la suite de la bataille de Chéronée en –338 (Cf. Sur ce même site : La naissance de la démocratie à Athènes, section 16.) Or, l’assassinat de Philippe suscita un immense espoir de liberté dans les cités grecques ; espoir aussitôt déçu par la réaction d’Alexandre qui s’employa à faire taire ce genre de velléités. Plus tard, en –335, et mettant à profit les dures campagnes engagées par Alexandre aux abords des frontières balkaniques, les Grecs pensèrent que le moment était venu pour se soulever à nouveau. La réplique d’Alexandre fut immédiate : il s’empara de Thèbes, chef de file de la rébellion, la détruisit et vendit ses habitants comme esclaves. Dès lors, la paix s’installa durablement sous son règne. La Grèce était donc totalement asservie. La notion même de cité autonome était anéantie et, bien évidemment, le processus démocratique fut durablement stoppé (il faudra d’ailleurs attendre la révolution française de 1789 pour que la démocratie renaisse de ses cendres.) Dans ce contexte politique (non politique devrait-on plutôt dire), notamment désastreux pour Athènes, la philosophie politique émanant des Politiques d’Aristote ne pouvait être que mort-née comme le souligne si finement Pierre Pellegrin dans son introduction au texte du Stagirite.
6- Nous sommes en –323 lorsque survint le décès d’Alexandre. Aussitôt, le parti anti-macédonien releva la tête et intenta, par l’intermédiaire de Démophile, un procès pour impiété contre Aristote. Gravement menacé, le philosophe jugea plus prudent de s’exiler afin, dit-il, : « D’épargner aux Athéniens l’opprobre d’un second crime contre la philosophie. » (Le premier fut commis à l’encontre de Socrate qui dut boire la ciguë en –399.) Aristote se réfugia donc à Chalcis en Eubée où il mourut en –322 à l’âge de 63 ans. A la suite du départ d’Aristote, l’un de ses élèves, Théophraste, prit la direction de l’École jusqu’à sa mort en –287. Sous la direction de Théophraste, le Lycée connut une forte expansion (le nombre des élèves inscrits atteint même 2000.) Cet important regain d’activité perdura sous le scolarquat (direction) de Straton de Lampsaque jusqu’à sa mort en –260. Le déclin de l’École s’amorça avec le successeur de Straton : Lycon. Dès lors, ce déclin ne cessa jamais de s’interrompre jusqu’à la publication du décret de l’Empereur Justinien (en 529) ordonnant la fermeture des écoles philosophiques d’Athènes. A la suite de cette décision éminemment politique, la pensée grecque s’exila en Orient avant de réapparaître en Occident vers le XIIe siècle. A partir de ce moment, l’Occident va redécouvrir Aristote grâce, notamment, à saint Thomas d’Aquin (1227/1274) qui reprit un très grand nombre de thèmes philosophiques du stagirite afin de les rendre compatibles avec les impératifs de la doctrine chrétienne. Ceci étant, saint Thomas d’Aquin ne fut pas le premier penseur a avoir tenté de rapprocher la philosophie aristotélicienne de la religion. En effet, et précédemment, le philosophe Averroès (1126/1198) s’était employé à démontrer que, loin de contredire le coran, l’aristotélisme le consolidait. Cependant, et comme cela arrive bien souvent dans le monde des idées (pas au sens platonicien...), l’avis d’Averroès ne fut guère partagé notamment par saint Thomas d’Aquin qui ne cessa de le combattre.
7- Pour essayer de comprendre la philosophie politique d’Aristote (et, a fortiori, celle de Platon), il me paraît indispensable de dissocier notre environnement sociopolitique (et géopolitique) de celui qui existait à l’époque des deux philosophes. Il faut donc rester prudent lorsque nous nous penchons sur notre lointain passé et surtout de ne pas faire des grecs de cette époque « nos fils en croyant faire nos pères » (Jean Brun, Les présocratiques, p. 11.) C’est pourquoi, et notamment dans le domaine politique, il faut se prémunir contre l’erreur « sociocentrique » qui consisterait à attribuer au passé les valeurs du présent. Par exemple, la notion « d’État », telle que nous la concevons aujourd’hui, ne s’apparente guère avec celle qui prédominait durant le siècle de Périclès (Ve siècle av. J.C.) A cette époque, il s’agissait davantage « d’États-Cités » que d’États au sens moderne. Pour mieux se représenter les choses, imaginons que chacun de nos départements soit véritablement autonome et, par conséquent, doté d’une constitution propre. Par exemple, tel département serait une oligarchie alors que tel autre serait une monarchie voire, une démocratie. A priori, une telle organisation pourrait être considérée comme pleinement satisfaisante et, en tous cas, ne pas soulever de problèmes particuliers. Seulement, les cités grecques, dès qu’elles se sont engagées vers des formes politiques plus sophistiquées, n’ont cessé d’être en crise. Dès le VIIe siècle, la quasi-totalité d’entre-elles s’est engluée dans des conflits internes le plus souvent générés par les rivalités entre conservateurs et démocrates (voir, dans ce même site mon article : Naissance de la Démocratie à Athènes.) Facteurs aggravants s’il en fut, l’antagonisme entre la Grèce et la Perse (d’où les guerres médiques) ou, encore, celui ayant opposé Athènes et Sparte (d’où les guerres du Péloponnèse) ont baigné la mer Égée dans de perpétuels désordres et, surtout, dans un constant climat d’insécurité.
8- Ballottées au gré des vents insufflés par les rapports de force inhérents à la politique, les constitutions se défaisaient donc aussi vite qu’elles s’installaient dans les cités. A l’instar de la quatrième république en France (1945/1958), l’instabilité politique était la règle et, de fait, perdura jusqu’à l’asservissement de la Grèce à la suite de la bataille de Chéronée (en –338) gagnée par le Macédonien Philippe II. A cette époque, et indépendamment du contexte géopolitique, ces désordres constitutionnels étaient, pour la plupart, générés par les incessants conflits entre deux idéologies prédominantes : celle des conservateurs et celle des démocrates. Tout comme aujourd’hui, d’ailleurs, le problème soulevé ici concerne la répartition des richesses et il ne semble pas que « la main invisible » d’Adam Smith (pardon pour l’anachronisme...) se soit révélée des plus performante en matière d’équité. Pour les conservateurs de l’époque Antique, il était absolument exclu de renoncer à leurs privilèges, leurs biens patrimoniaux ou, plus prosaïquement, financiers. A l’opposite, les démocrates n’eurent de cesse d’imposer politiquement des conditions de vie plus justes et, surtout, plus équitables pour les gens démunis en raison de la voracité des conservateurs. Finalement, et de tout temps, la politique s’inscrit dans une problématique opposant les dominants et les dominés ou, si l’on préfère, les riches et les pauvres. Antagonisme multi-séculaire exacerbé par la confrontation des égoïsmes qui caractérisent la plupart des communautés humaines : « La politique, nous dit André Comte-Sponville, n’est pas le contraire de l’égoïsme (ce qu’est la morale), mais son expression collective et conflictuelle : il s’agit d’être égoïstes ensemble, puisque tel est notre lot, et le plus efficacement possible. Comment ? En organisant des convergences d’intérêt, et c’est ce qu’on appelle la solidarité (...) Présentations de la philosophie, p. 34. » Contrairement à ce que pensait Platon, la justice, l’équité, ne s’inscrivent pas dans le cadre de lois naturelles. Celles-ci privilégient un état de nature dont la férocité du plus fort installe la prédominance de celui-ci au détriment du plus faible. Non ! La nature n’est pas idyllique ! Loin de là !
9- En se distinguant très nettement de « l’utopisme » platonicien alimenté par ses Idées, rappelons-le, les conceptions politiques d’Aristote reposent, avant tout, sur l’analyse de la structure sociologique des États existant à son époque et non sur son éventuel progrès. Loin d’être un réformateur, Aristote fut un observateur désireux de comprendre les mécanismes politiques et sociologiques susceptibles d’expliquer la réalité de son temps. On peut supposer aussi que ses relations avec les souverains macédoniens (Philippe II et Alexandre le Grand) ont quelque peu influées sur sa pensée en dédramatisant, notamment, la perte de souveraineté infligée à Athènes au lendemain de la bataille de Chéronée (-338). Alors, si la politique est bien la « science première ou, absolument souveraine » (Les politiques, p. 259), elle ne semble pas, chez Aristote, être destinée à un avenir prometteur. Certes ! Elle s’inscrit bien dans un processus historique mais ne paraît pas, à ses yeux, pouvoir générer indéfiniment des modèles constitutionnels susceptibles d’améliorer sensiblement le bien commun. Toutefois, et en dépit des conceptions différentes de la politique entre Platon et Aristote, on peut noter de nombreux points de convergence entre les deux philosophes. A titre d’exemple, comparons leur conception de l’oligarchie (de Olig ou : peu nombreux et Archie ou commandement). Pour Platon, « De tels hommes seront avides de richesses, comme les citoyens des États oligarchiques (...) La République VIII, 548 a. » Enchaînons avec Aristote : « Mais quand les citoyens, étant devenus pires, se mirent à spéculer au détriment de la chose publique, c’est vraisemblablement de là que vint l’oligarchie car c’est la richesse qu’on mit à l’honneur. Les Politiques, p. 278. » Concernant la description du tyran, nous retrouvons le même type de convergence. C’est ainsi que Platon (République, 567 b) nous dit : « Il faut donc que le tyran s’en défasse (des gens trop libres, à ces yeux), s’il veut rester le maître, et qu’il en vienne à ne laisser, parmi ses amis comme parmi ses ennemis, aucun homme de quelque valeur. » De son coté, Aristote (Les Politiques, p. 409) complète cet avis : « Les recettes formulées jadis pour assurer, autant que possible, la sauvegarde de la tyrannie sont les suivantes : retrancher du corps social les gens supérieurs, c’est à dire supprimer les grands esprits ; ne permettre ni repas en commun, ni association, ni éducation ; ni autre chose du même genre, mais au contraire se méfier de tout ce qui, d’habitude, donne naissance à ces deux sentiments : grandeur d’âme et confiance (...) » Par ailleurs, et toujours selon ces deux philosophes, la tyrannie a des conséquences encore plus désastreuses pour la paix entre les hommes. Écoutons Platon : « Mais quand il (le tyran), s’est débarrassé de ses ennemis du dehors en traitant avec les uns, en ruinant les autres, et qu’il est tranquille de ce coté, il commence toujours par susciter des guerres, pour que le peuple ait besoin d’un chef. La République, 567 a. » Une fois encore, Aristote ne dément pas : « Le tyran est aussi un fauteur de guerre, de manière à ce que ses sujets n’aient aucun loisir et en viennent à avoir besoin d’un guide. Les Politiques, p. 410. »
10- Pour Platon, comme pour Aristote, le paradoxe d’un régime tyrannique résulte de son origine. Car, et bien que la plupart du temps il soit instauré par la force, il repose néanmoins sur l’assentiment du peuple (Rappelons, et à titre d’exemple, qu’Hitler obtînt les pleins pouvoir à la suite d’un référendum qui fut un véritable plébiscite en sa faveur : 38 362 000 oui contre 4 295 000 non...) Quelque part, on peut dire que la tyrannie est le bras armé de la démagogie. Ce type de pouvoir s’abreuve de la crédulité humaine exacerbée par le charisme politique des démagogues : « Dans les temps anciens, nous dit Aristote, quand un même individu devenait démagogue et stratège, la démocratie se changeait en tyrannie. Les Politiques, p. 371. » Vingt-quatre siècles plus tard, l’histoire nous a montré que cet avis était toujours fondé. En effet, que furent Mussolini ou Hitler sinon des démagogues suffisamment talentueux pour entraîner leurs peuples (et une grande partie de l’humanité) aux creux d’abîmes dans lesquels périrent tant d’êtres humains ? Ce simple rappel historique nous montre que la paix (donc, une forme de bonheur, selon les anciens, comme pour nous, d’ailleurs), ne sera jamais acquise tant que les hommes seront dupes d’eux-mêmes car le manque de lucidité est un crime, non seulement vis à vis de soi, mais également vis à vis des autres. La philosophie s’efforce d’éclairer les hommes sur ce qu’ils sont (Qu’est-ce que l’homme ? Se demande Kant) mais, et bien souvent, elle cède à la froideur de ses propres raisonnements : « C’est pourquoi le philosophe est au plus haut point l’homme insaisissable, nous dit Jean-François Revel (Histoire de la philosophie Occidentale, p. 455) : lui résistez-vous au nom de vos sentiments, il vous présente avec froideur la facture des raisons démonstratives, démolissez-vous ses raisonnements, il fait du chantage aux sentiments et vous somme de dire de quel coté de la barrière vous vous trouvez. » Pour le philosophe, le bon coté de la barrière est celui occupé par la raison : « Ce qui est propre à l’homme, nous dit Aristote, c’est donc la vie de l’esprit, puisque l’esprit constitue essentiellement l’homme. » Et, lorsque le philosophe s’aventure vers ce que nous appelons l’affectivité, c’est pour mieux la rejeter dans les limbes incertains d’un monde dans lequel prédominent nos passions. De concert avec beaucoup de mes contemporains, je me demande souvent si ce que nous nommons le bonheur est une réalité ou un mythe (voir mon article sur l’ataraxie.) Relève-t-il davantage de l’inné ou de l’acquis ? Ou n’est-il qu’une sorte de rêve, (ou de chance, peut-être), auquel nous nous accrochons tous afin de masquer la précarité inhérente à notre existence ? Par le truchement de ses grandes Écoles (les stoïciens et les épicuriens, notamment), la période hellénistique (III/I siècles av. J.C.) a réfléchi sur les conditions devant être réunies afin d’orienter l’homme vers le bonheur. Mais, finalement, y est-elle parvenue ?
11- A l’époque d’Aristote, comme à celle de Platon, la réflexion politique reposait sur deux notions, certes distinctes, mais néanmoins complémentaires : celle de Cité et celle d’éthique.
Note : Ici, et en raison de l’ambiguïté liée au terme éthique, je pense utile d’insérer un extrait concernant l’un de mes précédents articles : Qu’est la philosophie ? (Section XIV)
Fondatrice de la morale moderne, la deuxième question kantienne (Que dois-je faire ?) soulève un problème lexical : existe-t-il, ou non, une différence de sens entre morale et éthique ? Étymologiquement, « morale » est issu du latin moralis, traduit du grec ta èthica par Cicéron. Si nous en restons là, « les deux termes désignent ce qui a trait aux mœurs, au caractère, aux attitudes humaines en général et, en particulier, aux règles de conduite et à leur justification » Eric Weil, in Universalis. « Seulement, nous dit Paul Ricœur (Id.), je propose de distinguer entre éthique et morale, de réserver le terme d’éthique pour tout le questionnement qui précède l’introduction de l’idée de loi morale et de désigner par morale, tout ce qui, dans l’ordre du bien et du mal, se rapporte à des lois, des normes, des impératifs. » Ce dernier avis implique une diachronie (une évolution) entre éthique et morale durant laquelle la première préfigure la seconde. De fait, les diverses éthiques (aristotélicienne, stoïcienne, épicurienne etc.) n’ont aucunement relevé de l’impératif kantien qui repose sur une injonction : tu dois ! Si, pour nous modernes, il convient donc de distinguer éthique et morale ou Comment vivre ? et Que dois-je faire ? Remarquons aussi que l’éthique répond à la première question ; la morale, à la seconde.
De fait, et au-delà du questionnement spécifiquement politique, Platon et Aristote posent une question préjudicielle : Comment vivre ? Et, surtout, comment bien vivre ? Pour l’un, comme pour l’autre, la réponse à ces questions repose sur une notion essentielle de cette époque : celle de vertu car elle conditionne l’idée que l’on se fait de « l’homme de bien » : « (...) l’excellence d’un homme de bien, nous dit Aristote, est la même que celle d’un citoyen de la cité excellente (...) » Page 458, Aristote revient sur cette notion : « Pour l’instant prenons pour base qu’une vie excellente, aussi bien pour chaque individu pris à part que pour les cités prises collectivement, c’est celle qui s’accompagne d’une vertu pourvue d’assez de moyens pour qu’on puisse prendre part aux actes conformes à la vertu. » Il appert donc que la cité est à l’image des citoyens qui l’a composent. Par ailleurs, les spécificités culturelles des peuples expliquent la diversité des comportements socio-politiques, et des diverses constitutions, que l’on peut observer dans les communautés humaines. Dans la République (535 e), Platon n’a pas manqué de souligner cette caractéristique si commune et, parfois, si déroutante : « N’y a-t-il pas grande nécessité de convenir qu’en chacun de nous se trouvent les mêmes formes et les mêmes caractères que dans la cité ? (...) Il serait, en effet, ridicule de penser que le caractère irascible de certaines cités n’a pas son origine dans les particuliers qui ont la réputation de le posséder, comme les Thraces, les Scythes et presque tous les peuples du Nord ou qu’il n’en est pas de même pour l’amour du savoir, que l’on pourrait principalement attribuer aux habitants de notre pays (...) »
12- Sur un plan purement politique, Aristote a remarqué que les cités puissantes imposaient aux cités soumises une sorte de prosélytisme idéologique : « De plus, ceux qui ont exercé l’hégémonie sur la Grèce, ayant chacun en vue la constitution qui était en vigueur chez eux, établissaient dans les cités assujetties les uns des démocraties (Athènes, par exemple), les autres des oligarchies (Sparte, entre autres), ne considérant pas l’avantage de ces cités mais le leur propre. » Notons que cette remarque nous renvoie à un problème tout à fait contemporain : faut-il, ou non, intervenir dans certains États au nom des droits de l’homme ? En d’autres termes, les démocraties occidentales sont-elles habilitées à imposer un modèle politique, conforme aux leurs ? Et cela, indépendamment des traditions ancestrales qui peuvent expliquer, dans certains endroits de la planète, l’existence d’une dictature ? (La guerre menée en Libye contre Kadhafi est un excellent exemple de cette problématique.) De fait, le débat entre interventionnistes et partisans d’une neutralité politique est loin d’être apaisé. Pour ma part, je rappellerais simplement aux non-interventionnistes que, sans l’entrée en guerre des États Unis d’Amérique lors du deuxième conflit mondial, il n’est pas du tout certain que l’Europe aurait eu des moyens militaires et humains suffisants pour se débarrasser (à jamais, espérons-le) du nazisme. Et, pour retourner en Libye, que serait-il advenu des habitants de Bengazi sans l’intervention des Occidentaux ? Ces deux seuls exemples montrent combien cette question est difficile. La facilité consisterait à ne pas prendre parti en se réfugiant dans une suspension du jugement, si chère aux sceptiques. Seulement, procéder ainsi, ne reviendrait-il pas à éluder le problème à la manière de Ponce Pilate ?
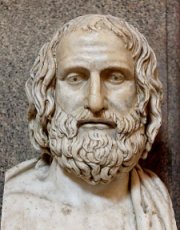
Protagoras
13- Reprenant quelque part la célèbre formule du sophiste Protagoras : « L’homme est la mesure de toutes choses », Aristote nous dit que : « La vertu et l’homme vertueux sont la mesure de toutes choses. » Cette vertu, pour le stagirite, est l’excellence même qui fonde le citoyen et la cité car, pense-t-il : « Il est manifeste que la cité qui mérite vraiment ce nom, et non celle qui est ainsi nommée par abus de langage, doit s’occuper de vertu (...) Les Politiques, p. 248. » Il semblerait donc que la vertu politique prolonge la vertu éthique. Seulement, Aristote considère le bonheur (donc le but ultime de l’éthique de cette époque) comme fin de la politique : « Il est clair, nous dit-il, que comme toutes les communautés visent un certain bien, c’est le bien le plus éminent entre tous qui vise au plus haut point celle qui est la plus éminente de toutes et qui contient toutes les autres. Or c’est celle que l’on appelle la cité, c’est à dire la communauté politique. Les Politiques, p. 103. » Dans ce même ouvrage (page 239) Aristote revient sur cette idée : « Néanmoins, l’avantage commun lui aussi les réunit (les hommes) dans la mesure où cette union procure à chacun d’eux une part de vie heureuse. Tel est assurément le but qu’ils ont avant tout, ensemble comme séparément. » L’articulation entre éthique politique et, donc cité, ne peut être davantage revendiquée. L’éthique est le but, la politique, le moyen et la cité, le cadre.
14- Etre vertueux consiste, pour un être, à réaliser pleinement ce qu’il est ce qui le conduit, en tant « qu’animal politique, donc, social » a accéder à sa pleine réalisation à l’intérieur de la cité. De tout cela il découle que la vertu de la cité est à l’image de celle du citoyen (Nous retrouvons, ici, Platon.) Ceci étant, l’homme est loin d’être naturellement vertueux et donc tout aussi loin d’être un bon citoyen. En France, et aujourd’hui même, cette question est au centre d’un débat politique agité qui porte sur cette question éminemment éthique. Et cela, à un point tel, que les hommes politiques ayant eu récemment accès au pouvoir envisagent de légiférer en cette matière. La campagne électorale que nous venons de vivre (qui s’est achevée par l’élection d’Emmanuel Macron à la présidence de la République) a réactualisé d’une manière extrêmement claire la problématique politique/éthique qui occupa la pensée de Platon et celle d’Aristote. En effet, et durant cette campagne, la question posée fut celle-ci : qu’elles doivent être les vertus éthiques (ou morales, selon le vocabulaire actuel) de ceux qui nous gouvernent ? Beaucoup plus complexe, une nouvelle question a surgi : qu’elle est la relation entre l’éthique et la loi ? En d’autres termes : respecter les lois et, par conséquent, ne pas les transgresser, suffit-il pour pouvoir se prétendre être un bon gouvernant ? « Rien n’est plus dangereux que l’influence des intérêts privés dans les affaires publiques, nous dit Rousseau (Du contrat social, p. 137), et l’abus des lois par le gouvernement est un mal moindre que la corruption du législateur, suite infaillible des vues particulières. » Nos gouvernants passés et présents feraient bien de lire et de relire ce texte...
 15- Jusqu’à présent, il semblait que le respect relatif des lois était suffisant. Aussi avait-on pour habitude de fermer les yeux sur certains usages délictueux, notamment en matière financière, dès lors que les impératifs de notre État de droit n’étaient trop visiblement violés. Or, il semble bien que cette sorte de consensus ait volé en éclats sans doute à cause des inégalités sociales qui vont croissantes dans notre pays comme dans bien d’autres, d’ailleurs. Le problème soulevé ici concerne le rôle et l’efficacité réelle de la loi. Avant d’aller plus loin, précisons que la loi est un outil social, donc, politique, qui définit ce qui est autorisé, permis ou ce qui est interdit au sein d’une communauté humaine. Dans un État de droit, c’est le législateur (élu par le peuple dans une démocratie) qui est chargé de l’instaurer en tenant compte, bien évidemment, des évolutions sociologiques d’où, d’ailleurs, ses continuelles adaptations. « Nul n’étant sensé l’ignorer » (ce qui n’implique pas, d’ailleurs, qu’elle soit systématiquement respectée), la loi a prévu des conditions juridiques (son versant répressif) afin d’assurer sa propre sauvegarde. Ceci étant, la loi peut-elle agir en matière d’éthique ? Pour le moins, et à la suite de Platon, Aristote en doute : « Alors la loi est pure convention, et, comme l’a dit le sophiste Lycophron, elle est un garant de la justice dans les rapports mutuels, mais elle n’est pas capable de rendre les citoyens bons et justes. Les politiques, p. 248. » Dans le même ouvrage (page 257), Aristote revient sur ce sujet : « (...) Il faut que ce soit les lois qui soient souveraines si elles sont correctement établies, et que le magistrat (le gouvernant), qu’il y en ait un ou plusieurs, soit souverain sur les seuls sujets où les lois sont absolument incapables de se prononcer avec précision du fait qu’il n’est pas facile de définir une règle universelle sur tous les cas. » Ici, et une fois encore, on ne peut s’empêcher de songer à Platon : « C’est que la loi ne pourra jamais embrasser exactement ce qui est le meilleur et le plus juste pour tout le monde à la fois, pour y conformer ses prescriptions : car les différences qui sont entre les individus et entre les actions et le fait qu’aucune chose humaine, pour ainsi dire, ne reste jamais en repos interdisent à toute science, qu’elle qu’elle soit, de promulguer en aucune matière une règle simple qui s’applique à tous et à tous les temps. Le politique, 294a. » Il ressort de tout ceci que, si la loi détermine le cadre juridique d’une communauté humaine, elle ne parvient pas à garantir ce qu’Aristote nomme : l’équité. (Qualité qui consiste à attribuer à chacun ce à quoi il a droit naturellement.) En soumettant le peuple à ses énoncés, les lois sont donc homogénéisantes : elles s’adressent au général (l’ensemble des gens) et non au particulier (l’individu en soi.) « Ce qui cause notre embarras, nous dit Aristote, c’est que ce qui est équitable, tout en étant juste, ne l’est pas conformément à la loi (...) La raison en est que toute loi est générale et que, sur des cas d’espèce, il n’est pas possible de s’exprimer avec suffisamment de précision quand on parle en général ; lors donc qu’il est indispensable de parler en général et qu’on ne peut le faire avec toute la précision souhaitable, la loi ne retient que les cas ordinaires, sans méconnaître d’ailleurs son insuffisance (...) Lorsque la loi s’exprime pour la généralité des cas, et que postérieurement il se produit quelque chose qui contrarie ces dispositions générales, il est normal de combler la lacune laissée par le législateur et de corriger l’omission imputable au fait même qu’il s’exprimait en général. Éthique de Nicomaque, p. 146, 147. » Dans le même texte, Aristote tire les conséquences de ce qu’il vient d’affirmer : « Aussi ce qui est équitable est-il juste, supérieur même en général au juste, non pas au juste en soi, mais au juste qui, en raison de sa généralité, comporte de l’erreur. La nature propre de l’équité consiste à corriger la loi, dans la mesure où celle-ci se montre insuffisante en raison de son caractère général. Voilà pourquoi tout n’est pas compris dans la loi (...) » Aristote a bien compris, qu’à l’inverse des impératifs « moraux » que nous adresse le décalogue (ou les « dix commandements), et que, loin d’être gravée dans le marbre, la loi est soumise aux changements qui caractérisent les sociétés humaines. Toujours, elle s’adapte aux évolutions sociales à un point tel que certaines conduites, interdites aujourd’hui, sont susceptibles d’être légales demain. La loi n’est donc pas un fait mais un processus qui accompagne l’évolution d’une société. Cette remarque est d’autant plus importante qu’elle explique l’accumulation, parfois déraisonnable, des lois qui régissent notre quotidien. Émanations des hommes, elles en épousent le destin...
15- Jusqu’à présent, il semblait que le respect relatif des lois était suffisant. Aussi avait-on pour habitude de fermer les yeux sur certains usages délictueux, notamment en matière financière, dès lors que les impératifs de notre État de droit n’étaient trop visiblement violés. Or, il semble bien que cette sorte de consensus ait volé en éclats sans doute à cause des inégalités sociales qui vont croissantes dans notre pays comme dans bien d’autres, d’ailleurs. Le problème soulevé ici concerne le rôle et l’efficacité réelle de la loi. Avant d’aller plus loin, précisons que la loi est un outil social, donc, politique, qui définit ce qui est autorisé, permis ou ce qui est interdit au sein d’une communauté humaine. Dans un État de droit, c’est le législateur (élu par le peuple dans une démocratie) qui est chargé de l’instaurer en tenant compte, bien évidemment, des évolutions sociologiques d’où, d’ailleurs, ses continuelles adaptations. « Nul n’étant sensé l’ignorer » (ce qui n’implique pas, d’ailleurs, qu’elle soit systématiquement respectée), la loi a prévu des conditions juridiques (son versant répressif) afin d’assurer sa propre sauvegarde. Ceci étant, la loi peut-elle agir en matière d’éthique ? Pour le moins, et à la suite de Platon, Aristote en doute : « Alors la loi est pure convention, et, comme l’a dit le sophiste Lycophron, elle est un garant de la justice dans les rapports mutuels, mais elle n’est pas capable de rendre les citoyens bons et justes. Les politiques, p. 248. » Dans le même ouvrage (page 257), Aristote revient sur ce sujet : « (...) Il faut que ce soit les lois qui soient souveraines si elles sont correctement établies, et que le magistrat (le gouvernant), qu’il y en ait un ou plusieurs, soit souverain sur les seuls sujets où les lois sont absolument incapables de se prononcer avec précision du fait qu’il n’est pas facile de définir une règle universelle sur tous les cas. » Ici, et une fois encore, on ne peut s’empêcher de songer à Platon : « C’est que la loi ne pourra jamais embrasser exactement ce qui est le meilleur et le plus juste pour tout le monde à la fois, pour y conformer ses prescriptions : car les différences qui sont entre les individus et entre les actions et le fait qu’aucune chose humaine, pour ainsi dire, ne reste jamais en repos interdisent à toute science, qu’elle qu’elle soit, de promulguer en aucune matière une règle simple qui s’applique à tous et à tous les temps. Le politique, 294a. » Il ressort de tout ceci que, si la loi détermine le cadre juridique d’une communauté humaine, elle ne parvient pas à garantir ce qu’Aristote nomme : l’équité. (Qualité qui consiste à attribuer à chacun ce à quoi il a droit naturellement.) En soumettant le peuple à ses énoncés, les lois sont donc homogénéisantes : elles s’adressent au général (l’ensemble des gens) et non au particulier (l’individu en soi.) « Ce qui cause notre embarras, nous dit Aristote, c’est que ce qui est équitable, tout en étant juste, ne l’est pas conformément à la loi (...) La raison en est que toute loi est générale et que, sur des cas d’espèce, il n’est pas possible de s’exprimer avec suffisamment de précision quand on parle en général ; lors donc qu’il est indispensable de parler en général et qu’on ne peut le faire avec toute la précision souhaitable, la loi ne retient que les cas ordinaires, sans méconnaître d’ailleurs son insuffisance (...) Lorsque la loi s’exprime pour la généralité des cas, et que postérieurement il se produit quelque chose qui contrarie ces dispositions générales, il est normal de combler la lacune laissée par le législateur et de corriger l’omission imputable au fait même qu’il s’exprimait en général. Éthique de Nicomaque, p. 146, 147. » Dans le même texte, Aristote tire les conséquences de ce qu’il vient d’affirmer : « Aussi ce qui est équitable est-il juste, supérieur même en général au juste, non pas au juste en soi, mais au juste qui, en raison de sa généralité, comporte de l’erreur. La nature propre de l’équité consiste à corriger la loi, dans la mesure où celle-ci se montre insuffisante en raison de son caractère général. Voilà pourquoi tout n’est pas compris dans la loi (...) » Aristote a bien compris, qu’à l’inverse des impératifs « moraux » que nous adresse le décalogue (ou les « dix commandements), et que, loin d’être gravée dans le marbre, la loi est soumise aux changements qui caractérisent les sociétés humaines. Toujours, elle s’adapte aux évolutions sociales à un point tel que certaines conduites, interdites aujourd’hui, sont susceptibles d’être légales demain. La loi n’est donc pas un fait mais un processus qui accompagne l’évolution d’une société. Cette remarque est d’autant plus importante qu’elle explique l’accumulation, parfois déraisonnable, des lois qui régissent notre quotidien. Émanations des hommes, elles en épousent le destin...
16- Pour Aristote, comme pour la pensée de cette époque, d’ailleurs, la constitution est étroitement liée à la notion de régime politique. (Le terme « constitution » désigne l’ensemble des principes fondamentaux adoptés par un pays correspondant à son régime politique et servant de charte de référence à l’ensemble de sa législation. Il découle de ceci que la constitution est la garante de l’État de droit (lorsqu’il existe) et des lois qu’il génère.) Dans un premier temps, cette approche éminemment politique de l’organisation sociale conduit à établir une typologie destinée à comptabiliser les formes constitutionnelles existantes (tâche à laquelle Platon et Aristote ont consacré beaucoup de temps.) Reste ensuite à déterminer qu’elle est la meilleure constitution. Ou, si l’on préfère, qu’elle est celle qui garantit le plus idéalement possible le bien commun. Nous retrouvons ici la réflexion platonicienne, suivie de celle d’Aristote, sur les constitutions liées aux principaux régimes politiques existant à leur époque : monarchie, aristocratie, oligarchie, démocratie et tyrannie. Si la constitution vassalise les lois en veillant à ce qu’elles soient correctement respectées, elle s’assure aussi qu’elles soient dûment rédigées. Pour ce faire, elle dispose d’un outil de contrôle : Par exemple, en France, le Conseil d’État ou la Cour Suprême aux États Unis d’Amérique. Ces organismes sont chargés de veiller à la bonne entente entre les lois et l’esprit de la constitution. Bref, elles assurent l’harmonie et la cohérence juridiques de l’État.
17- Incontestablement, il existe une tension entre la constitution et la démocratie. Cette dernière étant entendue dans son sens le plus large : la totale souveraineté du peuple. En effet, et dès lors que les sociétés démocratiques sont régies à la fois par des règles juridiques et sous le regard parfois soupçonneux de la constitution, la souveraineté populaire issue de la démocratie se retrouve singulièrement limitée. Il s’agit là d’un des reproches implicites adressés récemment par les « nuits debout » à notre système politique (Se reporter à mon article : Approche générale.) Dans les Politiques (p. 306), et après avoir évoqué plusieurs sortes de démocraties, Aristote se penche sur ce problème en n’omettant pas de déplorer certaines conséquences qui lui sont liées : « Une autre espèce de démocratie, c’est celle où toutes les autres caractéristiques de l’espèce précédente sont les mêmes, mais où c’est la masse qui est souveraine et non la loi. C’est le cas quand ce sont les décrets qui sont souverains et non la loi. Cela arrive par le fait des démagogues (A cette époque, ce terme désigne le chef d’un parti populaire.) Car dans les cités gouvernées démocratiquement selon la loi, il ne naît pas de démagogues (...) Là où les lois ne dominent pas, alors apparaissent les démagogues. » Finalement, en distinguant très nettement le décret de la loi, Aristote redonne à cette dernière ses lettres de noblesse. En effet, et comme toute organisation humaine, la démocratie a besoin d’une base juridique suffisamment puissante et assurée afin de se prémunir contre les velléités déraisonnables des hommes légitimement épris de liberté. Or, et lorsque les institutions manifestent quelques faiblesses, les citoyens sont tentés de s’en remettre à des démagogues suffisamment talentueux pour prétendre les représenter : « Ces démagogues, nous dit Aristote (Les politiques, p. 307), sont cause que les décrets sont souverains et non les lois, en portant tout devant le peuple. Il en résulte, en effet, qu’ils deviennent importants du fait que le peuple est souverain en tout, et qu’eux sont souverains de l’opinion du peuple. Car la multitude se laisse convaincre par eux (...) Car partout où les lois ne gouvernent pas, il n’y a pas de constitution. Car il faut que la loi commande en toute chose (...) De sorte que, si la démocratie est bien l’une des constitutions, il est manifeste qu’une telle organisation dans laquelle tout se règle par des décrets n’est pas une démocratie à proprement parler, car aucun décret ne peut être universel. »
 Note : Un décret est une décision émanant du pouvoir gouvernemental dont les effets sont identiques à ceux d’une loi. Juridiquement légitimés par une loi d’habilitation votée par le parlement, les décrets permettent d’outrepasser le pouvoir législatif en dispensant le gouvernement de se soumettre aux débats parlementaires. Il s’agit, en fait, d’une sorte de coup d’État réglementaire bien que le recours aux décrets soit conforme à la constitution (Il en va de même pour l’article 49.3 tellement décrié récemment.)
Note : Un décret est une décision émanant du pouvoir gouvernemental dont les effets sont identiques à ceux d’une loi. Juridiquement légitimés par une loi d’habilitation votée par le parlement, les décrets permettent d’outrepasser le pouvoir législatif en dispensant le gouvernement de se soumettre aux débats parlementaires. Il s’agit, en fait, d’une sorte de coup d’État réglementaire bien que le recours aux décrets soit conforme à la constitution (Il en va de même pour l’article 49.3 tellement décrié récemment.)
Émanations des usages politiques de l’ancien régime, les ordonnances permettaient aux rois d’édicter des règles juridiques. Tombés en désuétude sous les régimes non monarchiques, les ordonnances réapparurent le 27 octobre 1940 lorsque le général de Gaule prit une ordonnance, au nom du peuple français, afin d’organiser les pouvoirs publics durant la guerre. Toutefois, il faudra attendre le retour au pouvoir du général de Gaule pour que la constitution du 4 octobre 1958 intègre en son sein trois types différents d’ordonnances. En premier lieu, l’article 92 confie l’exercice du pouvoir législatif durant la période de la mise en place des nouvelles institutions. De son coté, l’article 47 permet au gouvernement de promulguer par voie d’ordonnance le projet de budget lorsque le parlement ne l’a pas voté dans un délai de 70 jours. Enfin, l’article 38, sous réserve d’une loi d’habilitation (loi votée par le parlement qui autorise le gouvernement à recourir aux ordonnances), permet à ce gouvernement d’agir dans le domaine législatif. Pour note, le président Macron envisage de recourir à cet article prochainement.) Pour finir, on peut remarquer que les décrets, les ordonnances ou le 49.3 déterminent la prédominance de l’exécutif sur le législatif et que ce constat ne manque pas de poser une question cruciale : quelle est la nature réelle de notre démocratie ?
18- J’espère avoir montré clairement (Cf. Mon article : La naissance de la démocratie à Athènes) que la démocratie ne fut pas une organisation politique créée ex nihilo. Elle s’inscrivit dans un processus politique amorcé par de grands législateurs dont l’un des plus brillants fut Solon (~640/~558 Av. J.C.) : « Quant à Solon, nous dit Aristote, certains sont d’avis qu’il fut un législateur excellent, qui en finit avec une oligarchie par trop excessive, mit fin à la servitude du peuple et établit une démocratie, celle du temps de nos pères, en mélangeant harmonieusement plusieurs éléments dans la constitution. Les Politiques, p. 214. » Seulement, la démocratie se heurta, dès ses débuts, à de grandes difficultés dues aux séculaires rivalités entre les conservateurs (les riches) et les démocrates (les défenseurs du peuple.) En fait, la grande question soulevée par la démocratie concerne le pouvoir : quelle est sa nature et, surtout, qui est digne de l’exercer ? Parangon de l’excellence, le système politique platonicien repose sur un ensemble de valeurs issues de la raison et donc, du moins idéalement, à l’abri des passions. Aux yeux de Platon, seuls les philosophes sont détenteurs de telles vertus : « Tant que les philosophes ne seront pas rois dans les cités, nous dit-il, ou que ceux qu’on appelle aujourd’hui rois et souverains ne seront pas vraiment et sérieusement philosophes ; tant que la puissance politique et la philosophie ne se rencontreront pas dans le même sujet (...) il n’y aura de cesse, mon cher Glaucon, aux maux des cités, ni, ce me semble, à ceux du gente humain, et jamais la cité que nous avons décrite tantôt ne sera réalisée, autant qu’elle peut l’être, et ne verra la lumière du jours. La République, 474a. » Antienne, s’il en est, Platon revient très vite sur le sujet (501d) : « S’effaroucheront-ils donc encore de nous entendre dire qu’il n’y aura de cesse aux maux de la cité et des citoyens que lorsque les philosophes détiendront le pouvoir, et que le gouvernement que nous avons imaginé sera réalisé en fait ? »
19- Pour Platon, il semble donc que la valeur du pouvoir, issu de la démocratie, ou non, soit directement liée à celle du souverain qui exerce ce pouvoir. Il faut donc, nous dit l’illustre élève de Socrate, que le souverain soit doté des mêmes vertus que le philosophe car ce dernier est le seul qui, sorti de la caverne, s’est rapproché des Idées génératrices du bien commun comme, par exemple, celle de justice. Contrairement au sophiste Protagoras, pour lequel l’homme est la mesure de toute chose, Platon affirme que la vérité ne peut dépendre des jugements particuliers : « Puisque la raison et la déraison existent, nous dit-il, il est absolument impossible que Protagoras ait dit vrai. Car un homme ne serait jamais réellement plus sage qu’un autre, si la vérité n’était pour chacun que ce qui lui semble. Cratyle, 386d. » Indéniablement, la critique est fondée. Toutefois, l’homme étant ce qu’il est c’est à dire : un être libre en raison et en conscience (et très souvent à la merci de ses passions), il ne peut exister d’universalité, ni d’idées ni de comportements, entre les hommes. Ceci explique, d’ailleurs, que les sociétés humaines aient besoin de lois afin de réfréner les égoïsmes et, très souvent, les velléités d’hégémonie, qu’elles soient d’ordre économique, ou autre, liées à la condition humaine.
20- Si, et notamment dans le domaine politique, on souhaite comprendre l’une des divergences majeures entre le platonisme et l’aristotélisme, il convient de distinguer les dualismes fondateurs des univers revendiqués par ces deux philosophies. Précédemment, nous nous sommes penchés sur le système platonicien qui comporte deux mondes à la fois antagonistes et complémentaires : le monde intelligible (celui des Idées) et le monde sensible (celui des objets concrets.) Toutefois, et abstraction faite des critiques formulées à l’égard de la bipolarité du monde platonicien, Aristote a également imaginé un univers dualiste : le monde supralunaire et le monde sublunaire. Émanation, Oh combien récurrente ! de la transcendance, le monde supralunaire est hors de portée des objets perceptibles par les sens. Dans ce monde-ci, il n’existe ni génération, ni corruption. S’il est habité par des êtres animés, ceux-ci n’ont ni commencement, ni fin. Ils relèvent donc, tous, de l’éternité. Remarquons, cependant, que cette conception, qui concerne à la fois la cosmologie et la théologie, est au service d’une revendication d’Aristote : expliquer le mouvement. Ici, nous sommes au cœur de l’une des préoccupations essentielles de l’homme : la causalité. Exigeant que chaque effet ait une cause précise, ce principe directeur de la raison humaine stipule que : « Tout fait a une cause, et les mêmes causes dans les mêmes conditions produisent les mêmes effets. » Guide éminent de la science, ce concept a pour inconvénient de s’embourber dans ce que les sceptiques nommaient : la régression à l’infini. En effet, nous dit Sextus Empiricus (Esquisses pyrrhoniennes, p. 141) : « Celui qui s’appuie sur la régression à l’infini est celui dans lequel nous disons que ce qui est fourni en vue d’emporter la conviction sur la chose proposée à l’examen a besoin d’une autre garantie, et celle-ci d’une autre, et cela à l’infini (...) » En termes plus simples (bien que.. !), si un effet a besoin d’une cause, cette même cause a également besoin d’une nouvelle cause qui la relèguerait, dès lors, au statut d’effet et cela, indéfiniment. Si l’on se réfère à sa célèbre formule : « Il faut s’arrêter », Aristote a évité de s’échouer contre ce redoutable écueil. Aussi, pensa-t-il, si tout ce qui est mû est mû par autre chose, elle-même, mue, il faut qu’il y ait un premier moteur qui, lui, ne soit pas mû. De la sorte, il est impossible qu’une série de moteurs existe. Dès lors, et du moins logiquement (mais nous évoquons Aristote...), il ne peut exister qu’un premier moteur générateur d’un mouvement dépourvu de commencement et dont le temps n’est que la mesure. Achevons cette courte parenthèse en remarquant que la philosophie d’Aristote est tout à fait étrangère à l’idée de création.
21- Parallèlement à ce monde, coexiste un autre monde qualifié par Aristote de : « sublunaire. » Très proche du « monde sensible » de Platon, ce monde est le siège de la génération et de la corruption. Ici, rien n’est parfait ni éternel : les êtres naissent et meurent en vertu des changements qui les animent. En bref, il s’agit tout simplement du monde dans lequel nous vivons. Toutefois, et à l’encontre du monde sensible de Platon, ce monde sublunaire n’est pas vassalisé. Conséquemment, il est totalement distinct du monde supralunaire et peut donc être l’objet d’une connaissance spécifique qui est dispensée de tout recours à une quelconque transcendance. La notion de justice, par exemple, n’a pas de référent sur lequel il serait possible de s’appuyer. Pour Aristote, et contrairement à Platon, il n’existe pas de justice « en soi » mais seulement une justice pensée par les hommes et pour les hommes.
22- Ceci étant, l’incontestable pragmatisme d’Aristote n’exclut aucunement une perspective téléologique (idée de finalité) en matière politique. En effet, et tout à fait en accord avec les deux grandes écoles futures (les stoïciens et les épicuriens), la pensée politique d’Aristote est indissociable d’une finalité éthique (qu’il ne faut surtout pas confondre avec la morale au sens moderne de ce terme.) Le but ultime de la politique c’est le « souverain bien » ou, si l’on préfère, le bonheur de l’être humain. Ou, encore, les conditions devant être réunies afin de vivre harmonieusement en espérant ne pas compromettre ce que Montaigne appelait : notre humaine condition. La voie étant ainsi tracée, restaient à définir les conditions devant être réunies afin de la parcourir. Pour ce faire, Aristote n’imagine pas la cité utopique de Platon mais se contente, pourrait-on dire, du réel. « Il faut, nous dit-il (Les Politiques, p. 291), introduire une organisation constitutionnelle telle que, à partir de ce qui existe, les gens soient à la fois facilement persuadés et en état de la mettre en oeuvre, parce que ce n’est pas une moindre affaire de redresser une constitution que d’en établir une de toutes pièces (...) C’est pourquoi, outre les capacités que l’on a mentionnées, l’homme politique doit avoir celle d’apporter son aide aux constitutions existantes (...) »
Note : Cette dernière citation éclaire singulièrement la problématique politique que notre pays traverse en ce moment. En effet, la dégradation de notre république est telle que seul un séisme constitutionnel peut y remédier. Deux leaders importants de notre environnement politique l’ont très bien compris. D’un coté, en s’appuyant sur une constituante, (c’est le 9 juillet 1789 que les états généraux se proclamèrent assemblée constituante afin de doter la France de nouvelles institutions), Jean Luc Mélenchon préconise l’instauration d’une sixième république. Du sien, Emmanuel Macron penche davantage pour le maintien de la cinquième république à la condition, cependant, de revenir à ses fondamentaux institués en 1958 et de l’amender en fonction des impératifs d’aujourd’hui. En termes aristotéliciens, Jean Luc Mélenchon opte pour l’établissement « de toutes pièces » d’une nouvelle constitution alors qu’Emmanuel Macron propose « d’apporter son aide à la constitution existante. »
23- De toute évidence, la constitution, avec ses qualités et ses défauts, est au centre de la réflexion politique d’Aristote. Et cela, à un point tel qu’il n’hésite pas à nous dire que : « Partout, en effet, ce qui est souverain, c’est le gouvernement de la cité, mais la constitution, c’est le gouvernement. (Les Politiques, p. 238. » Pour nous, modernes, cette inter-dépendance entre constitution et gouvernement peut paraître étrange dans la mesure ou nos gouvernements changent souvent alors que notre constitution (fondatrice, pour ce qui nous concerne, de la cinquième république) ne varie que très peu. Toutefois, si nous nous référons au contexte sociopolitique de l’époque, cela n’a rien de surprenant car la souveraineté de la cité était étroitement liée au pouvoir. C’est pourquoi, et en plein accord avec son temps, Aristote précise que : « Dans les cités démocratiques, c’est le peuple qui est souverain, alors que c’est le petit nombre dans les cités oligarchiques. Et nous disons que la constitution est, elle aussi, différente dans les deux cas, et nous établissons la même relation dans les autres cas. (dans une monarchie, par exemple.) Ibid., p. 238. » Pour la pensée antique, et, a fortiori, pour celle d’Aristote, la notion de constitution et de régime sont donc indissociables. Conséquemment, il existe autant de constitutions que de régimes. Ceci explique l’importance de la place occupée par la typologie, tant chez Platon que chez Aristote : combien existe-t-il de formes constitutionnelles ? Toutefois, cette question en appelle une autre : parmi ces constitutions, quelle est la meilleure ou, du moins, la moins nocive pour le plus grand nombre ? Avec ses réserves et ambiguïtés habituelles, Platon évoque la démocratie en termes sibyllins : « Quant au gouvernement du petit nombre (l’oligarchie), de même que peu est un milieu entre un seul et la multitude, regardons-le de même comme un milieu entre les deux autres. Pour celui de la multitude (la démocratie), tout y est faible et il ne peut rien faire de grand, ni en bien, ni en mal, comparativement aux autres, parce que l’autorité y est répartie par petites parcelles entre beaucoup de mains. Aussi, de tous ces gouvernements, quand ils sont soumis aux lois, celui-ci est le pire, mais quand ils s’y dérobent, c’est le meilleur de tous ; s’ils sont tous déréglés, c’est en démocratie qu’il fait le meilleur vivre ; mais, s’ils sont bien ordonnés, c’est le pire pour y vivre (...) Le Politique, 303b. » Ainsi, vient de nous dire Platon, la démocratie est un excellent gouvernement à la condition, toutefois, qu’il soit désordonné ! Paradoxe ? Peut-être pas... En effet, la question que soulève Platon concerne la relation entre la démocratie et la liberté. Pour lui, la liberté appelle toujours plus de liberté jusqu’à ce que cette surenchère aboutisse : « à un excès de servitude, et dans l’individu et dans l’état (...) Vraisemblablement, la tyrannie n’est donc issue d’aucun autre gouvernement que la démocratie, une liberté extrême étant suivie d’une extrême et cruelle servitude. Ibid., 564a. » Finalement, Platon considère la démocratie comme l’antichambre de l’anarchie. Pour lui, en effet, et même s’il ne recourt pas à ce terme, l’homme et le « gouvernement » anarchiques se caractérisent par l’absence d’une direction politique forte et du refus d’obéissance des citoyens envers les lois promulguées : « Or, vois-tu le résultat de tous ces abus accumulés ? Conçois-tu bien qu’ils rendent l’âme des citoyens tellement ombrageuse qu’à la moindre apparence de contrainte ceux-ci s’indignent et se révoltent ? Et ils en viennent à la fin, tu le sais, à ne plus s’inquiéter des lois écrites ou non écrites, afin de n’avoir absolument aucun maître. Platon. La République, 564a. »
24- Délaissant quelque peu l’approche « comportementaliste » de Platon, Aristote se place dans une perspective plus politique : « Car il semble, nous dit-il, que deux choses définissent la démocratie : la souveraineté de la masse et la liberté. Il semble en effet aux démocrates que le juste c’est l’égal, et qu’est égal ce qui est jugé tel par la masse, que c’est cela qui est souverain et que la liberté c’est de faire ce qu’on veut. De sorte que dans de telles démocraties chacun vit comme il veut et va là où le mène son désir comme le dit Euripide. Et c’est cela qui est mauvais, car il ne faut pas croire que ce soit un esclavage de vivre selon la constitution, c’est au contraire le salut. Les Politiques, p. 396. » Portée par une indéniable lucidité politique, la principale vertu de ce fragment résulte de son universalité. Pour s’en convaincre, il suffit de se référer à un passage, beaucoup plus moderne, issu de La démocratie (Bruno Bernardi, p. 42) : « On peut donc donner cette définition de la démocratie : la démocratie est l’organisation de la communauté qui a pour effet que les individus, comme les gouvernants, conduisent leurs actions conformément aux principes de la droite raison. La puissance la plus grande que le pouvoir souverain peut acquérir est celle qui s’appuie sur la reconnaissance de son autorité par ceux sur qui elle s’exerce. Et tel est le fondement de la démocratie. » De fait, il ne peut exister de démocratie véritable sans un consensus préalable entre les gouvernants et les gouvernés. C’est la condition sine qua non pour que soient acceptées les limitations des libertés individuelles imposées par l’État dont l’action, cependant, est la seule force susceptible de les garantir. Il découle de tout ceci que la liberté, au sens politique, n’est en aucun cas la liberté absolue car, comme l’écrivit Rousseau : « Quand chacun fait ce qui lui plaît, on fait souvent ce qui déplaît à d’autres, et cela ne s’appelle pas un État libre. » Indépendamment de la légitimé démocratique de l’État, qui limite la liberté du citoyen, force est de reconnaître qu’il limite également celle des autres. De la sorte, ma liberté est garantie par la limite de la tienne ce qui nous permet, tous deux, de vivre dans une relative harmonie. Et, si toi ou moi, transgressons cette règle, la loi est là pour nous rappeler à l’ordre. Car, écrivit Locke, : « Là où il n’y a pas de loi, il n’y a pas non plus de liberté. »
 25- Dans l’introduction de son livre (La démocratie), Bruno Bernardi soulève une épineuse question : pourquoi existe-t-il une si grande ambiguïté, pour ne pas dire : opposition, entre la philosophie et la démocratie ? « Que disent les philosophes de la démocratie ? S’interroge-t-il (...) La chose est criante : une anthologie des textes philosophiques sur la démocratie est avant tout une anthologie des critiques possibles de la démocratie. » En raison même de sa complexité, je me garderais bien, ici, de proposer une réponse, même partielle, à une telle question. Toutefois, il semble exister une tension entre la réflexion sur l’homme, en tant qu’homme, et sur le mode démocratique de l’organisation sociale. Platon, par exemple, semble mal supporter que, sous prétexte de liberté, la démocratie se dispense de toute norme réglant la vie des hommes et de la cité et, cela, au nom de l’égalité : « Tels sont les avantages de la démocratie, avec d’autres semblables. C’est, comme tu vois, un gouvernement agréable, anarchique et bigarré, qui dispense une sorte d’égalité aussi bien à ce qui est inégal qu’à ce qui est égal. La République, 558b. » Finalement, Platon n’est peut-être pas aussi éclairé qu’il n’y paraît. En effet, sa critique de l’égalité se fonde sur une ambiguïté, une erreur, pourrait-on dire, lourde de conséquences : si l’égalité implique que les hommes ont une nature ou une dignité communes, elle ne décrète pas pour autant qu’ils soient semblables en tout point. Par conséquent, l’égalité ne supprime pas les différences et, dès lors, s’accorde pleinement avec une réflexion sur la condition humaine. Platon ne pouvait connaître l’article 1er de la déclaration des droits de l’homme de 1789 selon lequel : « Les hommes naissent et demeurent libres en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune. » S’il en avait été autrement, Platon aurait sans doute tenu compte d’une donnée essentielle en matière politique : l’égalité ne concerne pas l’homme en tant que fait mais l’un des droits auxquels il peut prétendre.
25- Dans l’introduction de son livre (La démocratie), Bruno Bernardi soulève une épineuse question : pourquoi existe-t-il une si grande ambiguïté, pour ne pas dire : opposition, entre la philosophie et la démocratie ? « Que disent les philosophes de la démocratie ? S’interroge-t-il (...) La chose est criante : une anthologie des textes philosophiques sur la démocratie est avant tout une anthologie des critiques possibles de la démocratie. » En raison même de sa complexité, je me garderais bien, ici, de proposer une réponse, même partielle, à une telle question. Toutefois, il semble exister une tension entre la réflexion sur l’homme, en tant qu’homme, et sur le mode démocratique de l’organisation sociale. Platon, par exemple, semble mal supporter que, sous prétexte de liberté, la démocratie se dispense de toute norme réglant la vie des hommes et de la cité et, cela, au nom de l’égalité : « Tels sont les avantages de la démocratie, avec d’autres semblables. C’est, comme tu vois, un gouvernement agréable, anarchique et bigarré, qui dispense une sorte d’égalité aussi bien à ce qui est inégal qu’à ce qui est égal. La République, 558b. » Finalement, Platon n’est peut-être pas aussi éclairé qu’il n’y paraît. En effet, sa critique de l’égalité se fonde sur une ambiguïté, une erreur, pourrait-on dire, lourde de conséquences : si l’égalité implique que les hommes ont une nature ou une dignité communes, elle ne décrète pas pour autant qu’ils soient semblables en tout point. Par conséquent, l’égalité ne supprime pas les différences et, dès lors, s’accorde pleinement avec une réflexion sur la condition humaine. Platon ne pouvait connaître l’article 1er de la déclaration des droits de l’homme de 1789 selon lequel : « Les hommes naissent et demeurent libres en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune. » S’il en avait été autrement, Platon aurait sans doute tenu compte d’une donnée essentielle en matière politique : l’égalité ne concerne pas l’homme en tant que fait mais l’un des droits auxquels il peut prétendre.
26- De son coté, Aristote n’a pas éludé cette question : « Or tout le monde pense que le juste c’est une certaine égalité, et cela s’accorde jusqu’à un certain point avec les traités philosophiques consacrés à l’éthique. (Notamment : l’éthique de Nicomaque.) Le juste, en effet, c’est quelque chose en rapport avec des personnes, et on dit qu’il faut qu’une part égale revienne à des gens égaux. Mais il ne faut pas laisser dans l’ombre sur quoi porte l’égalité et sur quoi l’inégalité, car il y a là une difficulté et matière à philosophie politique. Les Politiques, p. 259. » Si la philosophie politique éprouve autant de difficultés face à la démocratie, c’est parce que cette dernière est un processus. Or, l’instabilité qui en découle s’accorde mal avec les exigences de la pensée philosophique qui recherche, toujours, des invariants indiscutables. Mais, au-delà, c’est la pensée politique, avec ses modes d’application, qui, dans sa totalité, s’avère être mouvante. Si les choses étaient différentes, il n’existerait qu’une seule constitution et, finalement, qu’un seul régime politique. Or, un système politique n’est que l’image sociale des peuples qu’il administre. De ce point de vue, l’Occident a eu beaucoup de chance si l’on considère que la Grèce, berceau de la démocratie, n’était, à son origine, qu’un système tribal figé dont l’injustice et l’arbitraire. C’est pourquoi, nous, heureux contemporains du 21ème siècle, avons une dette si grande notamment envers Clisthène (~570/~508.) En effet, et à l’aide de ses nombreuses réformes, il a su poursuivre l’œuvre de Solon en favorisant un processus démocratique qui atteint son apogée sous le règne de Périclès.
27- Assez paradoxalement, car, finalement, c’était l’un de ses rôles, la philosophie n’est pas à l’origine de la démocratie. D’où, peut-être, ses difficultés vis à vis de ce système politique. C’est pourquoi, Platon, puis Aristote, durent se contenter de commentaires plus ou moins éclairés à son sujet. De fait, la démocratie n’est pas issue d’une spéculation intellectuelle (philosophique, pourrait-on dire), sensée approfondir son concept, mais bien davantage d’évolutions sociales qui, toutes, tendent à orienter l’homme vers une liberté singulièrement absente dans les sociétés primitives. Certes, la démocratie repose aussi sur l’obéissance des citoyens mais dans un cadre juridique et non tribal. Dès lors, en démocratie, nous n’obéissons pas à un chef de clan mais, quelque part, à soi-même car nous constituons la base de sa légitimité. Seulement, si nous obéissons à nous-mêmes, nous sommes la mesure de notre obéissance. Ici, nous retrouvons le sophiste Protagoras pour lequel « l’homme est la mesure de toute chose. » S’il en est ainsi, l’homme est son propre souverain et, par conséquent, le maître de lui-même. Toutefois, admettre ce postulat soulève une redoutable question : Dans ce domaine, à quoi sert la philosophie ? En d’autres termes : que peut-elle apporter à un démocrate ? Certainement pas sa légitimité de citoyen puisque ce statut relève de la conception juridique de la société. La philosophie lui apporterait-il la faculté de penser ? Non ! Car la pensée est le propre de l’humanité : « Ce qui est propre à l’homme, nous dit Aristote, c’est donc la vie de l’esprit, puisque l’esprit constitue essentiellement l’homme. Éthique de Nicomaque, p. 277. » Alors, la philosophie ne serait-elle qu’un long commentaire sur elle-même ? Et, comme disait Kant : « On ne peut pas apprendre la philosophie mais seulement apprendre à philosopher ? » Certes ! Mais cela ne revient-il pas à penser que la philosophie n’est qu’une coquille vide ? Rassurons-nous : même lorsqu’il n’a pas étudié Hegel ou Nietzsche, un chat sait très bien ronronner sur nos genoux... Et, de con coté, la philosophie continue d’éclairer notre raison même si, quelque fois, elle faillit car, pensa Epicure, que l’on soit jeune ou plus âgé, il faut philosopher...

Périclès
28- La base de la souveraineté démocratique reposant sur l’adhésion des citoyens à ce système politique, reste à nous pencher sur la conception de la citoyenneté à l’époque de Platon et d’Aristote. Périclès, par exemple, donna un cadre juridique à la citoyenneté : désormais, celle-ci était réservée à ceux qui étaient nés de père et mère Grecs. Bien qu’elle soit énoncée clairement, cette définition est une ignominie à la fois humaine et juridique. En effet, tout en étant née d’un père et d’une mère Grecs, une femme n’était pas considérée comme une citoyenne. Or, et sauf erreur ou omission de ma part, je ne sache pas que Platon ou Aristote se soient insurgés contre cette injustice alors que, l’un et l’autre, ont beaucoup disserté sur ce sujet. Aussi, et si l’on peut admettre que la philosophie ne soit pas à l’origine de la démocratie, il est beaucoup plus difficile de comprendre sa désertion éthique face à l’un des plus grands scandales générés, à cette époque, par ce système politique. Car, rappelons-le, l’étymologie du terme démocratie signifie : le pouvoir du peuple. Or, les femmes (comme les métèques et les esclaves, d’ailleurs) ne faisaient pas partie de ce peuple désormais réduit à sa portion congrue. Je ne pense pas que la pensée platonicienne et aristotélicienne soit sortie grandie de ce paradoxe (pardon pour l’euphémisme.. !) En effet, ici, nous ne sommes pas dans l’anecdotique. Il s’agit de justice, laquelle, selon Platon, siégeait dans son monde des Idées. Celui-ci était-il donc si désinvolte vis à vis de ses propres concepts ? Finalement, si le « miracle grec » a su libérer la pensée, il ne s’est guère préoccupé de la seule valeur, à la fois humaine et juridique, qui soit véritablement cardinale : celle qui repose sur une réelle égalité entre les hommes et les femmes. Bien sur, m’a-t-on dit souvent, il faut replacer cette question dans son contexte historique. Mais cela ne nous dispense pas de nous interroger sur cette caractéristique, pour le moins étrange, de l’humanité. Mais, heureusement ! Les temps ont bien changés ! Et notamment dans un Occident qui n’est pas aussi nuisible que certains le pensent...
29- Il apparaît donc que, dès son énoncé, la notion aristotélicienne de la citoyenneté est singulièrement restreinte. En effet, et comme nous venons de le voir, les femmes, les esclaves et les métèques ne pouvant accéder au statut de citoyen, le concept même de citoyenneté a une portée pratique des plus limitée. Et cela d’autant plus qu’Aristote en circonscrit davantage la signification : « Un citoyen au sens plein, nous dit-il (Les Politiques, p. 221), ne peut pas être mieux défini que par la participation à une fonction judiciaire et à une magistrature (...) Nous posons donc que sont citoyens ceux qui participent de cette manière (comme magistrats) au pouvoir. Telle est donc à peu près la définition du citoyen qui s’adapte le mieux à tous les gens qui sont dits citoyens. » Il ressort de cette définition que la notion de citoyen est étroitement liée à celle de pouvoir qui, dans une démocratie, est indissociable de la loi. Ceci étant, il convient ici de se préserver d’une ambiguïté : qu’elle est l’acception de ce terme à laquelle Aristote se réfère ? Pour nous, modernes, la loi est la règle obligatoire promulguée par le pouvoir souverain, établie par une société et prise par le législateur. Au plan pratique, elle a deux conséquences : 1) tout citoyen est égal devant la loi. 2) Nul n’est censé l’ignorer : « De plus, disait déjà Aristote (Éthique de Nicomaque, p. 75), on punit aussi ceux qui ignorent quelques dispositions de la loi, que nul n’est censé ignorer (...) »
30- Pour mieux comprendre la conception aristotélicienne de la loi (qui est très éloignée de la nôtre, notons-le), il faut se référer à la notion d’isonomie. Pouvant être traduit par « égalité devant la loi », ce terme, « le plus beau nom qui soit, nous dit Hérodote », s’inscrit dans le strict champ politique exploré par la démocratie. La principale erreur à ne pas commettre consisterait à intégrer l’isonomie dans l’opposition moderne entre égalité de droit (égalité formelle) et égalité de fait (égalité réelle.) En effet, l’isonomie désigne le pouvoir du citoyen lui permettant d’élaborer les lois et non pas d’y obéir même si, en aval, il y est tenu. En réalité, le principe d’isonomie ne relève pas du juridique (bien qu’il y conduise) mais est, avant tout, une valeur ou, plus précisément, la désignation d’une dignité. Le fondement même de cette dignité (qui signifie, ici : accès à une fonction éminente) est précisément la citoyenneté définie par Aristote. En effet, le citoyen est une personne digne, en droit, d’accéder à une fonction de magistrat. Nous pouvons remarquer, ici, l’ambiguïté organique qui émane de cette définition. En effet, ce n’est pas la notion de mérite qui définit la citoyenneté mais seulement le statut de citoyen sur laquelle elle est fondée. Cette orientation politique de la démocratie ne pouvait que heurter le postulat fondamental de la philosophie : comment rendre l’homme meilleur ? Donc, comment le rendre vertueux ? Ces deux questions ont hanté la pensée de Platon et celle d’Aristote pour lesquels l’éducation était le seul moyen susceptible de les résoudre : « Que donc le législateur, nous dit Aristote (Les Politiques, p. 521), doive s’occuper avant tout de l’éducation des jeunes gens, nul ne saurait le contester. Et, en effet, dans les cités où ce n’est pas le cas, cela est dommageable à la constitution. » Or, déplorent ces deux philosophes, la notion d’égalité, qui est le propre de la démocratie, implique qu’une aptitude, notamment politique, est présente chez chaque citoyen. Cela laisserait supposer qu’il n’existerait pas de compétence, de savoir propre, pour exercer un mandat politique. Conséquemment, « l’homme étant un animal politique (selon Aristote) », il détiendrait une sorte de savoir inné, une compétence a priori lui permettant d’exercer une charge politique sans qu’il ait besoin d’une formation préalable.
Note : Remarquons que notre nouveau Président de la République, Emmanuel Macron, semble suivre cette voie. En effet, la plupart des candidats « macronistes » à l’élection législative, qui a suivi sa propre élection, sont issus de la société dite : « civile. » Donc, si l’on adopte cette étrange formule, et bien qu’ils soient amenés à légiférer, ces candidats ne disposent ni d’une formation, ni d’une expérience, en matière politique. L’avenir nous dira si cette option, pour le moins singulière, à notre époque, a été, ou non, une bonne idée. Pour ma part, je suis assez optimiste bien que je sois très réservé à l’égard de la politique économique et sociale préconisée par Emmanuel Macron...
 31- L’un des problèmes soulevés par la démocratie concerne l’aptitude du peuple à gérer les affaires de l’État. Montesquieu, par exemple, semble en douter : « Le grand avantage des représentants, c’est qu’ils sont capables de discuter des affaires. Le peuple n’y est point du tout propre (...) Il ne doit entrer dans le gouvernement que pour choisir ses représentants, ce qui est très à sa portée. L’Esprit des lois. » Montesquieu semble donc plaider pour une sorte d’élite qui serait la seule apte à légiférer et, a fortiori, à gouverner. Ici, le rapprochement avec Aristote paraît inévitable : « Il semble chose impossible qu’une cité ait une bonne législation si elle n’est pas gouvernée par les meilleurs mais gouvernée par les pires (...) Les Politiques, p. 316. » Certes ! Mais, comment peut-on reconnaître ceux qui sont les meilleurs ? Aristote nous répond : « Trois qualités doivent appartenir à ceux qui sont destinés à exercer les magistratures les plus importantes : d’abord la sympathie pour la constitution en place, ensuite une capacité éminente dans le domaine de leur magistrature, en troisième lieu l’excellence et la justice qui sont, dans chaque constitution, appropriées à cette constitution. Ibid. p. 392. » Seulement, et cela n’a pas échappé à Aristote, il existe très souvent un écart entre le réel et sa version idéalisée : « Mais il y a difficulté quand toutes ces qualités ne se trouvent pas chez la même personne : comment alors faire le choix ? Par exemple, si un individu a des aptitudes à être stratège, mais est pervers et n’a pas de sympathie pour la constitution, alors qu’un autre est juste et ami de la constitution mais inapte aux fonctions de stratège, comment faut-il faire le choix ? Ibid. p. 392. » Avec son habituel pragmatisme mâtiné d’une incontestable prudence, Aristote n’élude pas la question : « Il semble qu’il faille regarder deux choses : laquelle de ces deux qualités est la plus répandue parmi tous les citoyens et laquelle l’est le moins. C’est la raison pour laquelle, dans le cas de la fonction de stratège, on regardera plutôt l’expérience que la vertu, les dons de stratège, en effet, sont peu répandus, alors que l’honnêteté l’est plus ; mais pour une fonction de gardien du trésor ou d’intendant c’est le contraire, car cela demande plus de vertu que n’en possèdent la plupart des gens. Ibid. p. 392. » Ici encore, il me paraît difficile de ne pas établir un lien entre la pensée aristotélicienne et l’une des principales questions que nous nous posons aujourd’hui : quel doit être la relation entre la compétence et la vertu (ou si l’on préfère, la simple honnêteté) ? Dans ce domaine, il semble bien que nous assistions au retour en force de l’éthique (orientée, pour nous, vers la déontologie.) De fait, et après des décennies de dérives (comportementales, pour rester poli) émanant de nombreux hommes politiques, il semble bien que « l’opinion publique » soit lasse et donc désireuse de mettre un terme à ces pratiques pour le moins délétères. Cela est évidemment souhaitable mais à la condition, cependant, de ne pas céder aux sirènes d’un puritanisme encore plus dangereux...
31- L’un des problèmes soulevés par la démocratie concerne l’aptitude du peuple à gérer les affaires de l’État. Montesquieu, par exemple, semble en douter : « Le grand avantage des représentants, c’est qu’ils sont capables de discuter des affaires. Le peuple n’y est point du tout propre (...) Il ne doit entrer dans le gouvernement que pour choisir ses représentants, ce qui est très à sa portée. L’Esprit des lois. » Montesquieu semble donc plaider pour une sorte d’élite qui serait la seule apte à légiférer et, a fortiori, à gouverner. Ici, le rapprochement avec Aristote paraît inévitable : « Il semble chose impossible qu’une cité ait une bonne législation si elle n’est pas gouvernée par les meilleurs mais gouvernée par les pires (...) Les Politiques, p. 316. » Certes ! Mais, comment peut-on reconnaître ceux qui sont les meilleurs ? Aristote nous répond : « Trois qualités doivent appartenir à ceux qui sont destinés à exercer les magistratures les plus importantes : d’abord la sympathie pour la constitution en place, ensuite une capacité éminente dans le domaine de leur magistrature, en troisième lieu l’excellence et la justice qui sont, dans chaque constitution, appropriées à cette constitution. Ibid. p. 392. » Seulement, et cela n’a pas échappé à Aristote, il existe très souvent un écart entre le réel et sa version idéalisée : « Mais il y a difficulté quand toutes ces qualités ne se trouvent pas chez la même personne : comment alors faire le choix ? Par exemple, si un individu a des aptitudes à être stratège, mais est pervers et n’a pas de sympathie pour la constitution, alors qu’un autre est juste et ami de la constitution mais inapte aux fonctions de stratège, comment faut-il faire le choix ? Ibid. p. 392. » Avec son habituel pragmatisme mâtiné d’une incontestable prudence, Aristote n’élude pas la question : « Il semble qu’il faille regarder deux choses : laquelle de ces deux qualités est la plus répandue parmi tous les citoyens et laquelle l’est le moins. C’est la raison pour laquelle, dans le cas de la fonction de stratège, on regardera plutôt l’expérience que la vertu, les dons de stratège, en effet, sont peu répandus, alors que l’honnêteté l’est plus ; mais pour une fonction de gardien du trésor ou d’intendant c’est le contraire, car cela demande plus de vertu que n’en possèdent la plupart des gens. Ibid. p. 392. » Ici encore, il me paraît difficile de ne pas établir un lien entre la pensée aristotélicienne et l’une des principales questions que nous nous posons aujourd’hui : quel doit être la relation entre la compétence et la vertu (ou si l’on préfère, la simple honnêteté) ? Dans ce domaine, il semble bien que nous assistions au retour en force de l’éthique (orientée, pour nous, vers la déontologie.) De fait, et après des décennies de dérives (comportementales, pour rester poli) émanant de nombreux hommes politiques, il semble bien que « l’opinion publique » soit lasse et donc désireuse de mettre un terme à ces pratiques pour le moins délétères. Cela est évidemment souhaitable mais à la condition, cependant, de ne pas céder aux sirènes d’un puritanisme encore plus dangereux...
32- Nous venons de voir qu’Aristote a fait preuve d’une remarquable mesure en distinguant la compétence de la vertu et, surtout, en admettant que l’une n’est pas forcément liée à l’autre. Et, de fait, que ce soit dans le domaine politique, sportif ou autre, nous en avons la preuve tous les jours. Cela est d’autant plus compréhensible, qu’une personne, compétente ou non, reste souvent exposée aux aléas de sa psychologie, de son égocentrisme et, parfois même de sa vénalité. Aussi, ne pouvons-nous attendre que ce qu’il peut donner. S’il est imprudent d’affirmer qu’Aristote fut un démocrate zélé (le seul penseur qui, à cette époque, aurait pu revendiquer cette qualité est le sophiste Protagoras), il serait tout aussi déraisonnable de soutenir qu’il fut un adversaire acharné de la démocratie. Pour lui, en effet, et bien que ce système politique ne soit pas forcément le meilleur, il se garde bien de le vouer aux gémonies. Aussi, nous dit-il : « Qu’il faille que la masse soit souveraine plutôt que ceux qui sont les meilleurs mais qui sont peu nombreux, cela semblerait apporter une solution qui certes fait aussi difficulté, mais comporte aussi sans doute du vrai (...) Comme ils sont nombreux, en effet, chacun possède une part d’excellence et de prudence, et quand les gens se sont mis ensemble, de même que cela donne une sorte d’homme unique aux multiples pieds, aux multiples mains et avec beaucoup d’organes des sens, de même en est-il pour les qualités éthiques et intellectuelles. Ibid. p. 255. » Plus métaphoriquement, Aristote complète ce qui précède en mettant l’accent, cette fois-ci, sur la nécessaire relation devant exister entre les gouvernants et les gouvernés : « Connaître une maison, par exemple, ce n’est pas seulement le fait de celui qui l’a construite, mais celui qui s’en sert en juge mieux que lui (...) De même en est-il du pilote par rapport au charpentier, pour le gouvernail, et, dans le cas du festin, c’est le convive et non le cuisinier qui jugera le mieux. Ibid. p. 256. » En évoquant les rôles de l’architecte, du charpentier ou du cuisinier, Aristote soulève une question des plus cruciales : a quoi sert un homme politique et quelle est sa relation avec ceux qu’il gouverne ? A-t-il conscience de leurs besoins ? De leurs aspirations ? De leurs espérances ? Veut-il véritablement leur bien ? En bref, le pouvoir ne serait-il qu’au service du pouvoir ? Vaste question, ne trouvez-vous pas ? Conclusion :
Bien que parvenus au terme de ce rapide survol, nous pourrions néanmoins poursuivre en évoquant d’autres aspects, ou approches, de la politique aristotélicienne comme, par exemple, les constitutions droites ou déviées, l’égalité géométrique et arithmétique etc... Cependant, et après mure réflexion, je ne pense pas qu’il soit utile de persévérer dans ce sens. En effet, ces problématiques sont très éloignées des nôtres et ne peuvent donc éclairer notre présent. Toutefois je conseille au lecteur (à la lectrice) désireux de s’informer davantage de se référer aux deux textes fondamentaux sur lesquels je me suis appuyé pour écrire cet article : La République (Platon) et Les politiques (Aristote.) Ceci étant, je ne puis conclure sans évoquer la position d’Aristote vis à vis de l’esclavage. En effet, cette ignominie (comme celle concernant la position des femmes dans la cité) ne semble guère avoir préoccupé une pensée philosophique finalement peu soucieuse d’une véritable égalité entre les hommes. Plus édifiant qu’un long discours, écoutons Aristote : « Et pour l’usage, il n’est guère différent : l’aide physique en vue des tâches indispensables vient des deux, les esclaves et les animaux domestiques. Les Politiques, p. 119. » Sans commentaire.. ! Bien sur, pourrait-on me rétorquer, autre époque, autres mœurs... Certes ! Mais, indépendamment de sa condition sociale, de son destin, un homme est un homme et cela, la philosophie, notamment de cette époque, semble l’avoir oublié... (Pour note, il fallut attendre le 27 avril 1848 pour, qu’enfin, et sur la proposition de Victor Schoelcher, l’esclavage dans les colonies françaises soit aboli...)
Bien que différents sur beaucoup de points, Platon et Aristote ont montré (suggéré, plutôt) que la démocratie est, parmi les modèles politiques imaginés par les humains, l’un des plus fragile. En effet, ce système d’organisation sociale, en tant que structure politique, est un processus avant d’être une valeur. Facteur aggravant, s’il en est, les notions fondatrices de la démocratie, la liberté et l ‘égalité, sont loin d’être universelles. Car, l’une comme l’autre, ne sont que formelles et non de fait. Cela signifie qu’elles s’inscrivent, toutes deux, dans un processus culturel et non naturel. C’est bien pourquoi, d’ailleurs, l’article 1er de la déclaration des droits de l’homme de 1789 précise bien que « Les hommes naissent et demeurent libres en droit » ce qui implique qu’ils ne le sont pas universellement. De fait, et indépendamment de l’idée que l’on s’en fait (ici, je pense aux écologistes), la nature se moque complètement de la condition humaine. Peu lui importe, en effet, que les hommes soient libres et égaux. Elle est le siège de ce que l’on nomme : la loi naturelle qui n’est, finalement, que celle d’un arbitraire plus injuste, bien souvent, que celui instauré par les hommes eux-mêmes.
Au cours de l’histoire, la démocratie s’est sans cesse rapprochée de ce que l’on nomme : le bien commun. Évidemment, elle n’a jamais été parfaite mais, la perfection est-elle un objectif raisonnable alors que les hommes sont si faillibles ? Toujours menacée par les soubresauts de nos « cerveaux reptiliens », elle doit être protégée afin de préserver liberté et justice. Que ceux qui la vilipendent se souviennent de cela : lorsqu’elle s’absente, la vie en société devient un enfer...
Au moment même où j’achève ce texte, un débat se déroule au sein de l’assemblée nationale au sujet de la « moralisation » de la vie politique. En fait, la question posée est celle-ci : que doit-on faire (juridiquement) afin que les hommes politiques soient enfin dignes d’exercer leur charge ? S’agit-il, ici, d’un problème nouveau ? Certes non ! D’ailleurs, écoutons Aristote : « Ainsi pour éviter qu’on pille les deniers publics, le transfert des fonds publics doit se faire en présence de tous les citoyens, et des copies des comptes doivent être déposées auprès des phratries, des arrondissements et des tribus ; et pour que le pouvoir soit exercé de manière désintéressée les honneurs doivent être, de par la loi, décernés aux gens dont la réputation est intacte. Les Politiques, p. 390. » Ici, Aristote a raison : l’homme n’est pas naturellement vertueux ! Il est comme un enfant avide de plaisirs et peu soucieux des autres. Seuls comptent pour lui la satisfaction de ses désirs même si ses appétences vont à l’encontre d’autrui. C’est pour échapper à ce maléfique destin que les hommes ont inventé les lois fondatrices, pour nous, de la démocratie. Lois, sans lesquelles nous tous serions soumis à celle du plus fort. Aussi, chère lectrice, cher lecteur, souviens-toi de ceci : sans les lois, la liberté, l’égalité, la justice ne seraient que des mythes face auxquels nos fragiles rebuffades ne seraient que peu de secours...
Patrick Perrin


