| Faites connaître cet article avec Google +1 |
INTRODUCTION
« Un jour, il y a quelques années, comme je regardais les sculptures du Parthénon au British Museum, un jeune homme de mine inquiète m’aborda en disant : « Je sais bien que ça ne se fait pas d’avouer une chose pareille mais ces “machins” grecs, moi, ça ne me touche absolument pas. » « Voilà qui est intéressant », lui dis-je, « pourriez-vous préciser les causes de votre indifférence ? » Il réfléchit et répondit enfin : « Eh bien, tout cela me paraît bien trop rationnel. Me comprenez-vous ? » Je croyais comprendre. »

Ces quelques lignes écrites par E.R. Dodds au tout début de son livre (Les Grecs et l’irrationnel) illustrent l’immense mérite des philosophes présocratiques (philosophes ayant enseigné avant Socrate c’est à dire de la fin du 7e siècle jusqu’à la fin du 5e siècle av. J.C) qui eurent le courage de jeter les bases d’une pensée nouvelle. Pour la première fois en Occident, les cosmogonies (récits mythiques non-rationnels censés expliquer l’origine du monde) furent contestées au profit de conceptions pouvant être qualifiées de pré-rationnelles. Empruntant le chemin des cosmologies naissantes (discours rationnel sur la formation et la structure de l’univers) le logos (du grec : log (o) ou parole, discours, science) cessa progressivement d’être un « récit sacré », né de la pensée magique, pour s’orienter progressivement vers des acceptions beaucoup plus proches de l’univers scientifique. Outil incontournable de la langue philosophique, le logos accompagna les diverses étapes franchies par la raison. Ce cheminement, d’ailleurs, lui valu parfois de spectaculaires régressions dont la plus dommageable fut sans aucun doute celle infligée par Jean qui, dans le quatrième évangile (1er siècle apr. J.C.), recourut à cette notion pour désigner exclusivement la parole divine. Par contre, l’inexorabilité de cette diachronie (caractère des phénomènes analysés du point de vue de leur évolution dans le temps) pose un certain nombre de problèmes en raison des divers sens qu’il revêtit. Ceci explique qu’il soit indispensable de définir préalablement le contexte philosophique (en fait, la position de la raison) d’une période donnée avant même d’essayer de comprendre ce qu’il signifiait durant cette même période. L’une des erreurs les plus souvent commises consiste à « se tromper d’époque » soit en attribuant indûment notre manière de penser à des systèmes philosophiques trop anciens ou en confondant des périodes trop distinctes. A titre d’exemple, il est assez fréquent que l’on assimile l’atomisme antique (doctrine selon laquelle tout ce qui existe est matière ; toute matière étant composée d’atomes et de vide) à une science au sens moderne du terme. Bien que cette assimilation soit fort tentante, il n’en demeure pas moins que le fondateur de cette école (Leucippe ~500 av. J.-C.) et son prestigieux élève Démocrite étaient fort éloignés de la conception moderne de ce concept. En effet, leurs spéculations n’ont jamais été nourries d’observations expérimentales mais seulement d’intuitions dont on ne peut nier l’ingéniosité et, dans une certaine mesure, l’aspect prémonitoire. (A ce propos, notons que la “science” des grecs de l’Antiquité ne put jamais aboutir en raison, notamment, du grand mépris que cette époque voua à la pratique. Les tâches manuelles étaient réservées aux esclaves dont l’existence ne semble pas avoir choqué un Platon ni même un Aristote. C’est ainsi que la méthode expérimentale ébauchée par les Ioniens (penseurs du 6e siècle av. J.C. issus des cités côtières de l’Asie mineure notamment Milet et Ephèse) non seulement ne perdura pas mais tomba de surcroît en désuétude durant 2000 ans. Curieuse ironie de l’histoire, les esclaves, devenus chrétiens par la suite, finirent par prendre le pouvoir.. !) Ceci étant, la conception atomiste de la matière (Leucippe, Démocrite et, plus tard, Epicure) peut être considérée comme un matérialisme (Concernant l’époque, doctrine selon laquelle la matière est la seule réalité existante) pré-scientifique (que l’on songe à la théorie des quanta ou, encore, aux relations d’incertitude d’Heisenberg.. !) Par ailleurs, et dans la mesure ou la matière est considérée comme uniquement composée d’atomes et de vide, le mouvement devient par-là même possible comme le devient également l’existence de l’être et du non-être puisque l’un et l’autre dépendent d’un grand nombre d’états intermédiaires.
Par contre, et pour rester dans le domaine des assimilations heureuses ou malencontreuses, considérer Parménide (6e/5e siècles av. J.-C.) comme le précurseur de la notion complexe d’ontologie (que l’on peut traduire par : « Science de l’être ») ne semble pas relever de l’égarement (Il faudra cependant attendre Aristote –384/322 av. J.C. – pour que les bases rationnelles de l’ontologie soient posées.) Notons par ailleurs qu’en recourant à une double tautologie (proposition considérée d’une manière redondante comme toujours vrai : « un chat est un chat... ») affirmant que « l’Etre est et que le Non-Etre n’est pas », le philosophe Eléate a posé le principe d’identité et donc celui du tiers exclus (A est A ou A n’est pas A ; l’existence de l’un excluant automatiquement celle de l’autre.)
Il semble exister une sorte de « fil d’Ariane » qui permit au logos de conserver une cohérence historico-philosophique et cela en dépit de la multiplicité de ses sens. Cette continuité sémantique repose sur l’universalité de sa fonction primordiale qui est celle de la parole. Le logos ne mesure pas, il nomme, non pas un fait relevant du quantitatif, mais bien davantage un processus. C’est ainsi que le logos Héraclitéen désigne le processus par lequel la parole sensée du maître exprime une réalité émanant du divin alors que le logos Platonicien concerne un autre processus par lequel la parole du philosophe s’érige en instance scientifique. C’est notamment en raison de cette particularité métaphysico-linguistique que le logos tombera dans l’escarcelle de Jean l’évangéliste et, un peu plus tard, dans celle des Pères Apologistes (2e/3e siècles). Aidés en cela par la dichotomie Stoïcienne (pensée immanente et parole qui l’exprime) et la séparation/complémentarité des mondes platoniciens (monde sensible et monde intelligible), les penseurs chrétiens ont en effet réussi le tour de force de s’approprier l’un des plus profonds concepts de la philosophie antique pour le mettre au service de leur théologie.
Quelques aperçus épistémologiques.
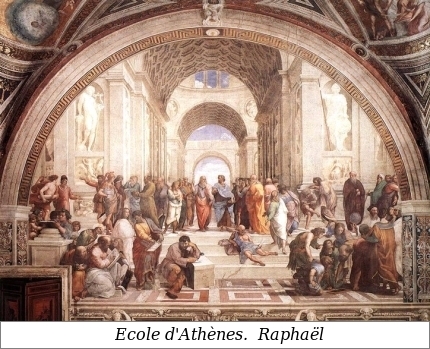
« Fille de la cité », la philosophie antique, tant au niveau de son étymologie (du grec philo, ami et sophos, sage) que de sa vocation (établir un discours rationnel –logos– destiné à comprendre la nature du monde) est d’origine grecque. Contrairement à la science, elle ne peut être considérée comme l’ébauche maladroite de pensées ultérieures. Dès les présocratiques (et, à fortiori, chez Platon et Aristote) elle proposa des systèmes extrêmement sophistiqués qui alimentent toujours notre réflexion à l’instar de conceptions beaucoup plus récentes (Rappelons, par exemple, que, non seulement d’avoir découvert la sphéricité de la terre, les pythagoriciens affirmèrent qu’elle tournait autour d’un feu immobile et que sa rotation quotidienne sur elle-même expliquait le mouvement diurne. Il faudra attendre Galilée pour la confirmation.. !) La philosophie antique est la génitrice de l’ensemble de la philosophie occidentale. Elle a conditionné, modelé, formaté (en dépit du freinage imputable à l’intrusion du catholicisme) le mode de pensée de notre civilisation. En dépoussiérant les mythes puis, en s’en écartant, la philosophie grecque a jeté les bases de la pensée rationnelle en lui fournissant les cadres conceptuels sans lesquels cette pensée n’aurait pu s’épanouir.
S’il est donc acquis que la philosophie occidentale soit née aux alentours de la mer Egée, les causes de cette survenue sont loin d’être l’objet d’un consensus. Ces divergences s’expliquent d’autant plus facilement qu’aucune raison ne s’impose véritablement tant et si bien que de nombreuses questions perdurent toujours aujourd’hui. Parmi les spéculations liées à cette interrogation, certaines, qualifiées de « farfelues » par certains penseurs, ont été définitivement écartées. Il en est ainsi de causes prétendument géographiques ou même climatiques (causes déjà raillées par Hegel). Si, chassés par les Doriens (vers 1180 av. J.-C.) , les Achéens, Ioniens et Eoliens s’installèrent en Asie Mineure pour y fonder plusieurs cités (dont Colophon, Ephèse, Milet etc..), leur fuite ne peut expliquer la floraison intellectuelle dont ces villes servirent de cadre. Par contre, il apparaît à beaucoup que la Grèce Antique, berceau de la parole, du discours, ait largement bénéficié de certaines particularités de la langue grecque comme, par exemple, sa facilité à exprimer des significations abstraites. Plus encore, la fonction copulative du verbe être a favorisé la mise en relation d’une chose avec une autre ce qui permit, d’ailleurs, à Aristote d’établir la liste de ses catégories. (Essence, qualité, quantité, relation, temps, lieu, avoir, action, passion, situation) Il n’est en effet pas sans conséquences d’affirmer que « Socrate est un homme » car, tout en désignant l’homme Socrate, on évoque la communauté (la catégorie) infiniment plus extensive des hommes. Dès lors, il est à la fois le sujet « Socrate » tout en devenant un « objet homme » susceptible d’être analysé en tant que tel. Il devient ainsi possible de réfléchir sur l’homme « Socrate » tout en s’interrogeant sur l’ensemble des hommes. Ou, encore, de se pencher à la fois sur le particulier et sur le général. Cette sorte de « causalité prédicative » a permis de dépasser le strict champ de l’expérience sensible pour atteindre un ordre de réalité qui le transcende. (La copule « est » n’implique pas l’identité entre le sujet et le prédicat. Par contre, elle exprime l’appartenance du sujet (Socrate) à l’idée énoncée par le prédicat (homme). Dès lors, le « est » de la célèbre formule parménidienne “l’Etre est” et le Non-être n’est pas” s’avère des plus ambiguë. C’est pourquoi Aristote précisera que l’Etre s’entend en de multiples acceptions. En effet, que Socrate appartienne à la famille des hommes n’implique en aucun cas sa disparition ou sa négation en tant que Socrate. En fin dialecticien, Platon avait avancé que le Non-Etre parménidien n’était ni l’opposé ni le contraire de son Etre mais un Etre différent du premier. En termes modernes, le Non-Etre platonicien peut être considéré comme l’altérité (Caractère de ce qui autre. Ce terme s’oppose à l’identité) de l’Etre parménidien.)
Une autre particularité de la langue grecque ne fut sans doute pas sans effet sur la naissance et le développement de la philosophie. Il s’agit de la possibilité de substantiver des adjectifs neutres. C’est grâce à cette opportunité linguistique que Platon (327/347 av. J.C.) a été en mesure d’imaginer sa théorie des Idées : l’adjectif « beau » est ainsi devenu « le Beau » ; « juste » est devenu « le juste » etc.. Il semble également utile de souligner le rôle essentiel joué par l’article défini. Cet article précieux permet non seulement de fixer son attention sur une personne, un objet donné, mais également sur ce qu’est, ou n’est pas, cette personne ou cet objet ; c’est à dire de s’interroger sur son essence. Ainsi, lorsque je dis « l’homme », je ne me borne pas à désigner un homme particulier mais m’interroge également sur ce que l’homme est en soi et, au-delà, sur ce que sont les hommes en général.
Muthos et Logos.
Indépendamment de ces quelques aperçus, il est un élément fondamental qu’il ne faut pas négliger. La philosophie est née du désistement progressif du mythe. Les choses se sont passées comme si le mythe s’était trouvé dans l’impossibilité de répondre aux questions nouvelles qui se posèrent soudainement. Se présentant souvent sous la forme d’un récit portant sur l’origine des choses, le mythe raconte une histoire qui ne peut s’inscrire dans un processus historique. (Le Dieu « incréé » de la théologie Chrétienne relève du même processus) Cette antériorité à l’histoire se comprend car, s’il en était autrement, le mythe ne pourrait rendre compte des conditions nécessaires à cette même histoire donc, de son origine. Cependant, tout en étant hors de l’histoire, in illo tempore, le mythe dit quelque chose sur quelques chose et comment ce quelque chose est né. « Le mythe est un langage », écrivit Lévi-Strauss (Anthropologie structurale) et à ce titre, il dispose des outils propres à tout langage. Dès lors, on ne peut l’accuser d’être totalement dépourvu de sens ni de ne pas transmettre des vérités même si celles-ci se tapissent derrières des formulations allégoriques un peu comme le contenu manifeste d’un rêve masque son contenu latent.
Parmi les mythes générés par les cultures pré-scientifiques, le mythe cosmogonique sert de matrice à tous les autres (cf. la création du cosmos (l’ordre) à partir du Chaos (le désordre) dans la Théogonie d’Hésiode.) Celui là raconte comment le monde a été créé et surtout quels sont ses géniteurs. Récit de l’origine par excellence, le mythe cosmogonique explique sous le mode métaphorique l’inexplicable, ce qui ne peut être conçu par la seule raison. Il tente notamment de surmonter le grand mystère soulevé par l’apparition du monde. Pourquoi existe-t-il quelque chose et non rien ? Mais, et contrairement à la théologie chrétienne, le mythe cosmogonique ne va pas jusqu’à évoquer une création ex nihilo. C’est ainsi que le monde issu de la Théogonie d’Hésiode est né d’un chaos existant avant toutes choses. De même, les cosmogonies orphiques reposent sur le mythe de l’œuf cosmique originel. Finalement la notion de « rien » est difficilement pensable et c’est sans doute pourquoi l’adhésion à l’idée selon laquelle un dieu est « incréé » ne peut être accomplie sans un acte de foi. (A ce propos, il est intéressant de se souvenir, qu’historiquement, Abraham fut le fondateur de la foi religieuse. En effet, la genèse affirme qu’il reçut un ordre divin lui enjoignant de se rendre sur le mont Moriah afin de sacrifier son fils Isaac. Bien qu’il ressemble à tous les sacrifices du monde paléo-sémique (qui relèvent de la coutume, d’un rite parfaitement assimilé), celui-ci s’en distingue fondamentalement dans la mesure ou il ne fut justifié par aucune cause (à la condition, cependant, d’excepter une totale allégeance à un Dieu) Aussi, et bien qu’il ne comprit pas pourquoi il devait accomplir cet acte, Abraham était malgré tout disposé à obéir en raison d’une foi inconditionnelle vouée à sa divinité. On peut supposer (et malgré les apparences) qu’il existe une clémence divine car, et au moment même ou il s’apprêtait à sacrifier son fils, un ange survint et lui dit : « Abraham, Abraham, ne porte pas la main sur l’enfant et ne lui fait aucun mal car je sais maintenant que tu es un “craigant-Dieu” . » Le décryptage de ce message illustre l’attitude somme toute paradoxale des croyants dont la foi repose sur un mélange très ambigu constitué de crainte et de l’espoir en un très problématique retour de “l’âge d’or” ou, encore, en une rédemption finale).
Indépendamment des mythes attachés aux origines, d’autres tentent de résoudre des contradictions apparemment insolubles. Il en est ainsi du mythe des Titans (poésie Orphique) qui essaie de justifier la méchanceté des hommes alors qu’ils sont censés détenir une infime portion de l’âme divine. En substance, ce mythe nous explique que les « méchants » Titans mangèrent Dionysos (après l’avoir fait bouillir et rôtir.) A la suite de ce crime Zeus, pour le moins courroucé, les frappa de la foudre. De leurs cendres émergea la race humaine qui, dès lors, hérita des tendances sanguinaires des Titans tout en participant (peu, il est vrai) de la perfection divine.
Très souvent évoqué, le mythe de Prométhée tente d’expliquer pourquoi les hommes sont condamnés à la vieillesse et à la mort. Irrité contre Prométhée, auteur de la supercherie du bœuf et du vol du feu, Zeus lui envoya la première femme, Pandore. Prudent, Prométhée refusa de la rencontrer ce qui ne fut pas le cas de son frère Epiméthée. Pandore avait apporté un coffret contenant tous les maux qui, dès le coffret ouvert, se dispersèrent à travers le monde. Lorsque Pandore (ou Epiméthée, selon certaines sources,) referma le coffret, seule l’espérance resta au fond. Ce beau mythe est intéressant dans la mesure ou il s’apparente au « péché originel » mais sans qu’aucune rédemption ne soit possible.
Le mythe est donc bien un langage prétendant dire quelque chose sur le cosmos et sur la condition humaine. Il raconte comment les dieux interviennent sans cesse dans les affaires humaines en se mêlant, par exemple, de la guerre de Troie. Durant la période archaïque, (7e/6e siècles av. J.C.) le mythe, en tant que discours, fut qualifié de muthos ou de logos. A quelques nuances près, l’un et l’autre constituèrent chacun de leur coté un « récit sacré » destiné à conter (et à représenter) un monde dont l’origine et les modalités relevaient de l’imaginaire. Toutefois, et il ne faut pas s’y tromper, ce récit sacré à eu, chez les Grecs, une fonction propédeutique (enseignement préparatoire destiné à l’accomplissement d’études plus approfondies) pour les siècles futurs. En insistant, par exemple, sur le passage du désordre à l’ordre (du chaos au cosmos), Hésiode (cf. supra,) a indéniablement (et certainement à son insu) préparé l’étape suivante qui consista à s’éloigner des mythologies pour rechercher les relations existant entre les diverses parties d’un univers supposé ordonné. Dans un premier temps, les générations divines (notamment décrites dans la Théogonie d’Hésiode) furent peu à peu couplées à des processus naturels. C’est ainsi que Zeus devint le feu ; Poséidon, l’eau ; Gaia, la terre et Hadès, l’air. C’est à partir de cette évolution que naquit la notion de principe qui tenta de définir une cause matérielle unique susceptible d’unifier notre expérience du monde. Finalement, le problème fondamental soulevé par les présocratiques consista à se demander comment l’univers matériel s’était formé et non plus à spéculer sur son origine. En d’autres termes, les cosmogonies cédèrent leur place aux cosmologies. Pour Thalès, (7e/6e siècles av. J.-C.), (le fondateur de la philosophie, selon Aristote) le principe fondateur fut l’eau ; pour Héraclite (6e/5e siècles av. J.C), le feu ; pour Anaximène (6e siècle av. J.C), l’air. De son coté, Empédocle (5e siècle av. J.C) ajouta à ces trois principes un quatrième : la terre. Ceci étant, que les présocratiques aient choisi l’eau, le feu, l’air ou la terre comme principe générateur de tous les autres « Etants » importe peu. De toute manière, ils ont, tous, eu tord ! Par contre leur génie consista à définir un principe unique qui, dès lors, devint « l’Un. » Cela dit, les choses ne furent pas aussi simples. Tout commença par « un combat de géants », remarquera Platon (Le sophiste 246 a) au sujet des présocratiques qui se heurtèrent à une redoutable aporie (contradiction insoluble) : comment l’Etre peut-il provenir du non-Etre ? Le changement existe donc bien (le « fleuve » d’Héraclite...) Mais aussi, comment l’Etre peut-il être autre chose que lui-même sans cesser d’être le même ? (« L’Etre est » de Parménide...) La philosophie doit à Aristote d’avoir su mettre un terme à ce combat en « catégorisant » les divers états de l’Etre. Dès lors, l’Etre demeura certes lui-même mais devint également autre chose.
Bien que les présocratiques aient tenté de substituer aux cosmogonies divines des cosmologies reposant sur des principes matériels et naturels, il serait faux de penser qu’ils opérèrent une rupture brutale avec le divin en balayant d’un revers de manche les conceptions mythiques qui prévalaient. A titre d’exemple, Xénophane de Colophon (6e siècle av. J.C.) ne cessa de dénoncer l’anthropomorphisme de ses contemporains : « si un bœuf savait peindre, son Dieu ressemblerait à un bœuf » (frag. 15). Ceci étant, il fut un homme profondément religieux. Toutefois, son Dieu n’était en rien semblable aux hommes, ni par l’apparence, ni par l’esprit. Dès lors, il n’est pas surprenant qu’il se soit rendu compte que la croyance en un Dieu relevait inévitablement d’un acte de foi (cf. Abraham) et non du fruit d’une connaissance : « Aucun homme, dira-t-il, ne peut connaître les Dieux. Même s’il tombait par hasard sur la vérité exacte, il ne pourrait savoir qu’il y serait parvenu. » Cet honnête distinction (dilemme omniprésent dans la pensée grecque de cette époque) entre ce qui est connaissable et ce qui ne l’est pas deviendra au fil des siècles l’un des fondements de l’humilité scientifique et, dans une certaine mesure, du relativisme (positif) d’un Auguste Comte.
De son coté ; Thalès de Milet se garda bien d’enfermer le divin dans un placard : « De tous les êtres le plus ancien c’est Dieu car il n’a pas été engendré... » A son tour, Pythagore (6e siècle av. J.-C.), après avoir déclaré au tyran Léon être un homme s’efforçant d’aller vers la sagesse, ajouta : « Il n’y a pas d’autre sage que Dieu. » On ne peut s’empêcher de noter la persistance du divin chez ces penseurs qui, par ailleurs, ont affirmé être les détenteurs d’une sagesse susceptible d’éclairer leurs contemporains. Toutefois, cette prudence ne les préserva pas de l’hostilité des masses populaires qui, la plupart du temps, préférèrent s’en remettre aux devins professionnels et autres charlatans. Dès lors, il n’est pas surprenant que ce rationalisme naissant (doctrine qui considère la raison comme moyen de connaissance) se soit heurté dès son éclosion à une très forte réaction. Non seulement la majorité du peuple n’adhéra pas aux idées nouvelles mais certains philosophes furent même accusés d’impiété. Si Anaxagore (5e siècle av. J.C.) et Aristote n’eurent pas à en trop souffrir, ce fut loin d’être le cas pour Socrate... Finalement, la raison n’éclaire que la raison...
Dès son origine, la philosophie a tenté de trouver le fondement des choses en séparant le bon grain (la part de vérité pressentie dans le mythe) de l’ivraie (la part métaphorique du mythe). Pour s’affranchir des illusions et des obscurités issues de l’univers mythologique, la raison n’eut d’autre choix que d’opposer aux mythes un refus rationaliste et obstiné. C’est à ce moment là que muthos et logos commencèrent à se disjoindre et l’on peut avancer que la philosophie est née de cet antagonisme croissant. Dans un premier temps, le logos a désigné un récit qualifié de « sacré » alors que le muthos se cantonna dans les limites du discours « profane. » Puis, peu à peu, le logos s’orienta vers une spécialisation beaucoup plus rigoureuse qui aboutit à l’émergence d’un discours bien réglé. De son coté, le muthos s’installa dans la parole illusoire, trompeuse. Creuset de la subjectivité, son discours consista à énoncer ce qui était possible mais sans jamais le démontrer. Pour conclure, nous pouvons avancer que les mythes relèvent tous du muthos grec alors que la raison moderne relève du logos tout comme la science moderne est l’héritière directe de ce même logos.
Le Logos Héraclitéen.
Si l’on veut bien suivre Apollodore, l’Ephésien Héraclite, aurait vécu son acmé (sa quarantième année) vers –500 av. J.C. Il aurait ainsi connu les désastres qui frappèrent la Grèce d’Ionie et notamment le sac de Milet (- 498) ainsi que les incursions perses vers l’Europe. S’il semble incontestable qu’Héraclite ait connu ses prédécesseurs Ioniens (Thalès et le Milésien Anaximandre), en revanche, il ne les aurait jamais cités. Par contre, une évocation de Diogène Laërce (Vies, doctrines et sentences des philosophes illustres – ~ 3e siècle apr. J.C. -) en dit long sur la démesure de son orgueil et le mépris qu’il porta à certains penseurs de l’époque : « La grande érudition n’exerce pas l’esprit. Sans quoi, elle en aurait donné à Hésiode, à Pythagore, et encore à Xénophane et à Hécatée. »
L’un des thèmes essentiels de la pensée d’Héraclite se manifeste dans sa théorie de la mobilité ou du changement : « On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve...(fgt 91) » Opposée en cela à Parménide (pour lequel le mouvement ne peut avoir de réalité ontologique d’où : « L’Etre est et le non-Etre, n’est pas »), cette conception exprime le caractère aléatoire du monde des perceptions. Or, considérer les perceptions comme non fiables pose un grave problème au niveau de la connaissance. D’ailleurs, cette difficulté n’a pas échappé à Platon : « Mais on ne peut même pas dire, Cratyle, qu’il y ait connaissance si tout change et si rien ne demeure fixe (...) Mais si la forme même de la connaissance vient à changer, elle se change en une autre forme que la connaissance et, du coup, il n’y a plus de connaissance.. » (Cratyle 440c) De ce point de vue, il est possible de voir Héraclite comme un précurseur de Protagoras (5e siècle av. J.C.) dans la mesure ou sa théorie du changement perpétuel peut être considérée comme un pré-relativisme (doctrine selon laquelle la connaissance absolue des principes et des causes premières est impossible.) Nonobstant, la mobilité des choses n’a pas empêché Héraclite d’avoir une vision du monde reposant sur le combat et la lutte : « Toute chose naît de la lutte (fgt 8) » Ou encore : « Le combat est père de toutes choses (fgt 53) » (Cette conception est très proche du dualisme d’Empédocle selon lequel tout résulte du combat entre “l’amour” et la “haine”.) Ceci étant, cet accent porté sur les contraires n’exclut en rien ni leur unicité ni l’harmonie qu’ils constituent : « Les contraires s’accordent et la belle harmonie naît de ce qui diffère (fgt 8) » Nous retrouvons ici une trace de l’harmonie pythagoricienne résultant d’un rapport entre deux contraires. Plus tard, cette conception sera évoquée par Aristote : « Pour Héraclite, l’utile naît du contraire, la plus belle harmonie naît du contraire, et tout provient de la discorde » (Ethique à Nicomaque) Cette lutte entre les contraires n’est finalement qu’une réplique de l’opposition entre l’Un et le multiple et inversement : « Ce combat, écrivit Jean Brun, entre les contraires n’est, au fond, que la tragédie même qui oppose l’Un au multiple et le multiple à l’Un » De la sorte, le multiple naît de l’un comme l’Un naît du multiple ou, encore, l’Identité réside dans la Différence et la Différence ne saurait être sans l’Identité (Ici encore, nous retrouvons la conception défendue pas Empédocle.) Cette réversibilité nous renvoie inévitablement à la notion d’Eternel Retour (Représentation cyclique du temps par opposition à la conception linéaire et irréversible de ce même temps) si récurrente chez les Grecs. Comme le nota avec sa pertinence habituelle Jean Brun, il ne s’agit pas chez Héraclite d’une philosophie du devenir mais plutôt d’une philosophie du revenir.
Comme la plupart des présocratiques, Héraclite détermina un principe unique : le feu (qualifié parfois de « Un » ou « Chose sage. ») Il considéra cet élément comme le fondateur des multiples phénomènes de l’univers. Bien qu’apparemment conforme à la description moderne de la chimie, le feu Héraclitéen est bien plus qu’un simple phénomène issu de la combustion d’un corps. En effet, il est étroitement associé au logos divin ou, ordre d’un monde qui résulterait d’un équilibre instable entre des contraires toujours en conflit (D’où l’une des notions fondamentales de la pensée Héraclitéenne : la guerre – ou : polemos -.) Bien qu’il soit le moteur des choses qui surviennent, le feu d’Héraclite est également une « substantialisation du logos » (Jean Brun). Toutefois, ce logos n’est pas encore la raison administrant toutes choses. S’il n’est pas à proprement parler un oracle (Réponse que les dieux étaient censés apporter à une question posée par les hommes), le logos est malgré tout une parole vouée à la transmission d’un message : « Si ce n’est pas moi mais le Logos que vous écoutez, il est sage de reconnaître que tout est Un. » Ce fragment d’Héraclite (fgt 50) suggère une double appartenance du logos. Il est à la fois transcendant dans le sens ou il est porteur d’un message émanant d’une sorte d’intemporalité : « Les hommes sont incapables de comprendre le logos éternel... (fgt 1) » et immanent parce que commun à tous : « Bien que le logos soit commun à tous, la plupart vivent comme s’ils possédaient une pensée particulière (fgt 2). »
Philosophe isolé, Héraclite s’est fait l’interprète d’un logos toujours, selon ses propres dires, présent auprès de lui. Le double caractère du logos (à la fois transcendant et immanent) actualise une rupture ontologique entre le divin et les hommes. Le logos Héraclitéen est une passerelle entre ces deux instances ; une parole qui permet de communiquer un peu comme le corps calleux assure un dialogue permanent entre les deux hémisphères cérébraux. Pour Héraclite, il semble donc exister une interdépendance entre le monde et l’homme. C’est pourquoi certains penseurs avancent qu’il fut peut-être le premier philosophe ayant proposé une cosmologie (discours rationnel sur la structure de l’univers, rappelons le) mais également l’embryon d’une anthropologie (science de l’homme.)
Le Logos des sophistes.
Si la pensée des présocratiques fut étroitement liée au contexte mythologique de leur époque, celle des sophistes ne peut être dissociée du contexte politico-social d’Athènes (Il en sera de même pour la philosophie politique de Platon.) A titre d’exemple, Périclès - ~495/~429 – chargea Protagoras de rédiger les lois de la cité panhellénique de Thourioi. L’une des particularités des cités grecques (et notamment d’Athènes) fut d’être administrée par des aristocraties électives et non pas héréditaires. Seulement, pour être élu, encore faut-il savoir démontrer que l’on est meilleur que ses adversaires (Il en est ainsi dans toutes les démocraties.) D’où l’obligation de maîtriser la parole, de savoir persuader et d’être capable de convaincre à l’aide de ses propres arguments même si certains d’entre eux s’avèrent être des plus discutables...
C’est dans ce contexte qu’émergea au 5e siècle un type nouveau d’intellectuels (les sophistes) qui proposèrent de doter leurs élèves des outils indispensables à leur réussite sociale ou politique. Primitivement, ce terme n’avait aucune connotation péjorative. Issu de « Sophia » (ou sorte de compétence permettant l’accomplissement d’actes hors de la portée de la plupart), le terme « Sophistès » (ou « Sophiste ») désignait un expert de la Sophia, notamment en matière de langage. En opérant une véritable rupture avec les préoccupations des présocratiques (principalement orientées vers la nature), les sophistes ont centré leur pensée sur l’homme. Toutefois, cette orientation nouvelle n’émergea pas du néant. En énonçant que « L’homme est la mesure de toutes choses : de celles qui sont en tant qu’elles sont, de celles qui ne sont pas en tant qu’elles ne sont pas (Platon : Théétète 152 a) », Protagoras (490/420 av. J.C.,) ne fera qu’interpréter le pré-relativisme de son maître Héraclite. Car, puisque tout change, seules nos sensations sont susceptibles de nous renseigner sur ce qui nous entoure. Mais, comme l’homme est le siège de ces sensations, il devient évident qu’il est la mesure de toutes choses. Evoqué précédemment, l’atomisme de Leucippe et de Démocrite a également préparé le lit de la sophistique. En effet, puisque ce que l’on perçoit résulte de la mobilité des atomes, il ne peut exister de connaissance réelle des choses. Aussi, et en plein accord avec l’analyse de Jean Brun, Protagoras aurait pour ainsi dire transposé la mobilité des atomes en un mobilisme de la vérité. Le relativisme de Protagoras alla si loin qu’il n’hésita pas à affirmer que : « Concernant les dieux, je ne sais s’ils sont ou s’ils ne sont pas ». L’indignation de ses contemporains est facilement imaginable et, sans sa fuite, il aurait été sans aucun doute condamné pour impiété.
La première victime de cette révolution intellectuelle fut, notamment, le discours ontologique de Parménide. En atteste, entre autres, le traité de Gorgias - ~- 483/~374 av. J.C.- : Du non-être ou De la nature. Dans ce texte, le sophiste (considéré comme le père de la rhétorique ou art de l’éloquence) expose que rien n’est et que, même si quelque chose était, ce quelque chose ne pourrait être connu et que, même si ce quelque chose pouvait être connu, le langage ne pourrait traduire cette connaissance (Nous retrouvons ici l’une des conceptions de Xénophane de Colophon). Il s’agit là d’un véritable relativisme mêlé à un scepticisme (doctrine affirmant que l’on ne peut jamais être sur d’atteindre la vérité) désabusé (d’ailleurs l’influence des sophistes à l’égard de l’école sceptique, fondée par Pyrrhon à la fin du 4e siècle av. J.C., est incontestable bien que l’on ne puisse parler d’une véritable communauté d’idées).
Outre ce nihilisme ontologique (C. Ramnoux), les sophistes ont prit acte de la précarité humaine dont le mythe d’Epiméthée apporte une justification mythologico-métaphorique. Esseulés, (« nus, sans chaussures, ni couvertures... » - Platon : Protagoras 321 c) errant dans un univers inconnaissable, les hommes ne peuvent, pour connaître, que compter sur eux-mêmes. Dés lors, Protagoras peut affirmer que : « sur toutes chose on peut faire deux discours exactement contraires » (Diogène Laërce) Il devint donc inutile de spéculer sur un principe premier comme le firent les présocratiques ou encore s’en remettre à l’Etre parménidien. La connaissance, comme l’action, ne dépendent plus que de l’homme qui, livré à lui-même, s’expose à la dictature du paraître avec les incertitudes que cette sujétion implique.
L’homme étant la mesure de toutes choses mais étant, lui-même, sans mesure, il ne peut exister de référent universel. Dès lors, la rupture du logos Héraclitéen avec la transcendance d’où il était censé provenir devint inévitable. La parole ne transmet plus le sens émanant d’instances intemporelles, quasiment divines, mais traduit seulement des rapports de forces issus des confrontations entre les humains. Peu importe que le discours soit vrai ou faux ! Il ne s’agit que de technique donc, au final, de forme (Avec un incontestable humour, Aristote ne manqua pas de railler cette conception : « Ceux-là qui, parmi les sophistes, s’engagent à enseigner la politique (...) ignorent absolument en quoi elle consiste (...) Il ne semble pas non plus qu’on devienne médecin à la simple lecture des recueils d’ordonnances.. ! » - Ethique de Nicomaque p. 286 -) En poussant jusqu’à ses dernières limites la signifiance des mots (Prodicos de Céos - –5e/6e siècles av. J.C.- se distingua particulièrement en cette matière), les sophistes ont savamment coupé le langage de la réalité. Avec les sophistes, on peut dire que le discours est devenu une dynamique vouée à la seule persuasion. Alors que pour les présocratiques le logos était : « Un langage qui parlait à l’homme et à l’écoute duquel celui-ci devait se mettre » (J. Brun), les sophistes l’ont enfermé dans la rhétorique dont la vocation n’était pas de démontrer une vérité irréfragable mais seulement de promouvoir un point de vue. Cependant, si le logos des sophistes se résume à l’art de bien parler, il en constitue également la mesure. Par conséquent, tout en étant la parole, le logos des sophistes est également la mesure de cette parole. Seulement, considérer l’homme (il s’agit ici de l’homme/sujet et non de l’homme/générique) en tant que référent unique de ses conduites conduit inévitablement à des excès. C’est ainsi que Callicles (5e siècle av. J.C.) n’hésita pas à déclarer que la marque du juste était la domination du puissant sur le faible et sa supériorité admise. Pour lui, plus puissant, plus fort et meilleur étaient synonymes et qu’il valait mieux commettre l’injustice que la subir. De son coté, et à la même époque, Trasymaque considéra que « la justice n’était que l’intérêt du plus fort (Platon : République I , 338 c) ; assertion à laquelle Socrate répondit « Il faut se garder avec plus de soin de commettre l’injustice que de la subir » (Gorgias 527 b)
S’il est vrai que les sophistes furent responsables d’une très grave crise du logos, faut-il suivre Platon et Aristote en leur jetant l’anathème ? Faut-il les accuser d’opportunisme, voire de cynisme ? Leur conventionnalisme politique (conception selon laquelle les institutions relèvent d’une convention établie par les hommes et non de la nature) fut-il à ce point nocif et destructeur pour la cité ? L’opposition entre la physis (nature) et le nomos (convention, croyance, loi) sur laquelle ils fondèrent une partie de leur réflexion fut-elle à ce point hérétique ? Au final, ne furent-ils que des rhéteurs, certes avisés, mais dépourvus de tout sens de la déontologie (science des devoirs – Littré -) ? Ou, au contraire, n’ont-ils pas, en désacralisant le logos, ouvert la voie d’une liberté nouvelle ? N’ont-ils pas prédéfini « l’animal raisonnable » d’Aristote en suggérant que pour être raisonnable, il faut tout d’abord pouvoir nommer les choses accessibles ? Ils ont repoussé les limites du langage jusqu’à le transformer en un outil totalement indépendant de tout contexte. Ils ont défini les règles et les lois de la communication et les ont dotées d’une remarquable autonomie. De ce point de vue, ils sont incontestablement les précurseurs du formalisme de la pensée et surtout de la logique qui devra à la théorie du syllogisme d’Aristote de parvenir au seuil de la maturité. Contrairement aux présocratiques de la première période, les sophistes (et avant Socrate) ont déplacé la philosophie du ciel vers la terre. (Platon inversera en partie le processus.) Ils ont manifesté un scepticisme certain tant vis à vis du divin que de l’Etre Parménidien et reporté leur attention sur l’idéal démocratique de la cité. On peut penser qu’en démystifiant l’univers, les sophistes ont entre-ouvert la porte de la liberté humaine. Ils ont contribué à libérer l’homme du carcan mythologico-cosmogonique qui l’étouffait. Cependant, faisant cela, n’ont-ils pas confronté davantage l’homme à sa terrible solitude ?
Le Logos platonicien.
Nous venons de voir que le logos Héraclitéen se caractérisait par une équivocité dans la mesure ou il relevait à la fois de l’immanent (dans le sens ou il se confondait avec la pensée humaine) et du transcendant (dans la mesure ou il exprimait la pensée divine qui habitait constamment la nature.) A partir de cette passerelle jetée entre le monde cosmogonique et celui des humains, Héraclite (ainsi que la plupart des présocratiques) ont généré un véritable naturalisme qu’il est possible de considérer comme “pré-laïque”. En effet, la recherche d’un premier élément duquel découleraient tous les autres revient à mettre en retrait la recherche d’une cause universelle et première. Il n’importe plus de chercher une origine divine (sans d’ailleurs la nier) mais d’observer ce qu’il se passe autour de soi. Ensuite, et après avoir pris acte de cette réalité accessible aux sens, il sera alors temps d’imaginer ce que pourrait être l’instance invisible (et donc, imperceptible) qui la gouverne. Finalement, la philosophie consiste à démêler le visible de l’invisible (le perçu du non-perçu) tout en opérant une critique sans aucune complaisance des opinions qui ne reposent, elles, que sur les inévitables illusions générées par nos sens.
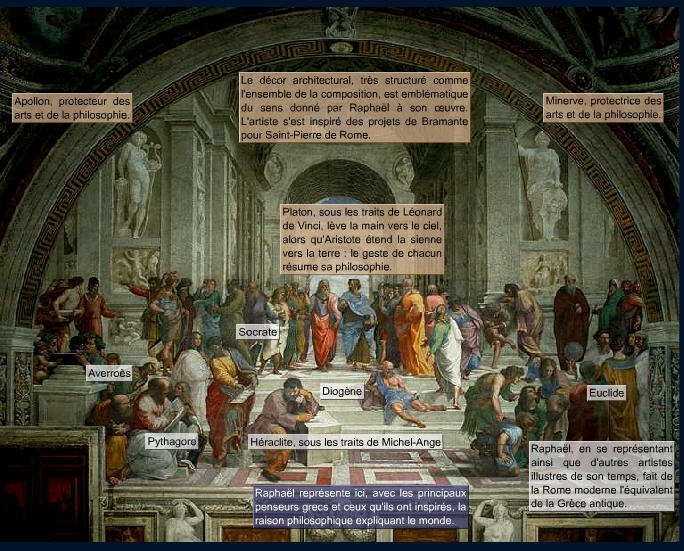
Beaucoup plus “utilitaristes”, les sophistes ont, en grande partie, délaissé le naturalisme des présocratiques pour se consacrer non pas à la condition humaine (selon un Malraux, par exemple) mais aux rapports sociaux. En énonçant que « l’homme est la mesure de toute chose », Protagoras a démystifié le logos en le coupant du divin. Certes, le logos désigne toujours la parole ; non plus celle d’un Etre transcendant mais celle, plus prosaïque, des hommes. Ayant Procédé de la sorte, les sophistes (Protagoras, surtout) auraient été les initiateurs d’une théorie teintée d’empirisme (doctrine selon laquelle la connaissance repose sur l’expérience sensible) et de relativisme (Conception selon laquelle la connaissance absolue des principes et des causes premières est impossible) que l’on peut (avec les précautions d’usage) mettre en perspective avec le pré-relativisme d’un Héraclite. Seulement, qui s’attache au relativisme se coupe obligatoirement du postulat essentiel de la raison : connaître et, surtout, tout connaître ! En effet si, d’une part, la connaissance absolue des causes premières est impossible et si, d’autre part, ce que l’on nomme la “vérité” est totalement subordonnée aux individus (thèse de Protagoras), la tentative de connaître l’universel n’est-elle pas vouée à l’échec ? Inévitablement, cette question renvoie à l’un des rôles essentiels de la philosophie : critique de l’opinion (du muthos), des prétendus savoirs, des idées préconçues etc. Mais, d’où proviennent ces opinions et ces prétendus savoirs sinon de l’homme lui-même ? Mais, encore, si l’homme devient le siège unique de la connaissance, à quelle instance pourra-t-il se référer afin de savoir s’il a tort ou raison ? En clair, qu’elle est sa propre mesure ? (“L’idéalisme” platonicien tentera de résoudre cette difficile question)
Paradoxalement, Socrate (470/399 av. J.C.) le maître de Platon (427/347 av. J.C.) a emprunté la technique oratoire des sophistes afin de les mieux combattre. Plus encore, il est possible de soutenir que la grande révolution du 5e siècle qui réorienta la pensée résulta de la collaboration involontaire des sophistes et de Socrate. La divergence porta sur la finalité du discours. Nous avons vu que pour les sophistes, celui-ci visait à favoriser la réussite personnelle, satisfaire l’ambition politique en dotant l’élève des outils destinés à façonner une redoutable rhétorique. Les sophistes excellèrent dans l’art de perfectionner ce formalisme verbal qui, en apparence du moins, était complètement étranger aux idées. A l’opposite, le grand mérite de Socrate fut d’avoir tenté de prouver, qu’à partir d’un discours commun, il était possible de parvenir à un discours juste. Pour ce faire, il a recouru à une méthode reposant sur des argumentations et des réfutations : la dialectique au sens strict (ou méthode d’argumentation et de réfutation reposant sur l’alternance de questions et de réponses). Contrairement aux présocratiques, Socrate semble avoir orienté sa pensée sur les questions morales. Avec lui, la philosophie antérieure (celle de la nature) s’est transmuée en philosophie de l’homme. Il a combattu les croyances, non pas celles manifestées envers le divin mais celles concernant des savoirs prétendument détenus par ses concitoyens. Sa grande force fut d’affirmer « qu’il savait ne rien savoir » et que ce jugement, apparemment négatif, était en fait un savoir bien supérieur au non-savoir ou au faux-savoir. Interprété sous cet angle, le fameux apophtegme (maxime, parole mémorable) : “Connais-toi toi-même” dont Socrate fit sa devise prend tout son sens. Pour lui, il ne s’agissait pas de se livrer à une introspection psychologique mais bien davantage de soumettre les avis de ses interlocuteurs à une critique rigoureuse. De la sorte, chacun devenait le juge impartial de sa propre pensée. Alors que chez les sophistes, le logos se confondait avec une rhétorique toute entière mise au service de l’homme en tant qu’individu, le logos socratique apparaît être une méthode (la maïeutique ou art d’accoucher les esprits) chargée de débusquer l’être par delà les apparences trompeuses et les idées préconçues.
L’histoire montre que la période n’était pas encore disposée à tolérer un esprit doté d’une telle lucidité. Par ailleurs, les “Nuées”, un texte écrit en 423 av. J.C. par Aristophane, prépara le terrain à la condamnation de Socrate pour impiété et corruption de la jeunesse. La mort de Socrate (qui but la ciguë) révulsa Platon : Comment Athènes a-t-elle pu oser punir l’un de ses meilleurs citoyens ? Comment le faux a-t-il pu triompher du vrai ? N’existe t-il donc aucune justice ? Voici les questions qui se posèrent à Platon et qui alimentèrent sa réflexion politique. Puisque l’injustice de la cité avait permis la condamnation de Socrate, il fallait réfléchir sur les moyens à mettre en oeuvre afin qu’un tel crime ne puisse se renouveler. Cette préoccupation, quasi obsessionnelle, explique la longueur de la République et, surtout, les outrances nichées dans les Lois. Abstraction faite de la mort de Socrate, les ravages dus à la guerre du Péloponnèse ont poussé Platon à se demander comment l’on peut former de bons citoyens. Comment retrouver la grandeur des hommes du passé qui avaient fait d’Athènes le phare de la mer Egée ? Pour lui, seule la fondation d’un pouvoir philosophique pouvait permettre le retour de ce passé révolu.
Pour réaliser un tel projet, il fallait auparavant restituer au logos son rôle d’intermédiaire entre une transcendance oubliée, perdue, et les hommes. Quelque part, Platon a restauré le logos d’Héraclite en l’insérant à nouveau dans le ciel. La théorie des Idées, la fonction gnoséologique (théorie philosophique de la connaissance) des mythes, la dialectique ascendante, la réminiscence furent pour Platon les outils de cette restauration. A ses yeux, sans celle-ci, la cité ne pouvait se soustraire aux brutalités et iniquités prônées par un Callicles ou un Thrasymaque. Pour Platon, le monde sensible, le multiple, ne sont que les incarnations d’instances archétypales elles-mêmes vassalisées par un principe unique : l’Un ou le Un-Bien. Dès lors, la réalité des choses relevant du monde sensible est assujettie à sa relation avec les essences intelligibles. La conception platonicienne du monde est donc bipolaire et verticale mais, cependant, forme un tout indissociable. D’un coté, subsiste l’Etre parménidien mais amputé de son immobilisme tautologique et, de l’autre, justice est rendue au non-Etre qui devient en quelque sorte une multitude d’Etants. Le “même” figé de Parménide devient par-là même un éventail de relations entre des objets dotés d’une identique réalité. Socrate est toujours Socrate mais, de plus, il est également un homme sans qu’il cesse pour autant d’être Socrate (Nous voyons ici, à l’état embryonnaire, se profiler la logique d’Aristote)
Ceci étant, présupposer l’existence d’un monde transcendantal (celui des Idées) et d’un monde composé des objets perceptibles à nos sens implique un mode de communication entre les deux. Car, dans le cas contraire, à quoi pourrait bien servir le premier s’il était impossible d’y accéder ? Si l’on veut essayer de comprendre Platon il ne faut jamais oublier sa vocation de pédagogue. Que ce soit en matière gnoséologique ou dans le domaine de la politique, Platon est avant tout un éducateur. Par exemple, si l’on veut que la cité soit administrée dans le respect de la justice, il faut bien que ses dirigeants aient une représentation claire de ce que l’on entend par justice. Par conséquent, ils doivent être éduqués en fonction de ce projet. Cependant, pouvoir se représenter ce qu’est la justice requiert un modèle de “justice en soi”. Pour Platon, cette justice en soi correspond à une Idée. Il en va de même pour la beauté. Pour que l’on puisse considérer que telle ou telle chose est belle, il faut bien disposer d’une sorte de modèle unique : la “beauté en soi”. Toute l’architecture de l’univers Platonicien repose sur l’existence de ces deux mondes. Celui des Idées est constitué d’êtres stables, non-changeant, toujours identiques à eux-mêmes alors que celui des réalités sensibles (le multiple) doivent leur existence à leur appartenance au premier. Les Idées sont donc les causes des objets constitutifs de la nature. Pour Platon, le philosophe doit s’extirper du monde sensible pour se hisser jusqu’au Idées avant de parvenir enfin jusqu’à l’Idée des Idées : le Un ou le Un-Bien. Ce degré ultime dans la hiérarchie platonicienne est une transcendance absolue qui ne relève d’aucune autre cause qu’elle-même. Pour parcourir le long chemin séparant le monde sensible de cette dernière instance, le philosophe devra recourir à une démarche intellectuelle que Platon nommera : dialectique. (Dans le système platonicien il existe en réalité deux dialectiques : l’ascendante et la descendante. Dans cet article je n’évoque que la première) La dialectique platonicienne est un processus par lequel la raison se déplace du bas vers le haut. Qualifiée de science véritable (contrairement à l’opinion) elle désigne chez Platon un mouvement ascendant par lequel la raison quitte les apparences du monde sensible pour s’attacher aux concepts rationnels avant d’atteindre les Idées et, enfin, de parvenir jusqu’au principe premier de toute réalité : le “Bien” ou “Un-Bien” (on retrouve ici le sens métaphorique du mythe de la caverne.) Conçue de la sorte, la dialectique platonicienne est un outil voué à la découverte et à la connaissance d’invariants immuables préservés de la corruption due aux changements propres au monde sensible.
Différent en cela du logos héraclitéen, le logos platonicien ne se borne pas à la transmission d’une pensée présupposée divine. Ce logos (considéré sous l’angle dynamique, on pourrait dire “logos/dialectique”) est un processus rationnel même s’il finit par aboutir à la contemplation de l’Un-Bien qui se dérobe à tout discours. C’est dans ce sens que l’on peut qualifier le logos platonicien d’instance rationnelle car c’est la raison, et la raison seule, qui effectue ce parcours voué à la découverte du Bien et du Beau. Avec Platon, le logos a retrouvé son rôle d’intermédiaire entre la transcendance et le monde des hommes. Il est l’outil de la mesure dont l’avaient dépourvu les sophistes. Plus encore, il démontre la préoccupation humaniste de Socrate pour lequel il doit servir la cause du bien et du vrai. Toutefois, il trahit aussi une rupture ontologique entre les êtres en soi/Idées et les choses sensibles. Sous cet angle, il perdure en tant que parole, certes sensée, mais, quelque part, coupée de son propre objet. De la naquirent sans doute les contradictions de la pensée platonicienne qui se manifestèrent notamment dans sa philosophie politique. Supposons en effet que l’Idée du Juste existe. Supposons encore qu’elle soit “visible”. Comment la répliquer dans un monde soumis aux changements du temps puisqu’elle est censée être non-changeante ? Ici, sont atteintes les limites du système platonicien : le logos ne peut rien contre le temps ! D’ailleurs, Platon en fit l’amère expérience lors de ses voyages en Sicile. Alors, le logos de Platon ne fut-il qu’une utopie ? Glaucon (République IX 592 ab) sembla le suggérer : « Tu parles de la cité dont nous venons de tracer le plan, et qui n’est fondée que dans nos discours, puisque, aussi bien, je ne sache pas qu’elle existe en aucun endroit de la terre... » L’ambiguïté du logos platonicien s’explique par ce dilemme : à quoi peut donc servir une parole qui, finalement, n’exprime qu’une utopie ?
Le Logos des stoïciens

S’il fallait recourir à une notion illustrant le long cheminement des idées (et de leurs découvertes), celle de filiation serait manifestement la bienvenue. Toute création intellectuelle ne survient pas ex nihilo mais résulte d’une ascendance aux vertus propédeutiques. C’est ainsi que la pensée des présocratiques s’est affirmée au détriment de la théogonie d’Hésiode. Celle de Socrate s’est érigée en rempart contre celle des sophistes. Celle d’Aristote (que je ne puis évoquer dans le cadre de cet article) s’est développée à partir d’une critique du platonisme. La philosophie des stoïciens (la “sagesse” conviendrait mieux) a été fortement influencée par plusieurs de leurs prédécesseurs. Par exemple la division de leur philosophie en trois parties intimement liées : éthique, physique et logique est une réplication de celle mise en place pour la première fois par Platon. Leur théorie des catégories (qui de dix passent au nombre de quatre) peut être interprétée comme un développement de celle proposée par Aristote (il en va de même pour leur conception du syllogisme). Dans un même ordre d’idées, la réflexion de Marc-Aurèle (121/180) selon laquelle il convient de « réfléchir souvent à la rapidité avec laquelle est emporté et disparaît tout ce qui est, et tout ce qui vient au monde. La matière étant, comme un fleuve, dans un perpétuel écoulement... » (Pensées VI) sonne comme l’écho lointain de la célèbre réflexion d’Héraclite ; « On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve ».
La richesse et la complexité du stoïcisme reposent d’une part sur sa durée (plus de cinq siècles : 3e siècle av. J.C./2e siècle de notre ère) et, d’autre part, sur sa division en trois périodes : 1) L’ancien stoïcisme dont Zénon (336/264 av. J.C.), Cléanthe (331/232 av. J.C.) et Chrysippe (283/210 av. J.C.) furent les pères fondateurs. 2) Le stoïcisme moyen dont les penseurs principaux furent Panétius (185/112 av. J.C.) et Posidonius (135/51 av. J.C.). 3) Le stoïcisme dit “impérial” dont les trois principaux représentants furent : Sénèque (4 av. J.C./65 après J.C.), Epictète (50/130) et l’empereur romain Marc Aurèle (121/180). D’évidence, la doctrine initiale de l’ancien stoïcisme subit au cours des siècles nombre d’ajustements et d’inflexions plus ou moins importantes. Au sujet de la morale, par exemple, Diogène Laërce (VII p.79) nous dit que : « Zènon de Cittium et Cléanthe, comme ils étaient plus anciens, l’avait traitée de façon plus simple (que leurs successeurs) en l’ayant divisée en théorique et pratique ».
A l’instar des épicuriens (leur école dite du “jardin” fut fondée par Epicure en 306 av. J.C.) les premiers stoïciens affirmèrent qu’il n’existait d’autre réalité que corporelle ou matérielle tout en refusant un dualisme de la nature et de la matière (Opposé au monisme, le dualisme est une doctrine selon laquelle la réalité est formée de deux substances indépendantes comme, par exemple, l’âme et le corps chez Descartes). Mais, et alors que pour les épicuriens la matière était constituée d’atomes (Nous retrouvons ici la théorie atomiste transmise à Epicure par l’élève de Démocrite, Nausiphanes), la matière des stoïciens était composée d’une multitude de corps. Pour un stoïcien tout était corps y compris les âmes et même les dieux ou, le dieu. Toutefois, restait à résoudre le problème de la connaissance de ces corps et, au-delà, de celle du moteur qui les animaient. C’est ici qu’intervint le réalisme (Doctrine affirmant qu’il existe une réalité siégeant hors de la pensée) des stoïciens. En effet, ils ne se demandèrent pas comment les corps avaient émergé mais se bornèrent à constater leur existence par le truchement des sens. A ce propos, l’une des prudences des stoïciens consista à ne pas s’encombrer avec des questions réputées aporétiques (insolubles). A titre d’exemple, ils ne se sont pas posé la question de l’origine des passions et se sont contentés de constater leur existence tout en dénonçant leur nocivité « Elle est un mouvement, nous dit Zénon, de l’âme irraisonnée et contraire à la nature, ou encore un comportement excessif ». Toujours en fonction du même réalisme, ils n’ont pas inscrit l’âme dans une perspective eschatologique (doctrine traitant des fins soit de l’homme (après sa mort) ou de l’humanité) comme le fit Platon et, plus tard, comme s’y risquèrent les chrétiens.
Ceci posé, se fier aux sensations pour parvenir à une connaissance du monde implique un cheminement conduisant des sens à la raison. Ce point crucial de la théorie de la connaissance développée par les stoïciens fut parfaitement illustré par Zénon. Il montrait sa main en maintenant ses doigts étendus : Voila la représentation (pour aller au plus court : ce que l’on perçoit mais, en réalité, ce concept est beaucoup plus complexe en raison de sa division en deux types : compréhensive et non-compréhensive et, d’autre part en raison de l’interactivité entre l’objet perçu et l’âme), disait-il. Il repliait ses doigts : Voici l’assentiment (reconnaissance du vrai supposé résider dans l’objet de la représentation), poursuivait-il. Fermant totalement le poing : Voici la compréhension (origine de la science) continuait-il avant d’enserrer le poing fermé avec l’autre main et d’affirmer : C’est la science du sage ! Comme l’illustre cet enchaînement de métaphores, la théorie de la connaissance des stoïciens s’inscrit dans un processus empirique (doctrine énonçant que la connaissance est fondée sur l’expérience sensible). En clair, je perçois quelque chose (la représentation), le considère comme vrai (l’assentiment) et le convertit en objet de connaissance (la compréhension).
Pour un stoïcien, l’objet de connaissance acquis par l’intermédiaire de la compréhension est un des outils conduisant à l’obtention de la sagesse. Avec lui, la philosophie se détourne de l’idéal contemplatif de Platon pour se transmuer en une technique destinée à devenir “sage”. Remarquons, cependant, que ce cheminement s’inscrit dans un contexte des plus trouble. Le grand siècle de Périclès est déjà bien loin. S’ajoutant au déclin d’Athènes, les guerres et les difficultés économiques se succédèrent. Apeuré, doutant de son avenir, l’homme de l’époque hellénistique (3e/1er siècles av. J.C.) ne crut plus à l’universalisme pourtant anti-démocratique des empires. Pour faire face à sa solitude croissante, il s’est tourné à la fois vers lui-même et vers les cultes orientaux qui, peu à peu, s’interposèrent contre les anciennes croyances de la cité. « Privé de son cadre politique naturel, nous dit Victor Goldschmidt, l’individu se découvre dans sa solitude ; la question du bonheur individuel devient prépondérante (...) L’isolement de l’individu, son sentiment d’impuissance en face des fluctuations politiques et sociales, le déclin progressif de la Cité avec les valeurs qui y étaient traditionnellement liées, l’apparition des cultes orientaux qui viennent prendre la relève de la religion de la Cité font naître ce qui s’appelle souvent le désir du bonheur » (Histoire de la philosophie (1) La Pléiade p. 725. 727) Tout comme l’épicurisme ou, encore l’école cynique, le stoïcisme tenta d’apporter une réponse politique, éthique et, pourrait-on dire, existentielle à ce désarroi ambiant.
Toutefois, et à l’inverse du cynique pour lequel le sage vit seulement avec lui-même tout en refusant les conventions sociales, le stoïcien ne s’est pas contenté d’un repliement sur soi. Il n’a pas fui ses responsabilités publiques : « Le sage peut, si rien ne l’en empêche, prendre part au gouvernement » nota Diogène Laërce en citant Chrysippe VII p.91). Les stoïciens ont donc participé à cette vie publique au prix, parfois, de surprenantes compromissions (pour exemple, la lettre de Sénèque destinée au tyran Néron) ou, à d’autres moments, en accédant à la plus haute marche du pouvoir (l’empereur Marc-Aurèle). Nonobstant, cette collaboration ne doit pas masquer le réalisme des stoïciens. Certes, ils s’investirent dans les affaires du monde mais ne perdirent pas de vue l’arbitraire des puissants et, au-delà, la vanité de l’utopie politique douloureusement expérimentée par Platon. « Cette indépendance (du sage à l’égard des puissances capables d’y faire échec) ne peut être une victoire réelle, effective. N’ayant aucun pourvoir sur le monde et les hommes, le sage ne peut modifier le cours des choses... » (Victor Goldschmidt ibid. p. 729)
Les stoïciens ne furent pas les seuls à prendre acte du contexte socio-politique de leur temps. Les cyniques, les sceptiques et les épicuriens firent de même et ceci explique les passerelles ayant relié leurs doctrines même s’ils se combattirent. Concernant les stoïciens, le stoïcisme impérial (1er/2e siècles de notre ère) a parfaitement illustré le glissement progressif d’une philosophie systématique vers des considérations presque uniquement orientées vers la morale et, par delà, sur les “bonnes” conduites à adopter. Par exemple, les conseils de modération et de prudence prodigués par Sénèque (lire les lettres à Lucilius) ou la méditation morale proposée par Epictète (lire son Manuel) ou, encore, la réflexion sur le sens du devoir prônée par Marc-Aurèle (Lire ses Pensées) ne concerne quasiment que la partie éthique de l’ancien et du moyen stoïcisme.
Si pour les principales écoles nées aux alentours du 3e siècle av. J.C., (Scepticisme, Epicurisme et Stoïcisme) les problèmes liés à la connaissance (ou son impossibilité) furent toujours présents il est une finalité individuelle qui prédomina : l’ataraxie. Apparue chez Démocrite, l’ataraxie (ou « absence de troubles ») est devenue, notamment chez les épicuriens et les stoïciens un but atteignable dès lors que l’on vit en accord avec la nature. Mais au-delà, cette démarche se confondit avec la recherche du bonheur. On peut toutefois remarquer que ce bonheur est quelque part a contrario car il n’intervient que dans le cadre d’une profonde quiétude reposant sur l’absence de tout trouble. Pour un stoïcien comme Epictète, il convint tout d’abord de distinguer ce qui est raisonnablement possible : « Il y a des choses qui dépendent de nous ; il y en a d’autres qui n’en dépendent pas... (Fragt 1) ». Un peu plus tard, Marc-Aurèle suivit la même ligne : « Il ne faut pas s’irriter contre les choses car elles ne s’en soucient pas (Livre VII Fragt 38) ». Ceci étant, l’ataraxie stoïcienne ne se réduisit pas à une dérobade face à des choses considérées comme inaccessibles. La détenir impliqua une connaissance de l’univers et notamment du mouvement qui l’anime dont le moteur était, pour les stoïciens un air chaud (pneuma). C’est ainsi que l’éthique s’est associée à la physique. En effet, une fois cette connaissance acquise, il suffisait d’accorder ses conduites avec l’univers.
Pour comprendre, notamment chez les stoïciens, l’importance de vivre en accord avec la nature il faut essayer de se représenter l’entrelacement entre le monde et le divin. « Tout est dans tout » affirma Sénèque ce qui implique que, dans la mesure ou tout est corps, dieu lui-même est un corps. Dès lors, il n’est pas surprenant que Marc-Aurèle (Livre IV) conseilla de se « représenter sans cesse le monde comme un être unique ayant une substance unique et une âme unique ». Ici, se profile la complexe notion du logos stoïcien. Au sein du monde, le logos est à la fois la parole de l’homme et le principe recteur de l’univers. Dès lors, l’homme est forcément en accord avec Dieu lui-même puisqu’une parcelle de l’esprit divin réside en lui « Le monde est donc gouverné par un esprit et une providence ; cet esprit pénétrant dans toutes ses parties, comme l’âme chez l’homme, mais toutefois moins dans certaines et plus dans d’autres. » (Diogène Laërce VII p.97). Par conséquent, vivre selon le logos c’est vivre selon la raison et, au-delà, vivre selon la nature puisque celle-ci est la matrice de tout ce qui existe. Après s’être prémuni contre les dévastatrices passions, le sage stoïcien est donc un homme qui vit selon la nature donc selon le logos. Toutefois, tout comme Platon dû se résoudre à l’imperfection de sa cité “idéale”, le réalisme des stoïciens les conduisit à reconnaître que leur sage n’était in fine qu’une construction de l’esprit. C’est ainsi qu’Epictète déplora voir des hommes débitants les maximes des stoïciens mais ne point voir de stoïciens : « Montre-moi donc un stoïcien, je n’en demande qu’un... » (Entretiens) De là, il appert que la sagesse est, bel et bien, inaccessible aux hommes puisque aucun d’entre eux n’a pu y accéder. Ce constat est lourd de conséquences. En effet, il implique la persistance d’une transcendance rectrice du monde. Dès lors, le logos ne régit pas seulement les pensées mais également la totalité de l’univers. N’étant qu’une partie de cet univers, l’homme ne peut donc prétendre accéder à une place que Dieu seul peut occuper. Aussi, et bien que Dieu soit imbriqué dans la nature au point de ne plus faire qu’un avec elle, on ne peut uniquement parler d’immanence au sujet de la doctrine stoïcienne. Il existe bien un principe régissant les parties du monde et les animant dont le logos est la traduction intelligible. Ce constat nuance singulièrement le panthéisme des stoïciens (doctrine selon laquelle Dieu est tout ce qui existe et non pas une entité qui transcende le monde comme pour le christianisme, par exemple) car, si cela était, l’homme serait confondu avec Dieu. En effet, si Dieu est bien immanent au monde, il en est également le régisseur. Rejoignant quelque part celui d’Aristote : « La nature ne fait rien en vain », le finalisme des stoïciens s’exprime sous la plume de Marc-Aurèle : « Tout ce qui arrive, arrive justement et ne peut pas ne pas arriver justement... » (Pensées IV) Antérieurement, Zénon avait prit acte de ce déterminisme (doctrine selon laquelle le réel relève d’un système de causes et d’effets absolument nécessaires) qui, à certains égards, peut apparaître désespérant : « La fin consiste à vivre conformément à la nature, c’est à dire à la vertu, car la nature nous conduit à la vertu » De son coté, Chrysippe précisa que « vivre selon la nature, c’est vivre selon les moyens que la nature nous donne pour vivre, car notre nature n’est qu’une partie de l’universelle nature ». Marc-Aurèle, encore, insista sur cette injonction : « Pour un être doué de raison, la même action est à la fois conforme à la nature et conforme à la raison (au logos) » Considérée sous cet angle, l’éthique stoïcienne apparaît être une initiation au bonheur car, si la nature conduit à la vertu : « le bonheur réside dans la vertu. » (Diogène Laërce VII p.92).
Dirigé par la raison, acceptant les évènements de l’univers et vivant en harmonie avec la nature, le sage stoïcien obéis au destin qui est : « L’enchaînement des causes des choses, ou encore la raison (le logos) qui gouverne le monde » (Diogène Laërce VII p.101). Ainsi donc, la première vertu du sage est l’impassibilité (Léon Robin : La pensée grecque P.398), impassibilité qui le conduit à ne s’étonner de rien : « Les stoïciens affirment encore que le sage ne s’étonne d’aucun des phénomènes qui paraissent extraordinaires... » (Diogène Laërce VII p.92). On mesure ici l’écart avec la conception platonicienne : « C’est la vrai marque d’un philosophe que le sentiment d’étonnement que tu éprouves. La philosophie, en effet, n’a d’autre origine... » (Théétète 155 d) .
Ainsi « le sage, c’est à dire l’homme libre parce que vivant sous la conduite de la raison (le logos), est celui qui s’attache à connaître les lois rationnelles de la nature (...) qui seules lui permettront de constituer un univers cohérent et vivable » (Jean Brun : Le stoïcisme P.120) Vu sous cet angle, le logos des stoïciens s’apparente au destin qui, selon Chrysippe, incarne la raison de l’univers. Différant du logos d’Héraclite pour lequel il était un verbe transcendant dont le philosophe se faisait l’interprète, celui des stoïciens s’inscrit dans une nécessité et un déterminisme régis par une providence elle-même guidée par les lois inexorables du destin. Il est moins un outil de connaissance (celle-ci relève de la technique) qu’un ensemble de règles devant dicter la conduite des humains. Il est un guide promettant la cohérence de la vie et son enracinement dans l’univers.
Le logos incarné des chrétiens.
Pour tenter de comprendre comment la théologie chrétienne eut l’opportunité d’associer le logos à sa doctrine, il faut préalablement se souvenir que la philosophie ne fut pas étrangère au judaïsme présent dans l’école d’Alexandrie. (Institution fondée à la fin du IV siècle av. J.C.) C’est ainsi que l’éclectisme (doctrine consistant à synthétiser les divers systèmes existants en privilégiant les points estimés pertinents) qui imprégna cette école entremêla le platonisme, l’aristotélisme et le stoïcisme. Il n’est donc pas surprenant que l’on trouve dans l’œuvre de l’un des plus brillants représentants de la philosophie judéo-alexandrine (Philon 13/54 apr. J.C.) les traces d’influences émanant à la fois de Pythagore, de Platon, d’Aristote et des stoïciens. Et, de fait, son logos est une synthèse mêlant la parole divine hébraïque avec les conceptions grecques issues du platonisme et du stoïcisme. La question soulevée par le logos de philon rejoint celle attachée à la relation existant entre ce qui est immanent (intérieur aux choses) et ce qui est transcendant (extérieur à ces mêmes choses). Ce logos implique obligatoirement un rapport entre ces deux mondes comme la dialectique ascendante platonicienne était censée établir une relation entre le monde « sensible » (le multiple mouvant) et le monde « intelligible » (les Idées), lui-même placé sous la régence de « l’Un-Bien ». Nous retrouvons donc chez Philon une conception, somme toute, assez proche de celle professée par Platon : le logos désigne à la fois les Idées/modèles et l’immanence d’un monde dont il est le lien garantissant la cohérence.
De tout temps, l’homme a été confronté à un problème crucial face au divin. Croire en cette instance, supposée transcender un monde imparfaitement perçu par nos sens, n’est pas absurde dans la mesure ou cette croyance apporte une cause à toutes les causes. Faisant preuve d’un indéniable pragmatisme, Aristote a admis qu’il fallait bien savoir s’arrêter sur une cause première ce qui revenait à rompre la chaîne infinie des causalités. (Rejetant cet argument dit “cosmologique”, Kant s’est écrié : nichée de sophismes !) Cependant, une telle décision implique une adhésion à une réalité purement spéculative laquelle, en aucun cas, ne peut pleinement satisfaire la raison. En effet, affirmer que Dieu est la cause de tout ce qui existe n’explique pas pour autant pourquoi lui, et lui seul, serait sans cause. Alors, des philosophes se sont évertués à trouver les “preuves” de son existence. Pour ne prendre qu’un seul exemple, évoquons Descartes pour lequel l’une de celles-ci repose sur l’imperfection de l’homme qui, pourtant, est capable d’imaginer la perfection. Si donc, pensa-t-il, l’imparfait peut imaginer le parfait c’est donc bien que ce parfait existe mais en dehors de celui qui l’a imaginé. On ne peut dénier une certaine logique à ce sophisme qui implique cependant une limite quasiment mathématique à la raison. Mais, si cela était, le progrès serait-il possible ?
Un autre problème se pose dès lors que l’on prête au divin des exigences en matière d’éthique (ou de morale). Comment doit-on se conduire pour vivre conformément au souhait de la divinité ? Et, surtout, qu’elle est la nature des signes qu’elle est censée nous adresser ? Plus encore, peut-on, et comment, les décrypter ? Si l’on veut bien se référer aux textes bibliques, nous pouvons trouver une réponse à ces deux questions. En effet, ce fut sur le mont Sinaï que Moïse reçu de son Dieu les lois dites « apodictiques » (connues sous le nom de « Décalogue » ou, encore, les « Dix commandements »). L’alliance ainsi conçue établit une filiation entre l’homme et son Dieu lequel, en plus de se manifester, lui dicta clairement les règles quasiment “déontologiques” devant guider son comportement. Il ne s’agit pas ici d’une quelconque cosmogonie dont les habitants divins se manifestaient de temps à autre à Delphes ou ailleurs, mais de la personnalisation d’une divinité susceptible de s’entretenir directement avec l’homme. Par conséquent, et si l’on considère cette anecdote comme véridique, le Dieu des Hébreux se serait bien adressé à eux. Ceci étant, une question subsiste : cette communication a-t-elle eu bien lieu ? Au nom de qu’elle irréfutabilité peut-on y adhérer ? Après tout, la pensée primitive croyait bien en l’existence de plusieurs dieux et, sans plus de preuves...
A toutes époques, la notion de faute et donc, de son expiation, s’est imposée dans l’esprit de l’homme. Au temps d’Homère, par exemple, existait la “culpabilité héréditaire” selon laquelle le descendant avait pour obligation d’expier la faute (ou les) faute (s) d’un ancêtre. A ce problème archaïque tardif se substitua la croyance en la “réincarnation” qui avait pour avantage d’offrir une solution moralement plus satisfaisante. En effet, cette explication eschatologique restituait une cohérence “juridique” en matière de répression de la faute car, dès lors, seul le contrevenant portait la responsabilité de ses erreurs antérieures. Avec le christianisme, la notion de faute, accorée à la culpabilité qui en découle, s’est universalisée (l’occident l’a payé très cher et le paie toujours très cher. Merci, Saint-Augustin.. !). En transgressant l’interdiction divine, Adam a introduit sur la terre une responsabilité collective dont l’intemporalité explique son inexpugnabilité. A la suite de cet écart, tous les humains se sont retrouvés associés face à une faute cependant commise par un seul d’entre eux. Dès lors, et avant même sa naissance, l’homme est coupable et, seule une totale allégeance à son Dieu, est susceptible de lui offrir un supposé salut non pas terrestre mais céleste (Saint-Augustin).
C’est dans ce contexte de culpabilité et d’un très problématique salut que le logos quitta son berceau mythico-philosophique pour être mis au service d’une religion qui finit par submerger l’Occident. Ce véritable rapt fut vraisemblablement amorcé par l’évangéliste Saint-jean qui, lors de la rédaction du quatrième évangile (1er siècle) recourut à la notion de logos pour indiquer que Dieu avait créé l’univers par sa parole. Dès lors, le logos désigna à la fois ce qui était créé et ce qui rendait intelligible l’objet même de cette création par la parole divine. Un peu plus tard (2e et 3e siècles), un groupe d’intellectuels (les Apologistes) tentèrent d’établir un syncrétisme (système philosophique ou religieux associant plusieurs doctrines différentes) entre le berceau Egéen de la philosophie grecque et le judaïsme alexandrin. S’appuyant sur le logos créateur fondé à Alexandrie et sur les diverses acceptions supportées par ce concept durant les siècles précédents, ils ont tenté d’ériger en philosophie ce qui n’était qu’une doctrine théologique. C’est ainsi que, pour eux, la doctrine chrétienne ne pouvait être que la philosophie véritable portée par un logos déjà identifié au christ préexistant.
Abstraction faite de la lutte menée contre les doctrines rivales (Gnose, Manichéisme, par exemple), la questions essentielle soulevée par les Apologistes concerna la relation existant entre le Père (Dieu inengendré) et le Fils (incarnation du Père qui en est la cause) et le Saint-Esprit (L’Esprit du Père). Or, le monothéisme étant la caractéristique la plus marquante du Judaïsme (celui que l’on prête à Akhenaton - ou Aménophis IV, 16e siècle av J.C. - étant d’un autre ordre), il fallut bien rendre cohérente cette multiplicité. Et, de fait, c’est à partir de cette exigence, à la fois théiste et intellectuelle, que s’est élaboré le dogme de la Trinité. Mais, et dès lors que Dieu, tout en étant unique, était supposé se présenter sous la forme de trois personnes (trois “hypostases”), la question portant sur la nature des relations entre elles trois ne pouvait manquer de se poser. Une telle problématique suscita nombre de divergences. C’est ainsi, par exemple, que naquit l’hérésie arienne (Arius fut patriarche d’Alexandrie vers 295-373). Selon celle-ci, le Christ ne pouvait avoir la même nature divine que le père puisque, et à l’inverse de ce dernier, il avait été engendré et avait eu un commencement. A cette conception (condamnée par le concile de Nicée en 325), s’opposa (non sans quelques réticences) celle d’Athanase (295-373) selon laquelle il existait une continuité substantielle entre le Père et le Fils. Athanase l’emporta sur Arius en raison de la cohérence de son système. En effet, l’avènement du Christ sur la terre ne releva pas du hasard. L’homme ayant “péché”, Dieu lui envoya son fils pour le « sauver » c’est à dire, pour doter l’homme des attributs divins perdus près de l’arbre de la connaissance. La pensée d’Athanase s’inscrivit donc bien dans la perspective du salut qui est la base même de la doctrine chrétienne. Mais, pour que le Christ soit en mesure de s’acquitter d’une telle tâche, il fallait bien qu’il relève, lui aussi, d’une substance divine.
Bien éloigné du logos de la philosophie grecque selon laquelle l’homme se justifiait par son appartenance à un univers qu’il tentait de comprendre par sa raison, le logos des chrétiens est une incarnation. Il est devenu une personne, Dieu ; une chair, Dieu encore. Il n’est plus l’outil de la raison mais, quelque part, le moteur d’une adhésion, inconditionnelle et ignorante, (Dieu est un mystère) à une instance présupposée apporter un problématique salut à l’humanité. C’est ainsi que pour Clément d’Alexandrie (2e/3e siècles), la seule philosophie est devenue le christianisme ou, encore, la seule raison universelle exprimée par le Christ. C’est ainsi, encore, que pour Origène (2e/3e siècles), ce Dieu mystère devint compréhensible par son Fils, le logos, qui est l’idée des idées donc, l’unique vérité.
Si le christianisme a triomphé en Occident c’est en raison d’un génial syncrétisme ayant associé le monothéisme judaïque et les exigences de la raison exprimées par la philosophie antique. Les grandes questions portant sur l’Un et le multiple (Platon) ou sur l’Être et le non-Être (Parménide) ou sur le rapport du général avec le particulier (Aristote) ont trouvé des réponses mythico-rationnelles. C’est de ce paradoxe qu’est née notre culture. Certes, le logos des philosophes s’est englué dans la théologie chrétienne mais s’est bien vengé dans la mesure ou cette même théologie n’a pu contourner l’obstacle philosophique. Pour s’en convaincre, lisons (ou relisons) Plotin (3e siècle) qui, sans le Parménide de Platon, aurait certainement été bien embarrassé avec la problématique soulevée par l’Un. Ou, encore, interrogeons-nous sur la conversion augustinienne dont l’ultime finalité est la recherche de l’absolu donc, la recherche de Dieu (la contemplation platonicienne de l’Un-Bien). Le logos des chrétiens ne recherche pas la connaissance mais tente uniquement de rendre Dieu intelligible. Certes, il est toujours la parole mais plus celle exprimée par la bouche du philosophe. Il est devenu la parole de Dieu exprimée directement aux hommes par la bouche du Christ. Avec les chrétiens, l’anthropomorphisme de l’époque homérique (contre lequel, rappelons le, s’est élevé Xénophane : « Si un bœuf savait peindre son Dieu ressemblerait à un bœuf... ») s’est renversé : « Dieu a créé l’homme à son image ». Dès lors, la personnalisation du divin ne pouvait que s’imposer en le rendant plus “humain” pendant que, parallèlement, l’homme devenait plus “divin”. C’est pourquoi, pour Athanase, le Christ (donc, le logos) est devenu homme à par entière afin que les hommes puissent se diviniser. Quelque part, le logos est devenu un outil de transmutation permettant, comme l’imagina Saint-Augustin, de franchir la ligne séparant la cité terrestre de la cité céleste. Par conséquent, le salut passe obligatoirement par lui à la condition, cependant, de ne pas désobliger le Père par une attitude par trop sceptique...
En dépit de l’avènement du christianisme et de son triomphe, la philosophie Antique n’a cessé de nourrir la civilisation Occidentale. Les philosophes de cette période ont jeté les bases de la pensée moderne. C’est ainsi que le platonisme (devenu le “néo-platonisme”) a baigné les premiers siècles de l’ère chrétienne. Le pythagorisme a accompagné l’époque Médiévale et alimenté la réflexion sur les nombres durant la Renaissance. Mis à l’écart lors des premiers siècles de notre ère, l’aristotélisme revint en force dès le 13e siècle, notamment sous la plume de Saint Thomas d’Aquin. Plus tard, nous retrouvons l’influence du Stoïcisme chez Descartes, Pascal, Montaigne, celle de l’épicurisme chez Montaigne, Gassendi ou Hobbes. La plupart des doctrines imaginées par l’homme, l’Idéalisme, le Rationalisme, le Relativisme, le Scepticisme etc. étaient déjà présentes dans les principales écoles de l’Antiquité. De son coté, le logos a accompagné toutes les évolutions de la philosophie. Il fut le témoin silencieux et ourlé de mystère qui traduisit, au-delà d’une sagesse recherchée, le cheminement d’une raison en quête de savoir. Compagnon de la pensée, le logos a parfois exprimé l’inexprimable. Il incarna souvent l’élan de l’homme vers ce qu’il y a de meilleur en lui. Aussi, Logos, accepte la gratitude d’un homme auquel tu as beaucoup apporté...
Patrick Perrin
VOS COMMENTAIRES
Un ami vient de me faire découvrir votre site philosophique. J’ai lu avec le plus grand intérêt votre article sur le logos. Je tiens à saluer sa qualité rédactionnelle ainsi que l’accessibilité du vocabulaire utilisé en dépit de la difficulté du sujet. Les nombreuses citations auxquelles vous recourez sont toujours judicieuses et d’une grande fiabilité. Soit vous êtes doté d’une excellente mémoire ou vous avez mis au point un système de notes très performant. J’ai beaucoup apprécié la finesse de vos analyses et la transversalité qui baigne votre article. Cela dénote chez vous un remarquable esprit de synthèse. Voila pour les fleurs... J’ai maintenant deux petites critiques à formuler. Vous avez associé le logos à la dialectique ascendante de Platon. Cet avis est intellectuellement courageux (et novateur, d’après mes sources) mais insuffisamment étayé d’autant plus que vous n’avez pas évoqué le rôle des nombres chez Platon. Concernant Héraclite, il manque un approfondissement sur la distinction entre logos divin et commun. Mais, rassurez-vous, ces remarques ne remettent pas en cause l’excellence de votre pensée. Je vais lire votre deuxième article et vous ferai part de mes impressions.
A bientôt.
Je vous remercie d’avoir bien voulu m’adresser un commentaire à ce point éclairé. Sans nul doute, cher internaute, vos connaissances en matière de philosophie dépassent très largement le simple cadre de la curiosité. Merci encore. C’est donc avec un grand plaisir que je me propose d’approfondir avec vous les points qui vous ont semblé insuffisamment traités. Effectivement (et peut-être à tort, d’ailleurs, bien que...) je n’ai pas évoqué le rôle des nombres dans la dialectique ascendante telle que Platon la concevait. Naturellement, je me suis posé cette question mais ai considéré qu’une telle évocation ne serait guère opportune. Maintenant, je me dois de vous dire pourquoi. Mais avant de poursuivre, remémorons-nous le sujet de l’article. Il s’agissait de réfléchir sur l’évolution du logos à partir de sa fondation sous la plume d’Héraclite (VI/V siècle av. J.C.) jusqu’à ce que le christianisme se l’approprie. A la suite d’Héraclite, deux écoles s’affrontèrent : celle des sophistes, pour lesquels le logos n’était plus une passerelle entre le divin et les hommes, et celle de Platon qui tenta de restaurer ce lien. Pour Platon, donc, il existait un monde transcendantal accessible à l’âme humaine à la condition, toutefois, qu’elle tente de l’atteindre. Et c’est ici qu’entra en scène la dialectique ascendante. Maintenant en fonction de quel raisonnement ai-je associé le logos à cette dialectique ascendante ? Tout simplement à partir du rôle que lui attribua Platon. La dialectique ascendante est un mouvement de l’âme qui s’extirpe du multiple (le monde sensible) pour s’élever d’idée en idée jusqu’à l’Un afin de découvrir le principe de chaque chose. Mais, finalement, qu’est donc l’Un ? Quelque part, il est dieu, Un/dieu, plutôt. Il est le démiurge du Timée, le principe des principes, la cause des causes. Il est surtout l’aboutissement d’un élan métaphysico-mystique dont la vocation est d’établir un lien entre les hommes et le divin. Alors, ai-je pensé, l’Un platonicien est la finalité d’un logos restauré dans sa majesté divine. Ceci étant posé, une nouvelle question s’est imposée à mon esprit : qu’elle est la place des mathématiques dans la dialectique ascendante ? Si les mathématiques avaient été semblables à cette dialectique, la question se serait résolue d’elle-même puisque les unes auraient été l’autre. Cependant, écoutons Platon : « Veux-tu dire, déclare Socrate en s’adressant à Glaucon, le travail du prélude, ou quel autre ? Ne savons-nous pas que toutes ces études (notamment, les mathématiques) ne sont que le prélude de l’air même qu’il faut apprendre ? Car certes, les habiles en ces sciences ne sont pas, à ton avis, des dialecticiens. République 531d. » Ici, Platon est très clair : les mathématiques, vient-il de nous dire, sont une propédeutique (préparation) facilitant l’accès à la dialectique ascendante. Elles sont utiles, précise-t-il, car « leur étude est nécessaire (...) au philosophe pour sortir de la sphère du devenir et atteindre l’essence (...) Ibid. 525b. » Utiles, donc, nécessaires aussi, mais non suffisantes. En bon dialecticien (au sens d’Aristote, cette fois ci – cf. les Topiques -) Platon explique pourquoi, et bien qu’elles relèvent de la science, les mathématiques ne sont pas La science : « Ayant supposés (les arithméticiens ou les géomètres) ces choses (le pair, l’impair, les angles etc.) comme s’ils les connaissaient, ils ne daignent en donner raison ni à eux-mêmes ni aux autres, estimant qu’elles sont claires pour tous (...) Ibid. 510c. » Il découle de ceci que les mathématiques ou la géométrie repose sur un système axiomatique dont les principes « à priori » n’ont pas besoin d’être démontrés. Par contre, la méthode dialectique, nous dit Platon, « est la seule qui, rejetant les hypothèses, s’élève jusqu’au principe même pour établir solidement ses conclusions (...) Ibid. 533d. » La distinction entre les mathématiques et la dialectique devient ici des plus claire : les mathématiques partent de principes non démontrés pour rechercher déductivement les propriétés des objets qu’elles traitent. Ce processus est donc essentiellement analytique. De son coté, la dialectique (ascendante, évidemment) ne recherche pas des conclusions élaborées à partir de principes énoncés a priori. Au contraire, elle rejette systématiquement ces principes pour parvenir jusqu’à un principe unique à partir duquel tout ce qui est découlerait. Je vous accorde volontiers, cher internaute, que la distinction existant entre les mathématiques et la dialectique ascendante ne saurait, à elle seule, justifier l’occultation des premières. Certes ! Mais si l’on veut bien considérer la dialectique platonicienne dans son ensemble nous devons convenir qu’elle est duale. La première, la dialectique ascendante, conduit l’esprit (l’âme, nous dit Platon) du multiple vers l’Un. Ce processus est donc synthétique. Par contre, la dialectique descendante invite l’esprit à effectuer le parcours inverse en empruntant, cette fois-ci, la voie analytique. La question qui se pose maintenant est celle-ci : les mathématiques recourent-elles simultanément à la synthèse et l’analyse ? Il ne le semble pas car elles partent de notions qu’elles traitent par voie déductive. En géométrie, par exemple, l’essence du triangle n’est pas recherchée mais seulement ses propriétés. Il ressort de tout ceci que s’il est possible d’assimiler les mathématiques à la dialectique descendante, cela n’est pas possible en ce qui concerne la dialectique ascendante. Or, et dans la mesure ou j’ai associé le logos à cette dernière, évoquer les mathématiques m’aurait conduis à sortir de mon sujet. Par contre, si j’avais consacré mon article à l’étude de la dialectique platonicienne, et non au logos, occulter les mathématiques (et le rôle des nombres) aurait certainement constitué une grave erreur.
Venons en maintenant à la distinction entre le logos divin et le logos commun d’Héraclite. De prime abord, il est évident que la simple lecture de son deuxième fragment vous donne entièrement raison : « Aussi faut-il suivre le logos commun, nous dit Héraclite, mais, bien qu’il appartienne à tous, le vulgaire n’en vit pas moins comme si chacun avait une intelligence particulière. » Ceci étant, je dois vous avouer que votre critique me confronte à un redoutable problème. En effet, et comme le déclara, non sans ironie, Socrate, comprendre Héraclite est loin d’aller de soi : « Ce que j’en ai compris (un ouvrage d’Héraclite) me paraît génial ; pour le reste, que je n’ai pas compris, je crois qu’il en est de même, mais j’aurais besoin pour interprète d’un bon nageur de Délos. Diogène Laërce : Vies des philosophes illustres Vol. 1 p. 110. » Du, cette fois-ci, à la plume du roi Darius, un autre témoignage corrobore cet avis : « Vous avez écrit un livre de la nature difficile à comprendre et à expliquer. Diogène Laërce. Ibid. Vol 2 p. 167. » Alors, s’il existe bien un logos divin et un autre, commun, encore faudrait-il, pour les départager, avoir une idée précise du premier. Or, et comme nous venons de le voir, la clarté ne fut pas la vertu principale d’Héraclite... Ceci étant, nous pouvons malgré tout nous pencher sur le fragment 1 d’Héraclite : « ce mot (logos), les hommes ne le comprennent jamais, aussi bien avant d’en avoir entendu parler qu’après. Bien que tout se passe selon ce mot, ils semblent n’avoir aucune expérience de paroles et de faits tels que je les expose, en distinguant et en expliquant la nature de chaque chose. (...) » Que nous apprend ce fragment ? Concernant l’extension du concept « logos », il semble bien qu’il englobe « tout ce qui se passe. » Or, pour Héraclite, tout ce qui se passe a pour seule origine le feu : « C’est le feu qui a tout créé et c’est en lui que tout se résout. Diogène Laërce : Ibid. Vol. 2 p. 165. » En toute logique, le feu participe du logos et, comme le feu est un principe premier, le logos ne peut être qu’une cause première ne pouvant provenir que du divin. La suite du fragment nous apprend, d’une part, qu’Héraclite se présente comme l’interprète de ce divin et, d’autre part, qu’il regrette l’incompréhension de ceux auxquels il s’adresse. Certes ! Mais au sortir de ce rapide survol, savons-nous vraiment ce qu’est le logos ? Un démiurge ? Non ! Un principe recteur de l’univers ? Non, encore ! Dieu ? Mais, si c’est le cas, de quel dieu s’agit-il ? Celui, inutile, du fragment 30 ? « Ce monde-ci, le même pour tous les êtres, aucun des dieux ni des hommes ne l’a créé (...) » Ou le guide du fragment 93 ? « Le dieu, dont l’oracle est à Delphes, ne parle pas, ne dissimule pas : il indique. » Ainsi que l’a si bien noté Jean Brun (Les présocratiques, p. 46) : « Comme l’oracle qui parle sans dire ceci ou cela, le logos nous transmet le Sens qu’il nous appartient de déchiffrer dans la mesure de nos forces. » Considéré sous cet angle, le logos est bien davantage qu’un dieu. Il est le pourvoyeur du Sens énigmatique qui baigne la condition humaine. « Il est donc à la fois et paradoxalement, nous dit encore Jean Brun –Ibid. p. 47-, un Sens qui nous est transcendant (le logos divin) et une signification qui nous est immanente (le logos commun.) Le logos se situe au cœur de la déchirure par laquelle l’homme est écartelé entre l’Etre manquant et l’existence qui le constitue ; la condition de celui-ci ne donc être que tragique. » Ainsi, vient de nous dire Jean Brun, l’homme participe de l’Etre mais n’est pas l’Etre tout comme il participe de l’existence en fusionnant, cette fois-ci, avec elle. Nous pouvons penser que la double acception du logos résulte de ce paradoxe qui, à lui seul, résume ce que nous appelons : la condition humaine. Alors, cher internaute, le logos divin relève d’un Etre inaccessible et éternellement manquant alors que le logos commun baigne l’existence des humains. A eux de le percevoir, semble encore nous dire Héraclite de son lointain passé...
P. Perrin.
Envoyer un commentaire


